Denis Diderot (1713-1784)
Jacques le Fataliste (1773, publication 1796)
— Marquis, il s’agit… Je suis désolée ; je vais vous désoler, et, tout bien considéré, il vaut mieux que je me taise.
— Non, mon amie, parlez ; auriez-vous au fond de votre cœur un secret pour moi ? La première de nos conventions ne fut-elle pas que nos âmes s’ouvriraient l’une à l’autre sans réserve ?
— Il est vrai, et voilà ce qui me pèse ; c’est un reproche qui met le comble à un beaucoup plus important que je me fais. Est-ce que vous ne vous apercevez pas que je n’ai plus la même gaieté ? J’ai perdu l’appétit ; je ne bois et je ne mange que par raison ; je ne saurais dormir. Nos sociétés les plus intimes me déplaisent. La nuit, je m’interroge et je me dis : est-ce qu’il est moins aimable ? Non. Est-ce que vous auriez à vous en plaindre ? Non. Auriez-vous à lui reprocher quelques liaisons suspectes ? Non. Est-ce que sa tendresse pour vous est diminuée ? Non. Pourquoi, votre ami étant le même, votre cœur est-il donc changé ? car il l’est : vous ne pouvez vous le cacher ; vous ne l’attendez plus avec la même impatience ; vous n’avez plus le même plaisir à le voir ; cette inquiétude quand il tardait à revenir ; cette douce émotion au bruit de sa voiture, quand on l’annonçait, quand il paraissait, vous ne l’éprouvez plus.
— Comment, madame ! »
Alors la marquise de La Pommeraye se couvrit les yeux de ses mains, pencha la tête et se tut un moment après lequel elle ajouta : « Marquis, je me suis attendue à tout votre étonnement, à toutes les choses amères que vous m’allez dire. Marquis ! épargnez-moi… Non, ne m’épargnez pas, dites-les-moi ; je les écouterai avec résignation, parce que je les mérite. Oui, mon cher marquis, il est vrai… Oui, je suis… Mais, n’est pas un assez grand malheur que la chose soit arrivée, sans y ajouter encore la honte, le mépris d’être fausse, en vous le dissimulant ? Vous êtes le même, mais votre amie est changée ; votre amie vous révère, vous estime autant et plus que jamais ; mais… mais une femme accoutumée comme elle à examiner de près ce qui se passe dans les replis les plus secrets de son âme et à ne s’en imposer sur rien, ne peut se cacher que l’amour en est sorti. La découverte est affreuse mais elle n’en est pas moins réelle. La marquise de La Pommeraye, moi, moi, inconstante ! légère !… Marquis, entrez en fureur, cherchez les noms les plus odieux, je me les suis donnés d’avance : donnez-les-moi, je suis prête à les accepter tous…, tous, excepté celui de femme fausse, que vous m’épargnerez, je l’espère, car en vérité je ne le suis pas… » (Ma femme ? – Qu’est-ce ? – Rien. – On n’a pas un moment de repos dans cette maison, même les jours qu’on n’a presque point de monde et que l’on croit n’avoir rien à faire. Qu’une femme de mon état est à plaindre, surtout avec une bête de mari.) Cela dit, Mme de La Pommeraye se renversa sur son fauteuil et se mit à pleurer. Le marquis se précipita à ses genoux, et lui dit : « Vous êtes une femme charmante, une femme adorable, une femme comme il n’y en a point. Votre franchise, votre honnêteté me confond et devrait me faire mourir de honte. Ah ! quelle supériorité ce moment vous donne sur moi ! Que je vous vois grande et que je me trouve petit ! C’est vous qui avez parlé la première, et c’est moi qui fus coupable le premier. Mon amie votre sincérité m’entraîne ; je serais un monstre si elle ne m’entraînait pas, et je vous avouerai que l’histoire de votre cœur est mot à mot l’histoire du mien. Tout ce que vous vous êtes dit, je me le suis dit ; mais je me taisais, je souffrais, et je ne sais quand j’aurais eu le courage de parler.
— Vrai, mon ami ?
— Rien de plus vrai ; et il ne nous reste qu’à nous féliciter réciproquement d’avoir perdu en même temps le sentiment fragile et trompeur qui nous unissait.
— En effet, quel malheur que mon amour eût duré lorsque le vôtre aurait cessé !
— Ou que ce fût en moi qu’il eût cessé le premier.
— Vous avez raison, je le sens.
— Jamais vous ne m’avez paru aussi aimable, aussi belle que dans ce moment ; et si l’expérience du passé ne m’avait rendu circonspect, je croirais vous aimer plus que jamais. » Et le marquis en lui parlant ainsi lui prenait les mains, et les lui baisait… (Ma femme ? – Qu’est-ce ? – Le marchand de paille. – Vois sur le registre. – Et le registre ?… Reste, reste, je l’ai.) Mme de La Pommeraye, renfermant en elle-même le dépit mortel dont elle était déchirée, reprit la parole et dit au marquis : « Mais, marquis, qu’allons-nous devenir ? »
— Nous ne nous en sommes imposé ni l’un ni l’autre ; vous avez droit à toute mon estime; je ne crois pas avoir entièrement perdu le droit que j’avais à la vôtre ; nous continuerons de nous voir, nous nous livrerons à la confiance de la plus tendre amitié.
Pour le commentaire…
On remarque d’abord la ruse de la marquise : elle dit le faux pour savoir le vrai. Le marquis, à la fin de notre extrait, tombe dans le piège et n’a rien compris, d’où un certain pathos. Le mécanisme de la double énonciation mène à une ironie tragique.
La marquise est une veuve, le marquis un libertin.
On peut relever trois temps dans cet extrait :
I. La fausse confidence : elle se donne pour vraie. On trouve de nombreux effets d’attente : la marquise ne cesse de rajouter des phrases. On trouve des traces de théâtralité (cf. Marivaux) : les personnages sont des nobles, les thèmes sont tragiques et sont replacés dans un monde quotidien. On note aussi le phénomène de l’aposiopèse (ou réticence) représenté par les nombreux points de suspension. Le double langage conduit à la perversion du langage et c’est sur quoi il faudrait s’intéresser dans le cadre d’une étude détaillée. Ce projet de lecture étudierait idéalement la dialectique incertaine entre la raison et le sentiment, mise en rapport avec la franchise factice de la rupture.
II. La réponse du marquis : une scène d’aveu inversé. Il y a aveu d’amour, mais qui est en fait un aveu de désamour → ironie tragique.
III. La clarification : la marquise l’a obtenue : elle a gagné mais elle a tout perdu. En effet, elle n’est plus aimée, d’où une certaine douleur ; on note le dépit amoureux, le dépit mortel. Le marquis désavoue de surcroît l’amour passé. La marquise s’est bien enfermée dans son mensonge.
Conclusion
Rappels pour la méthode de la conclusion :
– Reformulation, récapitulation des propos,
– Ouverture (contexte plus vaste) :
- En l’espèce, la blessure de la marquise explique sa vengeance, et notamment l’intensité de celle-ci. En effet, elle va s’arranger pour que le marquis tombe amoureux d’une prostituée, et qu’il se marie avec. Le marquis s’en trouvera déconsidéré au sein de la société parisienne.
- Pour Diderot, un comédien, pour bien jouer, ne doit pas éprouver les sentiments. En l’occurrence, la marquise est une actrice convaincante puisqu’elle se détache de ses véritables sentiments. Selon Diderot encore, le mariage (qui dure toute la vie) est une aberration → plaidoyer pour l’union libre, pour l’éphémérité de l’amour. D’où le paradoxe de notre extrait : la marquise incarne l’amour qui dure.
- On peut aussi évoquer la dialectique raison / sentiment propre au XVIIIe siècle avec un auteur comme Marivaux (thèmes du théâtre, du mensonge, du piège, du déguisement, et de la confidence qui forcent l’aveu d’amour). Chez Marivaux, on attend longtemps l’aveu, contrairement à ce qu’on a pu voir dans notre extrait. Laclos, quant à lui, représente l’amour comme une lutte. On y voit la préfiguration du libertinage, avec un rapport de force entre les deux amants.
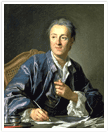 — Marquis, il s’agit… Je suis désolée ; je vais vous désoler, et, tout bien considéré, il vaut mieux que je me taise.
— Marquis, il s’agit… Je suis désolée ; je vais vous désoler, et, tout bien considéré, il vaut mieux que je me taise.