Les Âmes fortes1 de Giono (1949)
Chronique du mal ordinaire et extraordinaire
À mon fils Aymeric et à son ami Ferdinand, tous deux étudiants en CPGE.
Introduction
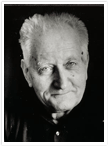 Giono, l’idéaliste, vient de vivre une expérience traumatisante. L’ancien combattant de 14-18, qui avait été écœuré par la barbarie du premier conflit mondial, avait voulu, malgré la montée des fascismes, rester résolument pacifiste. Il avait payé ce premier engagement par un séjour dans les geôles de la République pour propagande antimilitariste et incitation à la désertion. Lors du conflit armé, en revanche, le courant pétainiste le transforme à son insu en collaborateur de l’occupant. À la Libération, il connaît à nouveau la honte d’être incarcéré et injustement condamné. Giono vient d’expérimenter le mal sous les espèces du mensonge et de la falsification. Aux grands élans idéalistes de Que ma joie demeure vont succéder une période créatrice désabusée, plus noire, pour tout dire pessimiste. Les Âmes fortes appartiennent à cette époque.
Giono, l’idéaliste, vient de vivre une expérience traumatisante. L’ancien combattant de 14-18, qui avait été écœuré par la barbarie du premier conflit mondial, avait voulu, malgré la montée des fascismes, rester résolument pacifiste. Il avait payé ce premier engagement par un séjour dans les geôles de la République pour propagande antimilitariste et incitation à la désertion. Lors du conflit armé, en revanche, le courant pétainiste le transforme à son insu en collaborateur de l’occupant. À la Libération, il connaît à nouveau la honte d’être incarcéré et injustement condamné. Giono vient d’expérimenter le mal sous les espèces du mensonge et de la falsification. Aux grands élans idéalistes de Que ma joie demeure vont succéder une période créatrice désabusée, plus noire, pour tout dire pessimiste. Les Âmes fortes appartiennent à cette époque.
Le titre du roman fait penser à celui de Nicolas Gogol, les Âmes mortes. Bien entendu, c’est la paronomase qui nous y invite. Apparemment, Giono rejoint son illustre devancier dans le récit burlesque de diverses escroqueries, dans la peinture d’une société provinciale matérialiste et conformiste, sa chronique dénonce ainsi la médiocrité humaine. Pourtant en retenant un titre à la signification opposée, l’auteur méridional entend s’intéresser à des personnages hors du commun. Ce conte nous rapporte, pour reprendre le titre d’une œuvre de Georges Duhamel, la Confession de Minuit d’une certaine Thérèse. La lumière du Sud y rejoint la grisaille de Sous le Soleil de Satan de Bernanos pour nous révéler les turpitudes, la noirceur de l’âme humaine et le triomphe du mal. Ce récit parlé polyphonique est un témoignage fantastique sur la puissance évocatrice des veillées rurales de jadis éteintes par la civilisation industrielle. Il se pourrait que les âmes d’exception aient disparu sous les assauts de la modernité qui non seulement a fait voler en éclats le huis-clos, mais a aussi asséché les mots du désir mimétique.
Résumé
Quelque part dans la Drôme, en 1949, le pauvre Albert vient de trépasser. Quelques commères à la langue bien pendue sont venues veiller le mort. Il y a des voix anonymes, mais aussi Berthe la craintive, Rose l’accapareuse, et surtout une certaine Thérèse, plus âgée et plus verte que les autres, qui peu à peu impose sa présence. Pour passer le plus confortablement possible cette froide nuit d’hiver auprès du défunt, les voilà qui se réchauffent en festoyant, en buvant sec et en médisant du mort, de leurs familles et des voisins. Excès de boisson, violences conjugales, grivoiserie, sottise, âpreté au gain, manigances, personne n’est épargné. Ces vipères bafouent les conventions en ne respectant pas le recueillement sacré qui aurait dû entourer le mort. Les hypocrites conteuses, qui ne semblent pas craindre l’au-delà, sont obnubilées par la prégnance de la vie, le burlesque des apparences et la noirceur de la conscience d’autrui. Le ton est donné : la vie est une grimaçante comédie des apparences, l’agitation humaine est ridicule, l’homme est une bête malfaisante ou stupide… Alors peuvent émerger peu à peu du troupeau ces trop rares âmes fortes qui ont donné son titre au récit.
Thérèse, placée par ses parents comme lingère au château du Percy, décide de se faire enlever par Firmin. La famille de la jeune femme ne veut pas d’un mariage avec un orphelin, pauvre et sans véritable métier. Un soir de mai, Thérèse s’enfuit par les toits pour rejoindre Firmin qui l’attend avec une échelle. Les voilà lancés dans une course folle, puis une longue marche jusqu’à Lus pour prendre finalement la voiture de Châtillon. Rendus dans ce bourg qui sert de « centre de roulage », c’est-à-dire de relais pour les voitures ou les charrois, Firmin se fait embaucher chez le maréchal-ferrant Gourgeon. Thérèse semble avoir oublié ou dissimulé l’épisode peu glorieux d’une débauche de deux jours dans un hôtel borgne de Lus avant d’arriver à Châtillon. Dans ce bourg, Thérèse, pour sa part, s’engage comme servante à l’auberge. Elle y apprend à connaître le monde. C’est également là qu’elle fait la connaissance d’un joueur de billard affable, distingué, coqueluche de la société locale : le riche M. Numance. Un jour d’hiver, un huissier de Valence vient réclamer une dette de vingt mille francs qu’aurait contractée l’élégante et distante Mme Numance. Tout le bourg est en émoi. Thérèse va espionner la rencontre et s’étonner que la débitrice manifeste un détachement étrange dans cette société matérialiste. Par la suite, M. Numance est conduit à réduire son train de vie, à renoncer à ses parties de billard publiques et à jouer seul dans une arrière-salle. Thérèse qui a repéré le manège conseille à Firmin de tenir compagnie au bourgeois blessé. Thérèse commence doucement à s’immiscer dans l’intimité du couple. Puis M. Numance est amené à recourir aux services de l’usurier Réveillard, la terreur du pays. C’est le début de la décadence financière du couple. Tout Châtillon échafaude mille hypothèses pour connaître l’origine de cette dette fastueuse, et espionne à qui mieux mieux l’étrange Mme Numance qui défie quotidiennement le bourg par ses tenues distinguées lors de ses promenades hautaines. Thérèse et Firmin logent dans une « cabane à lapins » qu’on leur a prêtée. Thérèse y met au monde son premier enfant. Auparavant, Firmin a exploité habilement le dénuement du couple et la régularisation de sa situation matrimoniale pour devenir le centre d’intérêt de l’activité caritative protestante. Il faut trouver un nouvel équilibre d’autant plus que la forge Gourgeon est en train de péricliter.
Thérèse, séduite par la personnalité de Mme Numance, pense alors servir chez elle. Les Numance qui n’attendaient que cette offre de service vont jusqu’à donner un pavillon et un bout de terrain pour loger leurs nouveaux domestiques. Le méfiant Firmin se demande ce que cache cette offre généreuse. Thérèse passe des jours heureux auprès de sa patronne. Une grande complicité s’établit entre elles. Pendant ce temps, Firmin exploite habilement la situation pour se faire employer lui aussi. Son fils Charles est baptisé, la marraine est Sylvie Numance. Mais Firmin, tenu à l’écart de la relation fusionnelle de Thérèse et de Sylvie, émet stupidement des soupçons sur la fidélité de son épouse. Un soir il la frappe sauvagement. Ces violences finissent de rapprocher les deux femmes, Mme Numance y discerne l’occasion d’élever sa servante au rang de fille selon son cœur. Les mois qui suivent voient Sylvie souffrir atrocement de sa passion maternelle pour Thérèse car elle craint que sa domestique ne l’aime pas pour elle-même, qu’elle soit prisonnière de la reconnaissance. Elle l’impose à la bonne société du bourg. Au contact de sa maîtresse adorée, Thérèse devient plus raffinée, se coule dans la personnalité de son modèle. Firmin spécule sur les coupes de bois, il s’est mis en cheville avec l’usurier Réveillard. Il demande à Thérèse de dépenser ostensiblement ses gains pour marquer leur réussite. Il ramène encore quelques bénéfices, puis voulant tenter une grosse opération, est victime de la pluie qui arrive trop tard, se trouve ruiné et à la merci du terrible Réveillard. En fait Firmin a conçu cette mise en scène pour soutirer 50 000 F aux généreux Numance qui ont éventé la manœuvre. Six mois plus tard, Réveillard vient exiger les sommes dues. M. Numance est alors victime d’une attaque et décède dans les bras de son épouse. Sylvie quitte mystérieusement les lieux sans rien emporter, ni argent, ni vêtement ; elle disparaît à jamais.
Le dernier récit de Thérèse nous ramène en arrière et reprend toute l’histoire selon la perception de l’héroïne. Cette dernière rapporte comment elle a bridé ses sentiments pour ne laisser agir que sa tête. Elle a aussi dressé Firmin pour devenir l’outil docile de ses projets. Depuis l’auberge où elle sert, elle a appris à connaître la scène du monde et ses piètres acteurs. S’étant constituée un masque de femme-enfant stupide et bonasse, elle décide de séduire Mme Numance. D’abord elle choisit de tomber enceinte, puis se fait mettre à la porte de l’auberge en plein hiver pour paraître une pauvre victime qui excitera la pitié. De bonnes gens lui proposent d’occuper une cabane à lapins dont elle compte tirer parti pour donner des remords au bourg. Commence alors le « combat » avec « une certaine personne » : Thérèse va se faire désirer pour attiser la mauvaise conscience de Mme Numance.
Nous repartons alors pour vivre les conséquences de la disparition de Sylvie. Thérèse cherche partout sa « mère » en hurlant comme une folle. Firmin qui veut la faire taire s’avise de la frapper. Mal lui en prend car il se fait taillader le visage par sa femme en furie. Pendant trois jours, Thérèse erre à la recherche de la disparue. Elle est ramenée ligotée par les gendarmes. Lors de son retour, elle jette un regard de colère sur Firmin. Tout Châtillon est ému jusqu’aux larmes par l’amour filial de la jeune femme. En revanche tous accusent Firmin. Au cours des mois suivants, Firmin cherche à évacuer sa peur en battant sa femme. À chaque fois il a le dessous. Calmement Thérèse le blesse dans sa virilité, ce qui le terrorise. Le couple paraît avoir passé une paix armée après une altercation qui a immobilisé Firmin pendant deux mois. Thérèse et Firmin quittent alors Châtillon pour s’installer à Clostre où ils ont acheté l’auberge. Firmin y rêve d’assassiner sa femme, mais Thérèse le devine sans arrêt. Elle continue de punir son mari en prenant pour amant le cocher muet de Lus. Elle en a deux enfants. Seize ans plus tard, Thérèse a l’idée de rejoindre le chantier de construction de la voie ferrée, mais elle s’arrange pour que ce soit Firmin qui le décide. Elle devient la cantinière du village nègre. Elle aguiche l’entrepreneur Rampal, ce qui rend jaloux le postillon muet. Ayant repris le contrôle de ces deux « outils », elle décide de faire tuer Firmin devenu inutile à ses projets. Un soir d’automne, Firmin est retrouvé les reins cassés dans les déblais. Le muet l’a poussé. Thérèse joue sur la peur de Rampal pour rompre leurs relations intimes utilitaires et lui arracher une pension au motif d’ « accident du travail ».
La structure du récit
La structure de ce récit oralisé est complexe si bien qu’il est difficile de restituer une trame linéaire logique.
Les préliminaires (p. 7 – p. 53)
Le temps de l’énonciation se situe au cours de l’hiver 1949. Chaque énonciataire prend en charge ses propos par la 1re personne. Le lecteur découvre plusieurs récits secondaires enchâssés qui n’ont pas de liens apparents avec l’intrigue principale.
1er récit de Thérèse (p. 53 – p. 69)
Thérèse prend la parole, son propos n’est coupé que par quelques commentaires ou demandes d’information. Le récit subit un retour en arrière en 1882, soit presque soixante-dix ans plus tôt.
Le récit contradictoire d’une commère (p. 70 – p. 75)
Une participante à la veillée (la nièce de la Tante Junie) conteste les conditions d’arrivée de Thérèse et de Firmin à Châtillon.
Reprise du 1er récit de Thérèse (p. 75 – p. 80)
Thérèse décrit comment elle a vécu le service à l’auberge de Châtillon.
Interruption par une commère (p. 80 – p. 82)
Une commère cherche à savoir quand sont intervenues les dames de Sion.
Reprise du 1er récit de Thérèse (p. 82 – p. 120)
Thérèse continue l’évocation de son service à l’auberge de Châtillon. Puis elle raconte la visite de l’huissier chez les Numance et les signes conséquents de la baisse d’estime des Châtillonnais pour le couple.
Prise de parole contestataire par une commère (p. 120 – p. 272)
Cette interruption débute par une prolepse sur le séjour de Firmin et de Thérèse à Clostre, puis sur leurs liens avec Rampal dit Cartouche. La commère apostrophe Thérèse sur un ton menaçant ou soupçonneux. Elle se livre à un portrait acide et croustillant de Firmin. L’intervention se poursuit par une analepse à Châtillon, puis à Carpentras pour rapporter l’histoire des Numance. Dans l’histoire de la relation entre le couple des Numance et celui de Thérèse, la narratrice passe peu à peu de la focalisation interne à la focalisation omnisciente en rapportant des propos ou des scènes auxquels elle n’a pu manifestement assister. De plus ses propos sont assortis de remarques et de commentaires qui dépassent sa culture, sa logique, sa psychologie ou sa perspicacité. La narratrice intradiégétique s’est muée en porte-parole de l’auteur.
2e récit de Thérèse (p. 272 – p. 332)
La commère interpelle Thérèse et l’invite à reprendre le fil de l’histoire à l’auberge. Thérèse rapporte la conquête de Mme Numance.
2e prise de parole contestataire par la commère (p. 332 – p. 366)
La narratrice disparaît au profit d’une 3e personne extradiégétique omnisciente.
Fin du 2e récit de Thérèse (p. 366 – p. 370)
Thérèse redevient narratrice et maîtresse du jeu jusqu’à la fin. C’est elle qui a le dernier mot.
Épilogue (p. 370)
Retour à l’hiver 1949.
Chronologie romanesque déductive :
1813 : naissance de Bernard Numance (p. 166)
Vers 1817 : naissance de Sylvie Numance (2e version)
1843 : mariage de Bernard et de Sylvie (p. 176)
1851 : Bernard Numance prend une part active contre le coup d’État napoléonien.
1852 ou 1854 : naissance de Sylvie Numance dans la 1re version
1857 : naissance de Firmin
1860 : naissance de Thérèse
1870 : Bernard et Sylvie Numance participent à la résistance contre l’envahisseur prussien.
1871 : Sylvie et Bernard noient un uhlan dans le Rhône.
Mai 1882 : Thérèse se fait enlever par Firmin
Hiver 1882-1883 : un huissier vient réclamer 20 000 francs aux Numance.
Incident entre Mmes Carluque et Numance.
Printemps 1883 : Fête chez les Carluque qui veulent marquer leur ascendant sur les Numance.
Hiver 1883-1884 : Châtillon tente de savoir qui serait l’amant supposé pour lequel Mme Numance se serait endettée. La commère atteste que Thérèse a eu son premier enfant.
1882 : mariage de Thérèse et de Firmin
Hiver 1882-1883 : Thérèse et Firmin s’installent chez les Numance.
Mars 1883 : Thérèse (2e version) se fait renvoyer de l’auberge et accepte la cabane à lapins.
1883 : Firmin roue Thérèse de coups.
Hiver 1883-1884 : Firmin spécule sur les coupes de bois, il demande à Thérèse de dépenser ostensiblement.
Hiver 1884-1885 : Firmin et Réveillard tendent un traquenard aux Numance.
Printemps 1885 : Firmin espionne sans arrêt Mme Numance.
Été 1885 : Réveillard vient exiger son dû. Mort de M. Numance et disparition définitive de son épouse.
Été 1886 ? : Thérèse et Firmin quittent Châtillon pour s’installer à Clostre.
Juillet 1888 : naissance du deuxième enfant de Thérèse.
Octobre ou novembre 1889 : naissance du troisième enfant de Thérèse.
1902 : Firmin et Thérèse s’installent comme gérants de la cantine du village nègre2.
1904 : décès de Firmin
1949 : temps de l’énonciation
On s’aperçoit qu’entre les deux récits, celui de Thérèse et de la commère, il existe d’importantes divergences de dates.
Incohérences et contradictions
Le lecteur cartésien est vite confronté à d’apparentes incohérences ou contradictions, ce qui peut le déranger. Mais la plupart ne sont discernables que lors d’une relecture. En voici quelques exemples :
Thérèse affirme avoir vécu trente ans en compagnie de Firmin (p. 58), ce qui est exagéré. En réalité la durée de la vie commune n’a pu excéder vingt-deux ans.
Thérèse affirme que Mme Numance « pouvait avoir vingt-huit à trente ans ». (pp. 86-87) Elle est d’abord définie comme une demoiselle Rodolphe, fille de marchands de drap en Avignon.
La commère affirme que le postillon s’appelle « Casimir (le muet) et non pas Benoît » (p. 121). Il est curieux que Thérèse se trompe sur le prénom d’un amant qu’elle a gardé plusieurs années.
Giono place la construction de la voie ferrée Grenoble-Veynes en 1904 alors que la ligne a été ouverte par le PLM le 1er février 1878.
Firmin exerce le métier de maréchal-ferrant à Clostre, ce qui paraît impossible en raison de la ruine de sa santé physique après les rudes coups de Thérèse.
M. Numance est-il à la tête d’une scierie ou a-t-il réussi dans les filatures (p. 146) ? Son épouse affirme quant à elle qu’il n’entend rien aux affaires (p. 233).
Mme Numance se parfume-t-elle initialement au Chypre3 ou à la violette ? Cette question qui pourrait paraître futile entraîne une réponse qui l’est beaucoup moins. En effet est-ce Thérèse qui a choisi de se parfumer pour imiter son « idole » ou est-ce la bourgeoise raffinée qui a voulu rejoindre la simplicité de sa fille d’adoption ?
Le moment de l’embauche de Thérèse par les Numance varie au cours de la 2e version. Elle intervient peu après la naissance de Charles au début, puis « longtemps après sa délivrance » (p. 196) alors que Thérèse est employée chez un percepteur retraité libidineux.
Nous avons trois ou quatre versions divergentes de la relation entre Thérèse et les Numance : la 1re version de Thérèse, la narration de la commère (qui se subdivise en deux sous-ensembles) et la 2de version de Thérèse.
Au cours du service de Thérèse chez les Numance, la présence de l’enfant en bas âge est le plus souvent occultée, ce qui est peu compatible avec les besoins d’un nourrisson. Le lecteur a l’impression que Charles n’existe plus au cours de ces journées heureuses d’un amour en phase de romance.
Les incertitudes sur l’âge réel de Mme Numance sont plus gênantes : trente-cinq ans de différence changent complètement le sens de la relation. Si la jeune Mme Numance est une rivale enviée par Thérèse, seule la femme âgée peut devenir une mère de substitution.
Il est indispensable de se demander si ces « erreurs » sont volontaires ou non, si elles relèvent d’un laisser-aller ou d’un parti-pris esthétique auquel cas il faut les justifier : Troubles de la mémoire ? Appréciation subjective ? Enjolivement ? Exagérations ? Mensonges ? Désir de s’affirmer ?…
Il est important d’abord de relever quelle était l’ambition de Giono quand il écrit ses chroniques. L’auteur revendique une liberté créatrice.
Il l’a exprimé dans la Préface aux Chroniques romanesques (1962) :
Le plan complet des chroniques romanesques était fait en 1937. Il comprenait une vingtaine de titres dont quelques-uns étaient définitifs, comme Un Roi sans divertissement, Noé, Les Âmes fortes, Les Grands chemins, Le Moulin de Pologne, L’Iris de Suse etc. […] Toutes les histoires sont maintenant écrites, certaines sont publiées, d’autres n’ont pas encore atteint le degré de maturité et de correction pour l’être. Il s’agissait pour moi de composer les chroniques, ou la chronique, c’est-à-dire tout le passé d’anecdotes et de souvenirs, de ce « Sud imaginaire » dont j’avais, par mes romans précédents, composé la géographie et les caractères. Je dis bien « Sud imaginaire », et non pas Provence pure et simple.
C’est un malentendu qu’il faudra un jour dissiper, créé par le fait que je suis né et que je n’ai pas cessé d’habiter à Manosque. J’ai créé de toutes pièces les pays et les personnages de mes romans. C’était non seulement mon droit, mais mon devoir ; un devoir de l’écrivain (du créateur en général) qu’on oublie trop souvent aujourd’hui.[…] J’avais donc, par un certain nombre de romans, Colline, Un de Baumugnes, Regain, Le Chant du monde, Le Grand troupeau, Batailles dans la montagne etc. créé un Sud imaginaire, une sorte de terre australe, et je voulais, par ces chroniques, donner à cette invention géographique sa charpente de faits divers (tout aussi imaginaires). Je m’étais d’ailleurs aperçu que dans ce travail d’imagination, le drame du créateur aux prises avec le produit de sa création, ou côte à côte avec lui, avait également un intérêt qu’il fallait souligner, si je voulais donner à mon œuvre sa véritable dimension, son authentique liberté de non-engagement. […] Le thème même de la chronique me permet d’user de toutes les formes du récit, et même d’en inventer de nouvelles, quand elles sont nécessaires (et seulement quand elles sont exigées par le sujet).
Confronté à ces divergences, chaque lecteur est invité à donner une interprétation personnelle. Cette marge d’appréciation est sans doute voulue par Giono qui reprend peut-être le principe de l’enquête labyrinthique du Monsieur Ouine de Bernanos (1943) pour tenter de comprendre qui est réellement Thérèse. Rappelons que, pour Bernanos, cette perception kaléidoscopique de la réalité humaine est une technique d’écriture qui correspond au projet d’évoquer le mal à partir de l’ambiguïté, de l’obscurité, des énigmes, des mots piégés, de l’incohérence générale qui en résulte car le mal est d’abord opacité, désordre, confusion. L’âme humaine demeure par définition inaccessible, nous ne pouvons la connaître que par ce que la personne veut bien nous révéler. Est posée prioritairement non la véracité du témoignage, mais sa sincérité. Tout le récit de Thérèse est donc à apprécier en fonction de sa personnalité supposée. Le lecteur est ainsi intimement associé à la création romanesque comme à la nécessaire réflexion qu’elle suggère. Le récit résiste à l’analyse, crée une irritante frustration, c’est le prix à payer pour tenter de comprendre une âme d’exception et ses rapports au mal.
Toute la chronique est bâtie sur le principe du retournement, ou de la révélation comme dans le roman policier. Notons en outre la prime au dernier énonciateur, car le lecteur a eu le temps d’oublier les informations précédentes recouvertes par les derniers flux. Thérèse a finalement le dernier mot et ne sera plus contredite. Nous restons sur son autorité consolidée auprès du groupe des commères ce qui donne un crédit certain à sa version des événements. Elle est bien l’héroïne de référence voulue par Giono.
La peinture de la société alpine à la fin du XIXe siècle
Le récit se déroule dans la Drôme. Percy est situé à 25 km au nord de Lus. L’essentiel des événements se passent à Châtillon-en-Diois. Clostre est probablement Grimone.
Châtillon est un « cul-de-sac », « un petit bourg paisible, sans bruit » (p. 141) qui vit replié sur lui-même en raison notamment de sa population de retraités à la vie casanière. Le lieu n’est accessible commodément qu’en été. Pendant les autres saisons les intempéries rendent les déplacements hasardeux si bien que les voyageurs font figure d’aventuriers. Giono décrit les lieux à un moment historique, celui de la fin d’une société rurale enclavée. En effet le chemin de fer va bientôt la faire éclater. Ce nouveau moyen de transport est le symbole de la modernité. Le chemin de fer est en particulier le vecteur de l’industrialisation. Nous vivons les dernières années de certains métiers comme la maréchalerie ou la sellerie étroitement liées aux attelages équins. De même l’industrialisation signe la fin du compagnonnage, dont Firmin se réclame en s’attribuant le sésame de « dévorant ». On assiste également à la transformation des liens de travail entre patron et employés sous la poussée du syndicalisme naissant. Les grands chantiers de travaux publics attirent un prolétariat exploité, les individualités sombrent dans l’anonymat.
La chronique débute comme une satire burlesque des excès de boisson, des violences conjugales, de la grivoiserie, de la sottise, de l’âpreté au gain, des manigances intéressées. Nous sommes dans la veine des fabliaux. Ce burlesque dérisoire culmine dans l’affrontement odieux entre les deux sœurs en présence de leur mère en agonie. Giono écrit là une saynète comique grinçante, (pp. 46 à 51) avant de nous faire entrer peu à peu dans la lente tragédie thérésienne.
La première nécessité de ce monde rural est de survivre. Tous les moyens sont bons pour se procurer le minimum convoité. Très vite se développe la thésaurisation, remède à la peur de manquer. Les regards sont rivés sur les biens matériels. Il en résulte une société mesquine incapable de comprendre ce qui sort de l’ordinaire. Giono se sert d’ailleurs d’un style vert, de la faconde méridionale pour souligner la noirceur et le matérialisme ambiants.
La caractéristique de cette société est le conformisme, le souci du qu’en-dira-t-on. Il faut sauver coûte que coûte les apparences. « Je veux dire être et paraître, la différence que c’est ! Tu vas, tu viens, tu es quelqu’un ; et puis un beau jour ça éclate. » Dès le début, la pression du groupe s’exerce sur Thérèse qui n’ignore pas que sa fuite l’a mise au ban. Elle a choisi délibérément d’appartenir aux « dérobés », ces fugitifs méprisés pour s’être soustraits à l’autorité parentale, pour avoir rompu leur contrat de travail et surtout enfreint les interdits sexuels. Dans cette société féroce, la femme n’a pas d’existence propre. Elle est une proie pour l’avidité masculine. Si elle veut avoir un statut, elle doit se marier. Thérèse l’a bien compris qui distille : « il faut tout faire soi-même. Les hommes ne peuvent servir que de paravent. » (p. 293) Tout le monde vit sous le règne de l’hypocrisie, de la haine des différences. Le village s’abrite derrière des façades traditionnelles et secrètement décomposées : « Les familles étaient sacrées. […] Il ne fallait pas s’y hasarder si on n’avait pas le mot de passe. Tu risquais la mort. […] C’étaient de vieilles familles. Il n’en restait plus que des chicots. » (pp 288 – 289) La religion est un paravent commode ou un sauf-conduit cynique. « Moi j’estime : du moment qu’on est chrétien, on a le droit de tout faire. Tu seras jugée. Alors ne te prive pas. C’est de la banque. » Cet immoralisme goguenard favorise les malins mais il écrase les pauvres d’esprit. À plusieurs reprises, Thérèse parle d’enfer. Giono évacue son credo communiste sur les « damnés de la Terre ». La crapulerie généralisée ainsi que la toute-puissance de l’argent sont issues du réalisme balzacien comme de l’histoire contemporaine à la Libération.
Cette communauté vit de ragots. Les langues vont bon train, les yeux espionnent sans arrêt chacun. Giono nous en dresse un portrait savoureux lors des promenades de Mme Numance : « Elle passait et, à la devanture des magasins tu voyais des têtes dans les vitrines, entre les pelotes de laine, les couronnes mortuaires, les pains de sucre, les têtes de veau et les liasses de boudin » (p. 116). Derrière l’agrandissement burlesque, pointe quand même le regard qui chosifie ou qui tue. Cette médisance énonce un Mal subjectif. Chacun dit ce qui est mal, reprenant le consensus communautaire pour stigmatiser tout ce qui diverge de la norme. Chacun exprime une morale primaire, celle du décalogue. Mais tous les aménagements sont possibles à condition de rester secrets et de conduire à la réussite respectable.
Pour cette société, le mal est d’abord l’inconduite sexuelle : « Quand on veut faire le mal, ce n’est pas une culotte ou une robe qui vous le fait faire, ou qui vous en empêche » (p. 20). La sexualité est un sujet favori pour les commères qui exercent une curiosité malsaine sur leur entourage, qui veulent des détails sur la première nuit de Thérèse et Firmin. Cette société est un regard qui surveille et censure. Thérèse et Firmin sont jugés sur leurs écarts avant leur rencontre. Par la suite, leur statut de concubins scandalise les dames de Sion protestantes dont la vocation est d’aider les nécessiteux. Alors que le couple vit dans la misère, parce que Thérèse est tombée enceinte et qu’elle a dû arrêter de travailler, l’une de ses bonnes âmes jette : « Moi, je vais les faire marier, parce que c’est intolérable. Je vais au plus pressé, après on verra. » (p. 82) Autant dire que le respect de la règle est plus contraignant que la nécessité. Giono satirise ce formalisme de la charité chrétienne sans véritable amour4. Les relations sexuelles extraconjugales, les amours vénales ou intéressées alimentent la rumeur. Les bien-pensants distribuent sans mesure leurs méprisantes appréciations comme à l’encontre « de la Marie qui servait à l’auberge – qui servait de tout » (p. 71). La relation amoureuse des Numance qui ne nécessite plus l’accouplement reste incompréhensible pour la population du bourg.
Le mal est ensuite la bestialité des comportements : débauche, ivrognerie, goinfrerie, crudité des propos, pulsions incontrôlées, négations de fait de toute transcendance. L’alcool abrutit les êtres : « à la longue, l’alcool usait les facultés ; et même les vices, ce qui est plus grave. » Les corps sont animalisés, réifiés en viandes. Les hommes sont des porcs. Quand ils se rasent, ils se « racl[ent] la couenne » (p. 77). On peut noter également la fréquence et la violence des coups portés aux femmes. Pour ces rustres, une gifle serait presque une punition anodine. Ils se caractérisent en outre le plus souvent par leur lâcheté.
La mort y est désacralisée. Seules comptent les certitudes réalistes et concrètes. Les existences sont habitées par la peur de manquer et l’avarice conséquente. L’argent y est omniprésent. « Châtillon ne faisait pas de bruit. Tout le monde y battait doucement son beurre. » (p. 287) Le bourg vit sous le régime du désir mimétique, « On veut toujours ce qu’on n’a pas. » (p. 285) Tout est évalué, calculé. La manière de gagner son argent y prend souvent une tournure exécrable : par exemple, l’huile de foie de morue y est produite à partir de celle qui sert à assouplir les peaux dans les tanneries. Giono l’agnostique se montre proche de la sagesse évangélique : « Soyez bien en garde contre tout désir de posséder, car même quand on a tout, ce n’est pas cela qui donne la vie […] Tu es fou ! Cette nuit-même on va te réclamer ta vie, qui va recueillir ce que tu as préparé ? » Luc (12, 15-20) Bible des peuples.
Cette société est agitée par de puissants conflits d’intérêt. La population se divise entre clans, comme celui des Carluque et celui des Numance. Chacun fait allégeance à un patron comme le plébéien autrefois dans Rome. Seul, l’épicier revendique une indépendance éhontée… « pour la clientèle » en général. Dans cette lutte pour la reconnaissance sociale, l’avidité se dissimule derrière la religion ou la morale. Le sieur Carluque, le tanneur, est sans le savoir une version moderne de l’empereur Vespasien, pour qui l’argent n’avait pas d’odeur puisqu’il s’était enrichi, disait-on, par les taxes sur les latrines. Le dénommé Carluque, donc, n’est pas plus regardant car il empeste les rues de Châtillon par ses cuirs qui macèrent. Cet entrepreneur, qui a su détourner à son profit les fournitures de l’armée, affirme sans arrêt qu’il a la « conscience tranquille » (p. 103) sous-entendu à la différence des Numance qui ont reçu la visite d’un huissier. Le discours implicite est que la prospérité est un témoignage de la bienveillance de Dieu ; la misère, la confirmation de son châtiment. Et comme les Carluque sont catholiques alors que les Numance sont protestants, beaucoup y voient un signe divin qui indique où se situe la vraie foi.
Il faut donner une place à part au village nègre, cet amas de hangars et de baraques dignes de la conquête de l’Ouest américain. L’appellation renvoie aux heures peu glorieuses de la colonisation. Née au milieu des hauteurs inhospitalières du col de la Croix-haute, la bourgade sert à parquer et à exploiter deux mille travailleurs étrangers, des Piémontais5 que la population locale méprise. Lieu où beaucoup rêvent de se constituer une aisance financière, le chantier est caractérisé en fait par ses trafics en tous genres, la vénalité des rapports humains : marchands de sommeil, jeu, prostitution… C’est l’endroit idéal choisi par Thérèse pour se débarrasser de Firmin. Giono en a fait le symbole de la civilisation industrielle qui vient aggraver l’exploitation de la main-d’œuvre, fait éclater le cadre traditionnel de la société rurale, et finit de ruiner les relations personnelles.
Giono porte un regard bien pessimiste sur cette méchanceté humaine ordinaire et sans grandeur, mais le constat et le jugement implicite sont émis sur le mode réjouissant d’une sagesse faussement populaire à l’humour noir.
Un récit épique ouvert sur la mystique
Le récit oralisé recourt naturellement aux exagérations de la faconde méridionale, de la volonté de surprendre, de séduire les auditeurs, d’exprimer avec force des sentiments profonds. Ces amplifications successives nous font entrer progressivement dans le registre merveilleux. En premier lieu, le retour à un passé éloigné est un équivalent du « il était une fois », d’autant plus que l’époque décrite a disparu complètement sous les assauts de la modernité. La chronique entretient également un rapport étroit avec le conte par son aspect binaire entre bien et mal. Enfin le caractère extraordinaire de certains épisodes comme le gain d’une somme importante au loto6, le rôle de la bonne fée tenu par le couple Numance ou les affrontements entre Thérèse et Firmin à Clostre font accéder le récit aux légendaires oppositions entre un héros et des forces qui le dépassent.
La chronique baigne dans un climat pseudo-religieux. La religion traditionnelle est bien présente dans ce récit campagnard, mais envisagée de manière satirique. Deux communautés, la protestante et la catholique, s’affrontent, mais sur le fond, chacune cultive la respectabilité hypocrite. Giono en tire des effets comiques comme lors de la naissance du premier enfant de Thérèse. La cabane à lapins devient une crèche provençale dans laquelle figurent « une Sainte Vierge et un forgeron de la paix », un lieu où les dévotes viennent se montrer et se donner bonne conscience, un théâtre où deux nécessiteux soutirent habilement tout ce qu’ils peuvent. Pourtant ces allusions fréquentes à un au-delà indéterminé révèlent peu à peu une inquiétude chez ces paysans ou ces bourgeois matérialistes. L’agnostique Giono s’en sert pour passer progressivement au registre tragique. Que vaut une vie humaine ? Pourquoi cette angoisse de la mort ? Comment certains peuvent-ils dépasser leur peur viscérale de manquer ? Que penser de ces fous qui renoncent à la possession des biens matériels tangibles ? Le commun des hommes ne perçoit pas que l’existence peut être traversée par des forces spirituelles qui subliment des personnes singulières et les font échapper à l’esclavage de l’instinct de survie. Pour autant ces individus ne sont pas libres puisqu’ils ont choisi de se soumettre à une passion qui les obnubile. Seuls la qualité, le raffinement et la ténacité de cette ardeur les distinguent du troupeau de leurs semblables. Ainsi naissent, les héros, les saints ou les monstres, ceux qui ont emprunté la voie d’une existence rêvée pour tenter de vaincre les pesanteurs terrestres de la condition humaine.
Thérèse était une âme forte. Elle ne tirait pas sa force de la vertu : la raison ne lui servait de rien ; elle ne savait même pas ce que c’était ; clairvoyante, elle l’était, mais pour le rêve ; pas pour la réalité. Ce qui faisait la force de son âme, c’est qu’elle avait, une fois pour toutes, trouvé une marche à suivre. Séduite par une passion, elle avait fait des plans si larges qu’ils occupaient tout l’espace de la réalité ; elle pouvait se tenir dans ces plans quelle que soit la passion commandante ; et même sans passion du tout. La vérité ne comptait pas. Rien ne comptait que d’être la plus forte et de jouir de la libre pratique de la souveraineté. Être terre à terre était pour elle une aventure plus riche que l’aventure céleste pour d’autres. Elle se satisfaisait d’illusions comme un héros. Il n’y avait pas de défaite possible. C’est pourquoi elle avait le teint clair, les traits reposés, la chair glaciale mais joyeuse, le sommeil profond.
(p. 350)
Lorsque la narration revient à la réalité à la fin de la chronique, ce sont les mêmes appréciations qui sont reprises, Thérèse est « fraîche comme la rose ». Ressourcée dans son rêve, le temps de cette « nuit blanche », Thérèse est celle qui ne regrette rien, qui échappe aux destructions du temps.
Il faut ajouter que la disparition de Mme Numance contribue également à l’épopée. Elle entretient un parfum de mystère, d’inachevé qui sollicitent la curiosité du lecteur, le laissent insatisfait et l’éveillent à un au-delà du récit.
Qui sont les âmes fortes ?
Giono s’est inspiré d’un aphorisme de Vauvenargues qui définit l’âme forte comme « dominée par quelque passion altière et courageuse à laquelle toutes les autres, quoique vives, [sont] subordonnées. » Pour comprendre ce qu’elles sont, il faut se rappeler cette affirmation de Giono : « Je déteste suivre, et je n’ai pas d’estime pour ceux qui suivent ». Giono est un solitaire anticonformiste. Il est aussi un admirateur de la force de caractère des héros stendhaliens qui leur fait négliger tout ce qui n’est pas la poursuite de leur bonheur égotiste.
Deux couples opposés de manière symétrique
Giono s’attache particulièrement à individualiser quatre personnages dans l’ordre croissant : M. Numance, Mme Numance, Firmin et Thérèse. Ils forment en outre deux couples dont l’histoire singulière éclaire significativement le projet narratif.
Les Numance | Thérèse et Firmin |
| Des bourgeois distingués. | Des ruraux primaires. |
| Le couple est stérile. Il a décidé de vivre la chasteté. | Le couple a un enfant (lors de leur rencontre). |
| Thérèse mesure ses unions avec Firmin pour le faire plier à sa volonté. | |
| M. Numance est tout dévoué à sa femme. | Firmin veut dominer Thérèse. |
| Le couple vit en étroite communion. | Les conjoints s’opposent et se déchirent. |
| Le couple est idéaliste. | Le couple est matérialiste. |
| Le couple est oblatif et sacrificiel. | Le couple est captatif et victimaire. |
| Le couple est christique. | Le couple est démoniaque. |
Pour exister socialement les femmes ont besoin de leur mari. | |
Le personnage de M. Numance
Bernard Numance, dans la 1re version, est un notable dont la société châtillonnaise raffole. Bel homme, affable, « rond et sanguin », il « regard[e] tout le monde » à la différence de sa femme. Il est attiré par Thérèse à laquelle il propose souvent : « S’il te manque quelque chose, tu n’as qu’à le dire. Tu sais que je suis là ». Cet homme est « à cheval sur la perfection ». Quand la requête de l’huissier l’oblige à réduire son train de vie, sa fierté lui interdit de continuer à paraître en public sans jouer au billard, aussi se replie-t-il sur « l’hôpital », la salle de l’auberge où sont entreposés les rebuts. Là, pour continuer à satisfaire son plaisir raffiné, il remet en état le matériel afin de continuer ses parties désormais solitaires. Propriétaire de scieries, il essaie de rafler toutes les adjudications de coupe de bois. Les dettes de sa femme semblent avoir porté un coup au dynamisme de son entreprise par assèchement de sa trésorerie. Il semble surpris et abattu par les dépenses de son épouse.
Dans la seconde version, nous découvrons un autre personnage, un retraité « libéral », un « homme de haute taille, resté vert, mince » (p. 144). C’est un « vieillard » bien conservé qui défraie la chronique villageoise par sa générosité. En 1851, lors du coup d’État de Napoléon Bonaparte, il s’est distingué par son engagement républicain et a échappé de peu « à la déportation » grâce à l’entremise de sa femme. Le mari adore son épouse, « rien ne compte sauf elle » (p. 147).
Giono recourt souvent au regard pour caractériser ses personnages. Ainsi, Bernard présente des yeux délavés dans lesquels on se perd7, il a le regard de la dévotion, de celui qui s’est dissous dans la personnalité de Sylvie. Cette aliénation à la volonté de sa femme, ce dévouement à une passion amoureuse contre toute prudence ou logique fait de Bernard Numance une âme forte. Mais sa passivité, sa dépendance, son inscription dans le projet d’autrui le cantonnent dans un rôle secondaire. Il n’apparaît jamais comme un combattant de première ligne8.
Le personnage de Mme Numance
Dans la première version, c’est une jeune femme de trente ans, grande, maigre, aux « yeux de loup ». Elle a été élevée au couvent, elle porte des tenues qui tranchent sur l’uniformité utilitaire de la société châtillonnaise9. Elle se montre distante. Elle se signale par une dette de vingt mille francs dont l’origine est mystérieuse. D’ailleurs la présentation de cette dette par l’huissier de Valence surprend son mari. Au début de son séjour à Châtillon, Thérèse est rebutée par cette bourgeoise hautaine. Mais au fur et à mesure, elle est intriguée par l’originalité radicale de cette personnalité. Thérèse est attirée d’abord par le détachement insouciant que manifeste Mme Numance lors de la visite de l’huissier. Alors que tous prévoyaient son effondrement, elle se contente de rire. De même quand tout le bourg attendait qu’elle dissimule sa honte par une réclusion chez elle, Mme Numance poursuit ses promenades quotidiennes comme si de rien n’était. Sans ostentation, elle manifeste sa différence d’avec la société vulgaire et pragmatique de Châtillon en portant des tenues distinguées, en refusant la fatalité de la boue l’hiver et de la poussière l’été.
Dans la deuxième version, Giono lui donne le prénom de sa seconde fille, Sylvie, ce qui signe un personnage lumineux. C’est une femme âgée, aux « cheveux blancs », au « visage de poupée » (p. 145), qui a gardé la taille svelte de sa jeunesse si bien qu’elle est restée « agréable à regarder ». Elle se distingue par sa démarche, ses tenues recherchées comme ses jupes « amazone » dont toute la population rêve d’imiter la grâce. Comme son mari, c’est un ange de bonté. Elle a passé sa vie à payer les dettes des nécessiteux, à soigner les malades. « C’est le Napoléon du malheur » (p. 148). Ruinée une première fois par sa générosité, elle retrouve une fortune à la suite de l’achat inspiré d’un billet de loterie. Elle reprend donc ses activités charitables mais à Châtillon où le couple s’est retiré. Cette persévérance est un signe de la « vocation » des Numance qui manifestent un détachement évangélique au point d’ « être des saints » (p. 151). Giono d’ailleurs le relève avec humour par le commentaire de Firmin : « Cette façon de tout donner ça n’était pas catholique » (p. 153). Il est certain que la stérilité du couple s’est sublimée dans cette maternité spirituelle du don des biens10, puis du don total de soi11. Par le don de la maisonnette, Sylvie pense qu’ « elle t[ient] Thérèse de monsieur Numance. Comme un véritable enfant de lui et d’elle. » (p. 184)
Sylvie Numance est une sœur de Fabrice del Dongo, de la Sanseverina12 ou du Hussard sur le toit13. Elle aime contempler le monde de haut14, s’isoler, s’élever au dessus des mesquineries de ses concitoyens, elle cultive une forme de bonheur égotiste dans ses méditations solitaires, elle est soulevée comme eux par « une âme romantique » (p. 170). Elle est aussi une image du Christ qui se retire dans les hauts lieux peut-être pour prier, du moins pour se ressourcer. Mais elle est aussi capable de toutes les folies, comme ses parents stendhaliens ou gioniens, quand sa passion est menacée. Elle est prête à devenir meurtrière quand Firmin a brutalisé Thérèse ; elle a été complice de son mari quand il s’est agi de faire disparaître un militaire prussien. La douce féminité peut se muer en force brutale. Voilà une similitude avec Thérèse : ce sacrifice total à la passion est la signature des âmes fortes. Finalement Mme Numance n’est pas un être d’exception par sa générosité extraordinaire qu’elle partage avec son mari. Pour Giono, il y a plus grand que sa « sainteté », il voit d’abord sa force héroïque15, ce sacrifice même de sa vie vertueuse pour une passion maternelle vécue jusqu’à la folie.
La disparition finale du couple obéit sans doute à une logique narrative. Ces êtres qui ont choisi de tout donner en se laissant dépouiller ont une fonction salvatrice. Dans cet univers noir, ils restent lumineux. Là où sévissent les prédateurs, ils s’offrent en sacrifice. Leur acte de renoncement est parfaitement voulu. Il est accompli avec panache. À eux deux, les Numance représentent un symbole christique. M. Numance assume la descente au tombeau tandis que son épouse est enlevée aux yeux de tous comme dans une Ascension. Cette disparition de l’héroïne n’est pas la simple conséquence de la fin de son rôle dans le récit. Elle signifie qu’elle continue d’exister autrement, invitant chacun à chercher un pourquoi et un comment. Giono, par ce refus de clore une présence romanesque, crée une sourde inquiétude chez le lecteur. Comme dans le mystère chrétien, Sylvie Numance a soustrait son corps de chair pour laisser son esprit de force à l’œuvre dans une Pentecôte laïque16. Par sa disparition, elle engendre définitivement Thérèse. En effet cet enlèvement oblige Thérèse, dans une crise proche de la folie, à prendre ses responsabilités, à endosser l’héritage, à devenir la fille spirituelle de la mère sacrifiée, à rivaliser avec cette âme d’exception. Mais comme la place de la sainte est déjà prise, Thérèse ne peut plus se réaliser que dans le rôle du démon.
Le personnage de Firmin
Firmin n’est pas l’homme de devoir qu’il prétend. Avant de connaître Thérèse, il a eu plusieurs aventures. D’ailleurs les Compagnons lui ont donné le surnom de Joli cœur. Une participante à la veillée (p. 74) rapporte ses « zistonzestes ». Le personnage est sensuel et peu regardant.
Firmin a l’esprit pratique. Il se montre débrouillard pour trouver des solutions aux difficultés inopinées. Il est capable de combiner dans sa tête des stratégies compliquées : par exemple, lors de l’enlèvement de Thérèse, il a su concevoir des fausses pistes pour égarer les recherches des poursuivants, il s’est documenté sur leur lieu d’accueil, sur la manière d’exploiter son appartenance aux Compagnons du Tour de France. Mais il est secret, ne dévoile que ce qui est nécessaire, n’associe nullement Thérèse à ses entreprises, la met devant le fait accompli. En tout cas, très vite, il pousse la jeune femme à se méfier. Ce qui anime Firmin, c’est l’avidité et la peur du « trimard », c’est-à-dire l’errance des misérables. Le moteur de Firmin est de parvenir à l’aisance pour obtenir une reconnaissance sociale. « Ce qu’il veut c’est : avoir.» (p. 159). Un exemple significatif est celui du baptême de son fils Charles. Firmin est désespéré que la cérémonie se soit déroulée dans l’intimité, qu’elle n’ait pu être un témoignage public de sa bonne fortune. Heureusement M. Numance lui fait cadeau de plusieurs cigares dont il prend soin d’offrir un exemplaire pour assurer la publicité de sa réussite.
À Clostre, sur ses quarante-cinq ans, il se signale par sa petite taille. « Une veste d’homme servirait de soutane à Firmin ». Ses bras sont toujours musculeux. Il veut « qu’on lui donne le bon Dieu sans confession » (p. 133). Il aime à paraître ridicule pour mieux endormir ses adversaires. Il sait amener immanquablement les gens là où il veut. Il choisit soigneusement ses victimes qu’il suce comme une « tique ». (p. 135)
Si Firmin a une intelligence pratique développée, il ne se montre pas fin psychologue. Il se révèle incapable de comprendre Thérèse, qu’il croit « bête » (p. 198), ou le couple Numance. Il ment, dissimule, s’attribue des faits d’armes imaginaires. Il a peur de se faire rouler, ce qui arrive avec Réveillard, l’usurier plus matois que lui. Perpétuellement inquiet, habité par le doute, il ne peut aller au bout de ses manigances. Quand il a obtenu ce qu’il voulait des Numance, il se rend compte qu’il s’est vendu bêtement, il se met « dans une colère froide très cruelle. S’il avait eu le moindre courage il aurait été capable à cet instant-là de tuer. » (p. 257) Il en fait souvent trop ce qui alerte son entourage. En raison des forces contraires qui l’habitent et s’annihilent, de son caractère trop prévisible, de son manque de finesse et de détermination, Firmin n’est pas une âme forte. Ne pouvant parvenir à se faire craindre, il finit par être dédaigné. Thérèse ajoute à ce mépris une haine sadique.
Firmin exerce le métier de maréchal-ferrant, activité qui exige de la part de celui qui l’exerce une grande force musculaire pour battre le fer sur l’enclume. Or Firmin va être dominé physiquement par Thérèse lors de leur séjour à Clostre. Thérèse n’est pas seulement une âme forte, c’est aussi une forte femme qui cache bien son jeu. D’ailleurs pour décrire sa beauté fascinante, un des témoins utilise justement l’image du marteau : « Elle était belle comme ce marteau, vois-tu ! » Et il me montrait le marteau dont il faisait usage depuis vingt ans […], un marteau dont le manche était d’un bois doux comme du satin depuis le temps qu’il le maniait, dont le fer si souvent frappé étincelait comme de l’or blanc. Et avec ça elle était tout le temps affable et gentille. » (p. 340)
Le personnage de Rampal dit Cartouche
Bien entendu, cet entrepreneur n’est pas non plus une âme forte car il est trop prêt à capituler sur l’essentiel pour sauvegarder son emprise sur son territoire. Cet homme courageux a bâti une principauté dans les travaux publics. Son sens pratique, sa connaissance des métiers de base, son autorité et surtout sa roublardise en affaires l’ont conduit à la tête du chantier de construction de la voie ferrée Grenoble-Gap. C’est pourtant ce redoutable négociateur secrètement épuisé par l’alcool que Thérèse va manipuler et finalement dominer. Le personnage est là pour mettre en valeur le génie machiavélique de Thérèse.
Le personnage de Thérèse
Au début du récit, Thérèse intervient peu, elle écoute seulement au point de paraître dormir. C’est une vieille femme qui en impose à son entourage par son silence et son détachement. Elle ne semble pas concernée par le déballage obscène des autres visiteuses. Cette solitaire taciturne se met soudain à parler pour occuper le temps de cette longue nuit d’hiver. Elle raconte son histoire personnelle, comment elle a été amenée à changer en dépit de ses convictions de jeunesse.
Au début, c’est une âme naïve. « Je n’étais qu’une petite fille à vingt-deux ans […] » (p. 68). Si l’on en croit une des commères, elle n’était pas alors une oie blanche. « Si vous avez un ramoneur, ou n’importe quoi qui porte un pantalon, tenez-le loin, sans quoi c’est vite fait » (p. 75). Thérèse était aussi une noceuse sensuelle (p. 72), ce à quoi l’intéressée acquiesce à demi-mots. Son ingénuité s’exprime en particulier dans son goût prononcé pour les papiers peints voyants (pp. 73, 83). De même elle paraît dans ses peurs, au début de son service à l’auberge : peur du noir, de la solitude, des attouchements masculins. C’est aussi une sentimentale si bien qu’elle se met à pleurer à la lecture de Jocelyn de Lamartine (p. 282). Apparemment, dans le premier récit de la relation entre Thérèse et Mme Numance, la jeune femme s’est prise à aimer passionnément son « idole » (p. 155), la cause : « Les traits, l’allure, la démarche, le costume, le chapeau à plumes de madame Numance ». Alors qu’elle est proche de sa délivrance, Thérèse, assise sur la promenade, guette « celle-là » et lui prête des aventures invraisemblables à la manière d’Emma Bovary. Elle opère de même en peuplant le pavillon des histoires imaginaires de son héroïne comme dans « La Veillée des Chaumières ». Plus tard elle rêve d’elle la nuit. Au petit matin, elle délaisse ses obligations maternelles pour vivre dans le sillage parfumé de sa maîtresse. Cette « adoration » (p. 155) l’a conduite déjà à envisager l’hypothèse d’un meurtre, même s’il s’agit de son bienfaiteur : « S’il avait fallu tuer monsieur Numance […], elle n’aurait peut-être pas réfléchi longtemps » (p. 156). La spontanéité de Thérèse laisse transparaître un amour exclusif bien proche de la jalousie passionnelle (p. 198). Thérèse se définit alors par ses œillades amoureuses et implorantes. « Elle était une bonne grosse niaise épanouie. » (p. 165) C’est Sylvie qui lui révèle la puissance de séduction de son doux regard dont la jeune femme va faire l’arme de sa domination.
Mais très vite, elle apparaît une âme forte par l’acuité de son jugement, son mépris des convenances, sa volonté inflexible qui la conduit sur les chemins de la monomanie. L’auberge est un microcosme où elle apprend très vite à discerner les personnalités derrière les apparences. Ayant porté un regard sans concession sur la comédie sociale de son temps et de son milieu, elle a vite compris qu’une femme ne pouvait exister seule. Elle choisit d’affronter la réprobation du groupe par sa fuite. Son désir d’accomplissement personnel la fait échapper à l’autorité parentale comme à celle de son mari. Sa force est d’avoir compris que son émancipation devait rester secrète, qu’elle devait tromper tout le monde pour réussir. Thérèse affirme d’ailleurs (p. 120) : « Je suis plus futée que ce qu’on croit ». Cette affirmation qui pourrait paraître anodine est en fait un pivot de la diégèse, le déclic qui permet à la commère de corriger le témoignage trop favorable de la vieille femme. Dans son dernier récit, elle raconte comment elle a pris le pouvoir sur son mari en le dressant, selon la théorie pavlovienne du réflexe conditionné, par la cuisine et l’exercice de la sexualité. Firmin en devient soumis, souple et apparemment futé. Sous l’aiguillon thérésien, Firmin devient un instrument redoutable. Pendant ce temps-là, la jeune femme donne le change en se faisant « passer non seulement pour bête (ce qui n’est déjà pas mal) mais pour bête et bonne, ce qui est vraiment mieux. » (p. 301) Elle réussit son examen de passage avec la patronne de l’auberge, la méfiance incarnée. Elle y apprend « à haïr avec le sourire » et « à faire exactement le contraire de ce que [son] cœur [lui] commandait de faire. » (p. 302) Cette ascèse de l’affectivité par la « cervelle » la conduit à devenir « parfaite », à tromper tout le monde en faisant croire, sommet de son art, à une spontanéité qui « ne trompe pas. » (p. 302) Dans le fond, Thérèse est « froide », elle méprise, elle hait le genre humain. Pour sa conquête du monde, elle va mimer l’amour. « Ce mépris [lui] donn[e] beaucoup de plaisir. » Thérèse vient d’inventer la domination sadique.
Thérèse est donc une forme féminine de Tartuffe, mais une forme infiniment plus dangereuse dans sa poursuite de l’asservissement d’autrui en lieu et place du parasitisme, de la sensualité ou de la captation des biens. Thérèse vampirise ceux qu’elle a décidé d’approcher. C’est une araignée monstrueuse qui tisse patiemment sa toile. La force du récit repose en effet sur la lente révélation de la personnalité profonde de l’héroïne au lieu et au temps qu’elle a choisis. Rien ne lui est arraché. Près d’un demi-siècle après les faits, Thérèse décide de dévoiler, dans une confession laïque en forme de testament, une vérité que nul n’a approchée jusqu’alors.
Pourquoi lors de ce soir d’hiver en présence d’un mort ? Pour que l’œuvre de sa vie ne soit pas ignorée, mais alors Thérèse se soumettrait aux conventions du monde ordinaire ? Pour corriger cette vision de Berthe édulcorée et par trop conventionnelle ? Pour le plaisir d’ensorceler son auditoire ? Pour marquer une dernière fois son pouvoir de bête de proie ? Pour affirmer à la volaille cancanière et fascinée qu’elle reste le furet ? En tout cas Giono distille le secret avec délectation, il met son art de conteur au service de sa créature. Giono se dissimule derrière une coquetterie d’auteur quand il nous confie dans ses notes sur les chroniques : « Ce qu’elle est, personne ne le sait, pas même moi. Thérèse, je la vois du dehors, pas moyen de pénétrer dedans. Thérèse, c’est le personnage que je ne connais pas ». C’est quand même lui qui conduit de manière magistrale son projet de débusquer le mal.
Le mensonge, la dissimulation pour protéger la construction du moi chez le surhomme (ici des femmes d’exception) ne sont plus des vices abominables. L’intelligence de la conception, l’hypocrisie, la persévérance, le sacrifice pour un projet deviennent vertus pour Giono. Il faut entendre le mot dans son sens étymologique de force. C’est cette vigueur du caractère qui sublime Thérèse et la fait échapper à un destin vulgaire. Giono éprouve une forme d’admiration pour ce personnage hors du commun, il est fasciné par cette femme nietzschéenne amorale, par l’intelligence et la force du mal, incarnations de la « volonté de puissance » qui entend échapper à la morale des esclaves pour s’épanouir dans celle des maîtres. De même, dans la lignée de Stendhal, il réserve ses lazzi au niveau « bas » et étouffant de la société dauphinoise ; il admire sans réserve la virtù, l’énergie créatrice et passionnée qui constitue l’essence du héros romanesque. Ainsi la plébéienne Thérèse rejoint d’une certaine manière l’aristocratique Angelo.
Enfin Thérèse est marquée au sceau de Machiavel. Depuis 1948, Giono relit attentivement l’auteur de la Renaissance florentine. Il va d’ailleurs produire en 1952 une préface pour l’édition du penseur politique dans la Pléiade, puis un essai en 1986, De Homère à Machiavel, chez Gallimard. La réflexion politique de Giono s’est infléchie vers un attentisme aux conséquences manifestes dans sa création littéraire. Rebuté par les excès du stalinisme, Giono s’est éloigné du communisme. Il a renoncé à la lutte des classes et à toute révolte active contre un ordre social qui a coupé l’homme de ses racines naturelles. Ces forces inemployées vont se réinvestir dans le jeu des passions sociales. Giono, blasé, considère le théâtre social au travers de la grille d’analyse machiavélique : un réalisme amoral, une justification par la finalité et surtout un scepticisme pessimiste. Il écrira par exemple dans le Voyage en Italie de 1953 : « On assouvit une passion égoïste dans les combats pour la liberté ». Thérèse est bien cette héroïne qui sacrifie allègrement tout et tous sur l’autel de sa propre liberté. Les forces du désir mises en œuvre dans le réel permettaient à l’univers de subsister, d’enfanter à l’extérieur des formes nouvelles. Désormais privées d’exutoire, elles se sont muées en passions narcissiques qui s’exercent dans l’espace fermé de quelques relations interpersonnelles. Elles ne peuvent plus que détruire par leur violence, leur désespoir et leur pente vers l’anéantissement. Thérèse, sans le savoir, a mis le réalisme politique de Machiavel au service de ces forces devenues centripètes. Giono constate non sans effroi et amertume que la nature humaine anéantit ses richesses dans cet effondrement égoïste. Une indication certaine nous est donnée à ce sujet : Thérèse n’a pas été véritablement mère. Ses enfants ne l’ont pas préoccupée. Sa relation avec ses petits-enfants est inexistante. Elle n’a pas l’air d’en souffrir. Ce dialogue du début (p. 53) est bien révélateur : « Vous dites que vous n’aimez personne et que vous n’avez que vous.
— Eh bien ! où vois-tu du malheur dans tout ça ?
— Si je n’aimais personne et si j’étais toute seule, moi, je serai malheureuse.
— Tu te prépares une drôle de vieillesse. Il vaudrait mieux mourir maintenant dans ce cas. »
Thérèse est devenue indifférente à tout ce qui n’est pas elle.
Naissance d’un monstre
Thérèse devient une héroïne cornélienne dévoyée, « maître[sse d’elle-même] comme de l’univers ». Elle apparaît comme une personnalité dédoublée : sujet agissant et sujet qui se regarde perpétuellement agir, soldat et juge. Il y a en elle un maître intérieur qui brise sa nature sensuelle et bonasse pour faire émerger peu à peu un être cérébral bien dissimulé derrière ses rondeurs avenantes et son regard désarmant. Thérèse devient ainsi peu à peu une illusion séductrice, une création monstrueuse de la nature, une magnifique fleur carnivore. Ce n’est pas l’argent qui la meut, ni l’orgueil, mais tromper son monde. « Tromper la haine, c’était de l’eau de rose. Tromper l’avarice, c’était de l’eau de boudin. Tromper l’amour, d’un seul coup je trompais tout. C’était ce qu’il y avait de mieux. […] Je m’aperçus qu’il y avait des quantités de sortes d’amour. Le maternel me parut bien… » (p. 307) Le destin de Mme Numance est scellé, le démon a décidé de subvertir l’amour radieux du don total. « L’argent, là, ne serait pas défendu. Il serait au contraire offert comme l’hostie à la messe. Tout le jeu était, à la communion, d’avancer un joli petit museau de furet et de croquer à belles dents. » (p. 318) Tous les récits précédents n’ont donc été que simulation. L’intérêt de la chronique réside dans l’affrontement de ces deux âmes avec la victoire inéluctable de la manipulatrice démoniaque car Mme Numance est trompée et vaincue17.
Thérèse s’est construite par une ascèse vicieuse, elle a fait naître en elle une nature carnassière enfouie, celle du « furet devant le clapier. » Thérèse se réjouit de sa nuisance potentielle. « J’étais heureuse d’être un piège, d’avoir des dents capables de saigner ; et d’entendre couiner les lapins sans méfiance autour de moi. » (p. 316) Il y a donc le mal ordinaire, innocent pourrait-on dire à force de banalité, et le mal extraordinaire qui permet d’échapper à l’ennui, de se différencier, de construire son être ontologique. Thérèse sait lire dans les âmes. Les pages qui concernent les longues rencontres silencieuses sur la promenade alors que la future mère étale sa difformité sont très éclairantes. Celle qui feint le sommeil peut, par son regard intérieur, deviner toute la palette des sentiments qui agitent la promeneuse dévorée d’amour vrai. Elle suit leur maturation et en joue subtilement pour asservir sa victime à son projet. À Clostre, elle « connaissait Firmin comme sa poche. […] elle le voyait comme dans une lunette d’approche. » (p. 357)
Il faut remarquer que la stratégie thérésienne de l’enfouissement a ses limites car à un moment donné pour que la jouissance soit parfaite, il faut le dévoilement total : « Le monde est quand même bien fait. Les gens que tu vises ne tiennent à rien, sauf à aimer ; et ils te tombent dans les pattes. L’amour, c’est tout inquiétude. C’est du sang le plus pur qui se refait constamment. Tu vas t’en fourrer jusque-là. D’abord et d’une. Ensuite, puisqu’ils donnent volontiers tout ce qu’ils ont, c’est qu’ils aiment combler. Alors, à la fin, je me montre nue et crue. Et ils voient que rien ne peut me combler. Plus on en met, plus je suis vide. C’est bien leur dire : vous n’êtes rien. Vous avez cru être quelque chose : vous êtes de la pure perte. Ça, c’est un coup de théâtre. L’attendre me fera plaisir tout du long. Le rendre le plus étonnant possible me ravira à chaque instant. Puis il éclate et, brusquement, je suis qui je suis ! » (p. 318) Il y a dans ce ricanement à l’égard de l’amour trompé des accents lucifériens. Mais Thérèse n’avait pas imaginé que la proie lui échapperait à la fin.
À défaut de Sylvie, Thérèse va se rabattre sur Firmin qu’elle veut punir de l’avoir privée de sa suprême jouissance. « C’était uniquement de Firmin qu’elle tirait son plaisir. » (p. 356) Elle s’acharne à le détruire physiquement et psychologiquement avec l’apparence d’une innocente tendresse. Tout au long des seize ans passés à Clostre, Thérèse a fait « durer le plaisir. C’était une gourmande. » (p. 357) Au moment où elle décide de le faire mourir, elle se trouve « dans un état de volupté qu’elle n’avait encore jamais connu. » (p. 365) Le narrateur explicite cette jouissance : « Il faut, se dit-elle, qu’il se voie mourir. Ça va être un peu plus difficile. Mais, quelle différence ! »
Dans un roman bernanosien on dirait de Thérèse qu’elle est possédée. Une rapide comparaison avec le prologue de Sous le Soleil de Satan nous livre un même constat et une même trame.
Les hommes sont des illusions d’hommes : ils sont falots, lâches. Ils ont abdiqué leur révolte déclarée contre l’ordre établi (qu’ils confondent semble-t-il avec Dieu) dans un gris conformisme auquel n’échappe même pas leur désir impur. Ce sont des tyranneaux domestiques, souvent abrutis par l’alcool, qui méprisent les femmes et fuient leurs responsabilités. Tous sont poussés par l’orgueil originel. En creux, leur nature profonde est d’appartenir au troupeau des bien-pensants qui cachent leurs fredaines sous le masque de la respectabilité. Les auteurs se sentent bien plus proches des femmes libres qui, dans leur révolte, essaient d’exister. Elles ne supportent pas l’autoritarisme masculin. Elles sont prêtes à aller jusqu’au meurtre. Certaines cultivent le mensonge, la dissimulation. Elles mettent ensuite une force héroïque à faire aboutir leur projet de vie. Elles sont secrètement orgueilleuses de leur différence radicale. Les deux écrivains stigmatisent le matérialisme. Si Bernanos s’avance plus avant dans la voie du surnaturel, Giono ne dédaigne pas de faire quelques pas aux frontières. Par exemple Bernanos écrivait « l’enfer aussi a ses cloîtres » car Satan a besoin d’âmes dévouées. Giono fait culminer l’œuvre de Thérèse à Clostre, une autre forme de cloître, le lieu isolé, replié sur lui-même où nul ne peut échapper au regard d’autrui. À l’extérieur c’est un paradis à la manière du « paradou » de la Faute de l’abbé Mouret ; à l’intérieur, c’est un enfer. Firmin rêve d’assassiner sa femme. Thérèse détruit son mari à petit feu pendant seize ans tout en paraissant une épouse attentionnée. Thérèse lit dans les âmes comme Donissan. Elle a le rire jouisseur de Celui qui a réussi à tromper ses proies, « ce rire cruel, cette manière de profaner ce qu’il tue, voilà Satan vainqueur ! » Nos deux auteurs se rejoignent sur le constat que l’enfer est glacial. Tous deux dénoncent l’avènement de la civilisation moderne, ennemie de la force de l’âme.
Là s’arrêtent les ressemblances. Si Bernanos veut réveiller les âmes assoupies par « une complainte horrible du péché », Giono se contente de rejeter cette société gangrenée, de mépriser toutes les faiblesses, les lâchetés et les compromissions qu’elle encense. Il est surtout conduit à admirer des êtres d’exception « Par-delà le Bien et le Mal ». Le monde de Giono ne connaît pas le péché parce qu’il ignore la transcendance. Le lecteur ne peut qu’éprouver un malaise devant cet amoralisme. L’âme qui n’a plus ni maître ni Dieu paraît forte au prix d’une innocente et tranquille cruauté. Pour Giono, le Mal absolu, pour autant qu’il existe à ses yeux, réside dans le risque de l’ennui, il faut comprendre par là le vertige de la dissolution, de l’insignifiance, de l’absurdité d’une l’existence limitée à son horizon terrestre. Il convient donc d’échapper quoi qu’il en coûte, à cette forme pernicieuse du non-être par le divertissement. Il se trouve que Thérèse a choisi la voie du mal. Ce qui la divertit, c’est la tromperie, la souffrance d’autrui, son agonie. Elle se réalise dans le rôle du bourreau. En voulant être la maîtresse du jeu, elle bannit toute forme de compassion. C’est pourquoi Thérèse est surtout une âme féroce et une âme seule.
Notes
1 Cette étude a utilisé l’édition Folio no 249 chez Gallimard. ↑
2 P. 133 « Ce Firmin-là, il faut bien nous souvenir qu’il a quarante-cinq ans à cette époque ». ↑
3 Giono utilise la majuscule initiale qui désigne alors le parfum créé par Guerlain en 1840. La grande bourgeoise utilise cette essence de luxe, signe de raffinement et de distinction. ↑
4 Aux pages 137 à 139, Giono brosse un portrait acide de la charité bourgeoise. Les dévotes se réfèrent à des principes peu chrétiens pour distribuer leurs subsides : elles expriment leur défiance à l’égard d’une éventuelle paresse en attendant « de la bonne volonté » de la part des pauvres. Ces derniers doivent en outre se montrer présentables en n’étant pas « au dernier degré de la misère ». ↑
5 Giono est par son père d’origine piémontaise. ↑
6 Le lecteur ne saura jamais si ce gain a existé ou s’il est le fruit de l’imagination de la conteuse. La commère affirme « J’ai blagué » puis reprend ce verbe encore deux fois (p. 151) sans qu’on puisse attribuer le commentaire à un événement précis. ↑
7 Il partage cette caractéristique avec sa femme dont « [l]es yeux étaient si clairs qu’ils semblaient des trous. » (p. 194) ↑
8 « Vivre pour lui c’était donner parce que, pour sa femme, donner c’était vivre. » (p. 181) Giono adapte ou retourne la proposition mesurée de l’Avare (acte III, scène 1) : « il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger ». ↑
9 La jeune Madame Numance est en partie inspirée de l’amour caché de Giono, Blanche Meyer. Elle partage avec elle sa blondeur, sa sveltesse, son apparence altière. Blanche Meyer possédait une grâce exceptionnelle, une liberté d’esprit, des toilettes qui dérangeaient Manosque dont elle n’a jamais accepté le conservatisme étouffant. Dans la seconde version Sylvie vieillie a gardé son acrimonie envers la « ménagerie » des « belles dames » contre laquelle on « n’a à choisir qu’entre la cravache et le pistolet. » (p. 188) ↑
10 Les Numance donnent non seulement le superflu mais encore le nécessaire. Ils n’hésitent pas à se dépouiller jusqu’à la pauvreté, au détachement total synonyme d’anéantissement. ↑
11 Giono renvoie implicitement à la rencontre entre Jésus et l’homme riche dans l’Évangile de Marc 10, 21 :
« Alors Jésus le fixa du regard et l’aima ; il lui dit : "Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, tu auras ainsi un trésor dans le ciel ; puis reviens et suis-moi." » Bible des peuples. C’est ainsi qu’il faut comprendre les réflexions de Sylvie après s’être laissé déposséder : « Quel dommage que l’argent ne compte pas ! Je n’ai rien à lui sacrifier à elle [Thérèse] ; sinon mon désir même. » (p. 258) ↑
12 Personnages de la Chartreuse de Parme de Stendhal. Mme Numance partage aussi avec un autre héros stendhalien, Julien Sorel, la fascination pour l’aigle (p. 177), symbole napoléonien. ↑
13 Roman de Giono publié en en novembre 1951. Il fait partie du « Cycle du Hussard » ou d’Angelo. ↑
14 (p. 262) ↑
15 « Tu sais combien je peux être féroce dans cette façon de combattre [le plaisir de donner]. J’ai vraiment là, mon chéri, un orgueil indomptable […] » dit-elle à son mari après avoir joui de voir ses adversaires décontenancés. (p. 260) ↑
16 Nous prenons un risque en proposant cette interprétation. En effet Giono écrit malicieusement à la page 336 que « la diaconesse […] donna, du départ de madame Numance, une version verbeuse, évangélique et définitive ». ↑
17 Il reste cependant une incertitude sur son aveuglement car il semble que le couple ait perçu une part de la manœuvre au moins chez Firmin, mais peut-être aussi chez Thérèse, auquel cas son sacrifice en serait encore plus remarquable. ↑