« L’Hôte » d’Albert Camus
dans le recueil L’Exil et le Royaume (1957)
Un douloureux échec
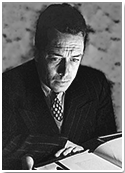 Albert Camus continue à nourrir la réflexion de nos contemporains. David Oelhoffen vient de produire un film généreux, Loin des hommes, dont le point de départ est « L’Hôte », une des nouvelles du recueil L’Exil et le Royaume. Film et texte résonnent étrangement en cette période troublée où nous assistons au « choc des civilisations »1. Camus, meurtri par le conflit qui vient de naître sur son sol natal, nous livre un apologue sur l’impossible réconciliation entre Orient et Occident malgré la présence d’hommes de bonne volonté.
Albert Camus continue à nourrir la réflexion de nos contemporains. David Oelhoffen vient de produire un film généreux, Loin des hommes, dont le point de départ est « L’Hôte », une des nouvelles du recueil L’Exil et le Royaume. Film et texte résonnent étrangement en cette période troublée où nous assistons au « choc des civilisations »1. Camus, meurtri par le conflit qui vient de naître sur son sol natal, nous livre un apologue sur l’impossible réconciliation entre Orient et Occident malgré la présence d’hommes de bonne volonté.
Rappelons le sujet de cette nouvelle. Sur le « haut plateau » désolé « au pied des masses violettes du contrefort montagneux où s’ouvr[e] la porte du désert », alors que la rébellion vient de se déclencher, Daru2, un instituteur français, se voit confier malgré lui un meurtrier indigène. Le gendarme Balducci lui demande de convoyer le prisonnier jusqu’à la première ville afin de le remettre aux autorités. Le récit va nous rapporter le face à face entre ces trois hommes et les événements de la nuit suivante.
Le titre est ambigu à souhait. Qui est l’hôte ? Le prisonnier, celui qui est imposé ? L’instituteur, celui qui accueille ? La vertu qui est sous-tendue est celle de l’hospitalité très prisée de l’islam3. Camus se sert donc de cette pratique coutumière pour évoquer l’humanisme éclairé auquel il croit. En effet l’accueil de celui qui passe, a fortiori de celui qui est imposé, ne va pas de soi car l’inconnu est potentiellement menaçant. L’hospitalité est d’abord l’affrontement soudain entre deux mondes différents avant de pouvoir muter en une rencontre apaisée et une ouverture sur l’autre. Daru, le porteur implicite de la morale laïque républicaine, va donc devoir apprendre à être dérangé, à apprivoiser sa peur et sa colère, à exercer concrètement ses principes idéalistes, à engager une part de lui-même dans une relation risquée.
Les six nouvelles de L’Exil et le Royaume appartiennent au cycle de la solitude. Elles mettent en scène des personnages dépossédés qui cherchent consciemment ou non à retrouver le chemin de l’acceptation de soi, de l’autre, de l’empathie nourricière avec le monde4. Au moment où commence le récit, Daru est un homme seul. Les récentes chutes de neige hivernales l’ont privé de la compagnie de ses élèves issus des villages dispersés sur le haut plateau aride. Le récit se présente comme une tragédie qui respecterait la règle des trois unités. Unité de temps : l’action se déroule en moins d’une journée. Unité de lieu : une école perdue sur les hauts plateaux désertiques. Unité d’action : l’affrontement entre deux modes de pensée, deux conceptions de la vie. La fatalité et l’absurdité mènent le bal.
Le décor est primordial. Pour évoquer cette solitude, Camus a choisi un territoire aride, inhospitalier : un haut plateau5 aux portes du désert, une étendue pierreuse calcinée par le soleil. L’habitant est à l’image des lieux et même pire : « Le pays était ainsi, cruel à vivre, même sans les hommes, qui, pourtant, n’arrangeaient rien. » Ce monde minéral, ce soleil omniprésent (rappelons-nous L’Étranger) sont propices au meurtre. Terre berbère sauvage jamais citée, mais dont le lecteur comprend qu’elle est la bien nommée en raison de son étymologie. L’école qui va accueillir les protagonistes est située en hauteur à flanc de colline. À la différence des villages disséminés sur le plateau, elle est visible de loin, elle ne se terre pas. Malgré son dénuement, elle apparaît comme la demeure d’un « seigneur, avec ses murs crépis, son divan étroit, ses étagères de bois blanc, son puits, et son ravitaillement hebdomadaire en eau et en nourriture. » Elle est à l’évidence un symbole civilisateur que Camus traite avec humour. Dans la salle de classe, « sur le tableau noir les quatre fleuves de France, dessinés avec quatre craies de couleurs différentes, coulaient vers leur estuaire depuis trois jours. » Au pays de la soif, la civilisation annonce des réalités impensables pour les petits écoliers…
Dans ce lieu encore plus isolé par les récentes chutes de neige, trois hommes vont s’affronter brièvement. Chacun a une fonction dramatique et symbolique.
Par ordre d’intérêt croissant nous avons d’abord le « vieux gendarme » Balducci. C’est le représentant du pouvoir colonial. Son physique qui révèle « un air attentif et appliqué » annonce le militaire ne badinant pas avec la consigne. Cependant sa rigueur ne l’empêche pas d’avoir bon cœur. Il a honte de tirer derrière lui un prisonnier exténué. En outre il s’est pris d’affection pour Daru en qui il retrouve son fils sans doute mort au cours du second conflit mondial. Il conseille l’instituteur comme un père6 et le tance gentiment de « fêlé » lorsque le « fils » refuse d’obéir. La rébellion qui couve l’a rendu méfiant. Désormais il se considère en guerre. Il a donc choisi son camp. Aussi ne peut-il comprendre que Daru trahisse en refusant de se solidariser avec ceux de sa race. Et même le brave homme est blessé dans son honneur de soldat et son affection de père : « Ce n’est pas la peine d’être poli. Tu m’as fait un affront », oppose-t-il à Daru qui veut le raccompagner. Sur le pas de la porte, il lance un « Adieu, fils » qui peut signifier la fin d’une relation confiante mais surtout apparaît prémonitoire.
Ensuite vient le prisonnier, « l’Arabe ». Si les Français portent un patronyme, le prévenu reste un anonyme. Ce personnage est un être fruste, pure émanation de la terre qui le porte. Il est l’Africain ambigu, à la fois apeuré, écrasé, sauvage et rebelle. Quelques traits suffisent à le caractériser : « ses énormes lèvres, pleines, lisses, presque négroïdes », le « nez […] droit, les yeux sombres, pleins de fièvre », « un front buté ». Tout au long du récit, il se situe dans une position inférieure à celle des Européens : d’abord piéton derrière le cheval du gendarme, ensuite accroupi, puis allongé à même le sol. Cependant il garde sa noblesse. Il ne parle pas la langue de ses maîtres et c’est par le regard qu’il communique de prime abord : « tout le visage avait un air à la fois inquiet et rebelle qui frappa Daru quand l’Arabe, tournant son visage vers lui, le regarda droit dans les yeux. » L’instituteur, qui découvre sans doute en lui une image de ses propres refus, va essayer, malgré son horreur, de le considérer comme un homme, un égal. Il va essayer de l’éveiller. En effet l’indigène a égorgé un cousin pour « des affaires de famille » apparemment futiles, une dette en grain, mais qui prennent toute leur importance en période de disette. La sauvagerie du geste d’ailleurs importe plus que le mobile : « Enfin, bref, il a tué le cousin d’un coup de serpe. Tu sais, comme au mouton, zic !… » Camus en fait surtout le symbole de la victime du fatalisme musulman, du mektoub7. En effet celui qui a l’air rebelle, celui qui au début est l’homme privé de liberté reste le prisonnier qui refuse de s’échapper, de prendre en charge sa vie. Il a du mal à comprendre l’émancipation que lui propose l’instituteur. Finalement quand il pourrait exposer un début d’explication son interlocuteur refuse de l’écouter. Drame de l’incommunicabilité, l’Arabe et Daru restent prisonniers de leur culture respective. Tout au plus leurs timides efforts de rapprochement n’ont pu dépasser la complicité animale de ceux qui partagent un espace vital rapproché, et encore… « Dans la chambre où, depuis un an, [Daru] dormait seul, [la] présence [de l’Arabe] le gênait [surtout] parce qu’elle lui imposait une sorte de fraternité qu’il refusait dans les circonstances présentes et qu’il connaissait bien : les hommes, qui partagent les mêmes chambres, soldats ou prisonniers, contractent un lien étrange comme si, leurs armures quittées avec les vêtements, ils se rejoignaient chaque soir, par-dessus leurs différences, dans la vieille communauté du songe et de la fatigue. Mais Daru se secouait, il n’aimait pas ces bêtises, il fallait dormir. » Ce qu’ils partagent n’est rien d’autre qu’une étrange soumission à « ces terres ingrates, habitées seulement par des pierres. » « Dans ce désert, personne, ni lui ni son hôte n’étaient rien. Et pourtant, hors de ce désert, ni l’un ni l’autre, Daru le savait, n’auraient pu vivre vraiment. »
Cette fascination animale de l’être pour le néant extérieur du désert n’est pas celle des mystiques du XIXe siècle, Foucauld ou Psichari… Pas plus que celle des anachorètes. Et pourtant Daru, l’instituteur, le troisième et plus important protagoniste, se voit « presque en moine dans cette école perdue », mais en moine laïque. Il affronte le silence et la solitude de l’ermite. Il est un point d’ancrage comme ses lointains modèles médiévaux : pourvoyeur d’aide aux démunis, dispensateur de savoir et d’humanité. Camus partage avec Pagnol cette discrète glorification de l’école républicaine8, une des vertus de la colonisation. Daru, comme Camus, déteste la guerre et toute forme de violence attentatoire. Il ne peut supporter de voir un homme entravé comme un animal. À l’évocation du meurtre rituel commis par l’Arabe « une colère subite vint à Daru contre cet homme, contre tous les hommes et leur sale méchanceté, leurs haines inlassables, leur folie du sang. » Ce rejet de la barbarie s’accompagne d’un véritable sens de l’honneur fait de courage et de foi en la dignité que mérite tout homme malgré ses crimes : « Écoute, Balducci, dit Daru soudainement, tout ça me dégoûte, et ton gars le premier. Mais je ne le livrerai pas. Me battre, oui, s’il le faut. Mais pas ça. » Daru voudrait opposer à la règle administrative la valeur de la parole donnée. La civilisation n’est pas pour lui une affaire de fonctionnaire. Cependant il va abdiquer. La « petite bouteille carrée d’encre violette, le porte-plume de bois rouge avec la plume sergent-major qui lui servait à tracer les modèles d’écriture » vont servir à signer le bon de remise et, par là, être pervertis. L’innocence de l’enseignement s’est compromise avec la mesquinerie juridique du colonisateur. En définitive, Daru échoue dans sa modeste tentative de changer le cours des choses. Le prisonnier, obstinément, continue de choisir la route de la prison et de la probable exécution qui s’ensuivra. Camus nous livre une leçon de pessimisme foncier.
Daru est, dans cette nouvelle, un résumé de l’itinéraire intellectuel de Camus : en quelques heures il va passer de l’absurde à la révolte pour finir dans la solitude. Il appartient à deux mondes antinomiques entre lesquels il lui est impossible de choisir. Comme Camus, d’un côté il entretient un lien affectif puissant avec la terre algérienne. « Daru y était né. Partout ailleurs, il se sentait exilé. » Mais de l’autre il est fils de la France et de l’humanisme des Lumières. La fin du récit nous apprend que non seulement Daru est vaincu mais que l’idéal de solidarité qu’il a maladroitement défendu reste incompris. La chute de la nouvelle mérite un peu d’attention. « Derrière lui, sur le tableau noir, entre les méandres des fleuves français s’étalait, tracée à la craie par une main malhabile, l’inscription qu’il venait de lire : « Tu as livré notre frère. Tu paieras. » Daru regardait le ciel, le plateau et, au-delà, les terres invisibles qui s’étendaient jusqu’à la mer. Dans ce vaste pays qu’il avait tant aimé, il était seul. » Qui a écrit cette condamnation à mort ? Un lecteur pressé désignera les membres du clan soucieux d’exercer, dans un honneur primitif, la vendetta. Or nous l’avons compris, l’Arabe et ses congénères ne parlent pas la langue du colonisateur. Ils sont encore moins capables d’écrire quoi que ce soit. Alors surgit l’évidence : la « main malhabile » est celle d’un enfant qui retourne contre l’instituteur le savoir généreusement reçu de lui. La leçon est doublement cruelle. La civilisation a échoué. La fureur et la folie sanguinaire sont désormais prêtes à ravager le « royaume » terrestre imparfait. Face à la montée des périls, l’humaniste reste un homme seul.
Notes
1 Le Choc des civilisations (en anglais The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order) est un essai d’analyse géopolitique de l’Américain Samuel Huntington, paru en 1996. ↑
2 Ce patronyme est curieux. Camus l’a-t-il choisi à cause du cousinage de Daru avec Stendhal ? Et dans ce cas qu’a-t-il voulu souligner ? L’homme d’action à l’esprit concret en même temps qu’écrivain reconnu ? L’homme resté digne dans les revers de fortune ? ↑
3 « Quiconque croit en Dieu et au Jour Dernier, doit bien traiter son hôte »
« Quiconque croit en Dieu et au Jour Dernier doit accorder à son hôte son dû.
Mais quel est son dû, lui demande-t-on ?
Le jour de son arrivée et la nuit suivante. Le droit à l’hospitalité est de trois jours. Ce qui dépasse cette période est une aumône. »
(Hadiths rapportés par Al Boukhari et Mouslim) ↑
4 Pour l’agnostique Camus, à la différence des chrétiens, le « royaume est de ce monde ». L’Envers et l’endroit (1937) ↑
5 Où situer El-Ameur et Tinguit, lieux fictionnels (à noter qu’il existe une Tinghit dans l’Atlas marocain) ? Au pied de l’Atlas ou dans les Aurès ? Notre préférence irait à la seconde éventualité, d’abord parce que Camus est né dans le Constantinois, ensuite parce que l’étymologie du toponyme se rattache aux fauves, soit en référence aux teintes caractéristiques de la roche, soit en raison de la présence de nombreux félidés dans les siècles passés, dans tous les cas en conformité avec l’inhumaine réputation des habitants. ↑
6 Camus n’a jamais connu son père mort dans les premiers mois du premier conflit mondial. À y regarder de plus près, ce gendarme pourrait bien évoquer ce père manquant, celui qui indique la loi, celui qui rattache à la terre des pères, la patrie. ↑
7 « Fatum, disent les latins : c’était dit ; mektoub, disent les Arabes : c’était écrit. […] La fatalité, c’est le triomphe du langage. » Jean-Marie Domenach, Retour au tragique.
Remarquons que le poids du destin est plus écrasant pour celui qui ne possède ni l’écriture de son propre dialecte ni la langue rationaliste des colonisateurs. ↑
8 Albert Camus a fait ses études à Alger. À l’école communale, il voue une admiration sans borne à son instituteur, Louis Germain, qui l’éveille à la vie intellectuelle et aux exigences morales. Cet ancien combattant de la Première Guerre mondiale lui insuffle l’horreur de la guerre. En signe de reconnaissance, Camus lui dédiera son discours de prix Nobel. Il est probable qu’il ait vu en lui un père de substitution. ↑