Sujets du bac de français 2010
Centres étrangers : Amérique du Nord
Série L
Objet d’étude : Le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde.
Corpus :
- Texte A : Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Livre I, chapitre III, 1831.
- Texte B : Émile Zola, Le Rêve, chapitre I, 1888.
- Texte C : Blaise Cendrars, L’Or, chapitre VI, 21, 1925.
- Texte D : Véronique Ovaldé, Et mon cœur transparent, chapitre III, 2008.
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris
Dans un vaste espace laissé libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait.
Si cette jeune fille était un être humain, ou une fée, ou un ange, c’est ce que Gringoire, tout philosophe sceptique1, tout poète ironique qu’il était, ne put décider dans le premier moment, tant il fut fasciné par cette éblouissante vision.
Elle n’était pas grande, mais elle le semblait, tant sa fine taille s’élançait hardiment. Elle était brune, mais on devinait que le jour sa peau devait avoir ce beau reflet doré des andalouses et des romaines. Son petit pied aussi était andalou, car il était tout ensemble à l’étroit et à l’aise dans sa gracieuse chaussure. Elle dansait, elle tournait, elle tourbillonnait sur un vieux tapis de Perse, jeté négligemment sous ses pieds ; et chaque fois qu’en tournoyant sa rayonnante figure passait devant vous, ses grands yeux noirs vous jetaient un éclair.
Autour d’elle tous les regards étaient fixes, toutes les bouches ouvertes ; et en effet, tandis qu’elle dansait ainsi, au bourdonnement du tambour de basque que ses deux bras ronds et purs élevaient au-dessus de sa tête, mince, frêle et vive comme une guêpe, avec son corsage d’or sans pli, sa robe bariolée qui se gonflait, avec ses épaules nues, ses jambes fines que sa jupe découvrait par moments, ses cheveux noirs, ses yeux de flamme, c’était une surnaturelle créature.
— En vérité, pensa Gringoire, c’est une salamandre2, c’est une nymphe3, c’est une déesse, c’est une bacchante4 du mont Ménaléen5 !
En ce moment une des nattes de la chevelure de la « salamandre » se détacha, et une pièce de cuivre jaune qui y était attachée roula à terre.
— Hé non ! dit-il, c’est une bohémienne.
Toute illusion avait disparu.
1 Philosophe partisan du doute systématique.
2 Batracien amphibie auquel on attribuait anciennement la faculté de vivre dans le feu.
3 Divinité féminine d’apparence jeune et gracieuse, qui hante les fleuves, les sources, les bois, les montagnes et les prairies.
4 Prêtresse du culte de Bacchus.
5 Le mont Ménale est une montagne du Péloponnèse en Arcadie.
Émile Zola, Le Rêve
Le jour de Noël, une orpheline de neuf ans a trouvé refuge devant la porte d’une église à côté de laquelle se trouve la maison d’un couple d’artisans, Les Hubert.
Sans pensées, l’enfant regardait toujours ce logis vénérable de maître artisan, proprement tenu, et elle lisait, clouée à gauche de la porte, une enseigne jaune, portant ces mots : Hubert chasublier1, en vieilles lettres noires, lorsque, de nouveau, le bruit d’un volet rabattu l’occupa. Cette fois, c’était le volet de la fenêtre carrée du rez-de-chaussée : un homme à son tour se penchait, le visage tourmenté, au nez en bec d’aigle, au front bossu, couronné de cheveux épais et blancs déjà, malgré ses quarante-cinq ans à peine ; et lui aussi s’oublia une minute à l’examiner, avec un pli douloureux de sa grande bouche tendre. Ensuite, elle le vit qui demeurait debout, derrière les petites vitres verdâtres. Il se tourna, il eut un geste, sa femme reparut, très belle. Tous les deux, côte à côte, ne bougeaient plus, ne la quittaient plus du regard, l’air profondément triste.
Il y avait quatre cents ans que la lignée des Hubert, brodeurs de père en fils, habitait cette maison. Un maître chasublier l’avait fait construire sous Louis XI, un autre, réparer sous Louis XIV ; et l’Hubert actuel y brodait des chasubles, comme tous ceux de sa race. À vingt ans, il avait aimé une jeune fille de seize ans, Hubertine, d’une telle passion, que, sur le refus de la mère, veuve d’un magistrat, il l’avait enlevée, puis épousée. Elle était d’une beauté merveilleuse, ce fut tout leur roman, leur joie et leur malheur. Lorsque, huit mois plus tard, enceinte, elle vint au lit de mort de sa mère, celle-ci la déshérita et la maudit, si bien que l’enfant, né le même soir, mourut. Et, depuis, au cimetière, dans son cercueil, l’entêtée bourgeoise ne pardonnait toujours pas, car le ménage n’avait plus eu d’enfant, malgré son ardent désir. Après vingt-quatre années, ils pleuraient encore celui qu’ils avaient perdu, ils désespéraient maintenant de jamais fléchir la morte.
Troublée de leurs regards, la petite s’était renfoncée derrière le pilier de sainte Agnès. Elle s’inquiétait aussi du réveil de la rue : les boutiques s’ouvraient, du monde commençait à sortir. Cette rue des Orfèvres, dont le bout vient buter contre la façade latérale de l’église, serait une vraie impasse, bouchée du côté de l’abside2 par la maison des Hubert, si la rue Soleil, un étroit couloir, ne la dégageait de l’autre côté, en filant le long du collatéral3, jusqu’à la grande façade, place du Cloître ; et il passa deux dévotes4, qui eurent un coup d’œil étonné sur cette petite mendiante, qu’elles ne connaissaient pas, à Beaumont5. La tombée lente et obstinée de la neige continuait, le froid semblait augmenter avec le jour blafard, on n’entendait qu’un lointain bruit de voix, dans la sourde épaisseur du grand linceul blanc qui couvrait la ville.
Mais, sauvage, honteuse de son abandon comme d’une faute, l’enfant se recula encore, lorsque, tout d’un coup, elle reconnut devant elle Hubertine, qui n’ayant pas de bonne, était sortie chercher son pain.
– Petite, que fais-tu là ? qui es-tu ?
Et elle ne répondit point, elle se cachait le visage. Cependant elle ne sentait plus ses membres, son être s’évanouissait, comme si son cœur, devenu de glace, se fût arrêté. Quand la bonne dame eut tourné le dos, avec un geste de pitié discrète, elle s’affaissa sur les genoux, à bout de forces, glissa ainsi qu’une chiffe6 dans la neige, dont les flocons, silencieusement, l’ensevelirent. Et la dame, qui revenait avec son pain tout chaud, l’apercevant ainsi par terre, de nouveau s’approcha.
– Voyons, petite, tu ne peux rester sous cette porte.
Alors, Hubert, qui était sorti à son tour, debout au seuil de la maison, la débarrassa du pain, en disant :
– Prends-la donc, apporte-la !
Hubertine, sans ajouter rien, la prit dans ses bras solides. Et l’enfant ne se reculait plus, emportée comme une chose, les dents serrées, les yeux fermés, toute froide, d’une légèreté de petit oiseau tombé de son nid.
1 Chasublier : tailleur de chasubles (vêtements de prêtres)
2 Abside : partie d’église qui se trouve derrière le chœur.
3 Collatéral : bas-côté de la nef d’une église.
4 Dévote : personne très pieuse.
5 Beaumont : ville dans laquelle Zola situe son roman.
6 Chiffe : chiffon.
Blaise Cendrars, L’Or
En 1839, Suter, un aventurier sans scrupules, arrive dans une vallée californienne sauvage avec le projet d’y édifier un ranch.
Six semaines plus tard, la vallée offre un spectacle hallucinant. Le feu est passé là, le feu qui a couvé sous la fumée âcre et basse des fougères et des arbrisseaux. Puis le feu a jailli comme une torche, haute, droite, implacable, d’un seul coup. De tous les côtés se dressent maintenant des moignons fumants, l’écorce tordue, les branches éclatées. Les grands solitaires sont encore debout, fendus, roussis par la flamme.
Et l’on travaille.
Les bœufs vont et viennent. Les mulets sont à la charrue. Les semences volent. On n’a même pas le temps d’arracher les souches noircies et les sillons les contournent. Les bêtes à cornes pataugent déjà dans les prairies marécageuses, les moutons sont sur les collines, les chevaux paissent dans un enclos entouré d’épines. Au confluent des deux rivières on élève des terrassements et le ranch s’édifie. Des arbres à peine équarris1, des planches de six pouces d’épaisseur entrent dans sa construction. Tout est solide, grand, vaste, conçu pour l’avenir. Les bâtiments s’alignent, granges, magasins, réserves. Les ateliers sont au bord de l’eau ; le village canaque2 dans une ravine3.
Suter s’occupe de tout, dirige tout, surveille l’exécution des travaux jusque dans leurs moindres détails, il est sur tous les chantiers à la fois et n’hésite pas à donner personnellement un coup de main quand un homme fait défaut dans telle ou telle équipe. Des ponts sont jetés, des pistes tracées, des marais desséchés, des étangs creusés, un puits, des abreuvoirs, des canalisations d’eau. Une première palissade protège déjà la ferme ; un fortin est prévu. Des émissaires4 parcourent les villages indiens, et 250 anciens protégés des Missions5 sont occupés dans les différents travaux avec leurs femmes et leurs enfants. Tous les trois mois arrivent de nouveaux convois de Canaques et les terres cultivées s’étendent à perte de vue. Une trentaine de Blancs établis dans le pays sont venus se mettre à son service. Ce sont des Mormons6. Suter les paie trois piastres7 par jour.
Et la prospérité ne tarde pas.
4 000 bœufs, 1 200 vaches, 1 500 chevaux et mulets, 12 000 moutons s’égaillent autour de la Nouvelle-Helvétie8, à quelques journées de marche à la ronde. Les moissons rapportent du 530 % et les greniers sont pleins à crever.
Dès la fin de la deuxième année, Suter achète aux Russes qui se retirent les belles fermes sur la côte, près de Fort Bodega. Il les paie 40 000 dollars comptant. Il se propose d’y faire de l’élevage en grand et, particulièrement, d’y améliorer la race bovine.
1 Équarrir : tailler à angles droits.
2 Canaque : adjectif formé à partir du nom Canaque désignant les habitants de Nouvelle-Calédonie (il s’agit ici d’hommes qui ont été déportés comme esclaves).
3 Ravine : petit ravin.
4 Émissaire : personne chargée d’une mission auprès d’une autre.
5 Missions : établissements religieux destinés à répandre la foi chrétienne parmi les populations indigènes, ici les Indiens d’Amérique.
6 Mormons : membres d’une secte religieuse américaine.
7 Piastre : unité de monnaie ; la somme totale est dérisoire.
8 Nouvelle-Helvétie : nom du ranch de Suter.
Véronique Ovaldé, Et mon cœur transparent
Lancelot corrige des textes avant leur publication et ce jour-là, il se rend chez son éditeur pour lui remettre son travail.
Il sortit dans la neige de pétales de cerisier (qui parsemaient le sol de minuscules pastilles blanches), et le temps était si délicieux qu’il décida d’aller à pied jusqu’à la maison d’édition. Il en aurait peut-être pour une heure mais de toute façon il ne voyait pas bien ce qu’il allait pouvoir faire de tout ce temps vacant qui lui restait avant sa prochaine correction, si ce n’est le remplir en regardant les chats sauter de branche en branche, en lisant un roman policier (quelque chose de classique, un Agatha Christie sans doute) et en buvant du thé vert. Lancelot ne cultivait aucune vie sociale parce que celle-ci lui aurait donné l’impression de disperser son attention, il lui aurait semblé semer de petits cailloux de sollicitude1, d’amitié et de temps disponible, ce qui ne lui paraissait ni honnête ni souhaitable. Lancelot entretenait une agréable solitude – comme d’autres s’adonnent à un sport ou prennent soin de leur bonsaï2 – simplement ponctuée par les leçons de choses de son épouse3.
Il marcha un moment et passa devant la boutique d’un fleuriste dont l’enseigne en anglaises4 aux arabesques outrées calligraphiait un : Il était une rose… (les points de suspension faisaient partie du nom de la boutique). Il s’arrêta pour considérer les bouquets tout prêts qui patientaient dans leur sachet transparent rempli d’eau. La commerçante bondit de son échoppe, Lancelot lui adressa alors un signe de dénégation, il reprit sa route d’un pas mesuré, mais fut stoppé tout net dans son cheminement par une chose tombée du ciel et atterrissant sur sa tête, une chose qui devait faire, mettons, vingt-cinq centimètres sur dix de hauteur, d’une texture très douce qui suggéra à Lancelot le velours d’une tenture ou bien alors ce qui s’appelle communément de la peau retournée, ce qui n’a jamais rien évoqué à Lancelot parce qu’il a l’impression qu’on lui parle de l’intérieur de la peau, et comment croire que l’intérieur de la peau soit aussi doux que du velours. Donc Lancelot reçut sur la tête un objet d’un format moyen et d’une texture douce muni d’un talon de dix centimètres entièrement recouvert de métal.
Le talon lui entailla légèrement le crâne.
Lancelot émit une exclamation de surprise et de douleur, il voulut lever le nez mais eut un bref étourdissement, une sorte d’éclair dans le coin de son œil gauche, qui lui fit préférer se pencher pour ramasser l’objet (une chaussure de femme très élégante taille 37) qui avait valdingué dans le caniveau. Il se dit en l’examinant attentivement, C’est un objet parfait. Et au moment où il se disait cela, il entendit un cri au-dessus de lui.
Il leva la tête en espérant apercevoir la personne qui portait ordinairement cette chaussure et que la personne, il se surprit à cet espoir, serait à l’aune5 de la perfection de l’objet.
Il ne vit rien d’autre qu’une fenêtre ouverte au deuxième étage de l’immeuble, et à moins que la chaussure n’ait dégringolé directement du ciel, ce qui était somme toute une hypothèse trop audacieuse, il y avait de fortes chances qu’elle fût passée par cette fenêtre.
1 Sollicitude : attention portée à autrui.
2 Bonsaï : arbre nain.
3 Son épouse : sa femme est institutrice.
4 En anglaises : en caractères cursifs penchés à droite.
5 À l’aune de : à la mesure de.
I. Vous répondrez d’abord à la question suivante (4 points)
Ces extraits figurent tous dans des débuts de roman. En quoi sont-ils particulièrement efficaces pour lancer la fiction romanesque ? Vous vous appuierez sur quelques éléments des textes A, B, C et D qui vous paraissent essentiels. Votre réponse n’excédera pas une vingtaine de lignes.
II. Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des sujets suivants (16 points)
Commentaire
Vous commenterez le texte A, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
Dissertation
Un roman se limite-t-il à l’invention d’une histoire ? Vous répondrez à cette question en vous appuyant sur les textes du corpus et sur vos lectures personnelles concernant l’objet d’étude « le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde ».
Écriture d’invention
Un lycéen écrit au courrier des lecteurs d’un magazine littéraire pour exposer ce qui lui donne envie d’entrer dans l’univers d’un roman. Rédigez sa lettre en vous appuyant sur des exemples d’œuvres que vous connaissez.
N. B. : vous ne signerez pas votre lettre.
Séries S et ES
Objet d’étude : Le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde.
Corpus :
- Texte A : Honoré de Balzac, Illusions perdues, 1843.
- Texte B : Émile Zola, L’Œuvre, 1886.
- Texte C : Marguerite Duras, Un Barrage contre le Pacifique, 1950.
- Texte D : Isabelle Jarry, Le Jardin Yamata, 1999.
Honoré de Balzac, Illusions perdues, « Un grand homme de province à Paris »
Lucien de Rubempré, un jeune poète, a quitté Angoulême, sa ville natale, pour tenter sa chance à Paris. Il y rencontre un journaliste, Étienne Lousteau, qui lui fait découvrir la vie nocturne parisienne. Dans cet extrait, ils sont au « Panorama Dramatique », une salle de spectacle de médiocre qualité.
Étienne et Lucien perdirent un certain temps à errer dans les corridors et à parlementer avec les ouvreuses1.
– Allons dans la salle, nous parlerons au directeur qui nous prendra dans sa loge. D’ailleurs je vous présenterai à l’héroïne de la soirée, à Florine.
Sur un signe de Lousteau, le portier de l’Orchestre prit une petite clef et ouvrit une porte perdue dans un gros mur. Lucien suivit son ami, et passa soudain du corridor illuminé au trou noir qui, dans presque tous les théâtres, sert de communication entre la salle et les coulisses. Puis, en montant quelques marches humides, le poète de province aborda la coulisse, où l’attendait le spectacle le plus étrange. L’étroitesse des portants2, la hauteur du théâtre, les échelles à quinquets3, les décorations si horribles vues de près, les acteurs plâtrés4, leurs costumes si bizarres et faits d’étoffes si grossières, les garçons à vestes huileuses, les cordes qui pendent, le régisseur qui se promène son chapeau sur la tête, les comparses5 assises, les toiles de fond suspendues, les pompiers, cet ensemble de choses bouffonnes, tristes, sales, affreuses, éclatantes ressemblait si peu à ce que Lucien avait vu de sa place au théâtre que son étonnement fut sans bornes. On achevait un bon gros mélodrame6 intitulé Bertram, pièce imitée d’une tragédie de Maturin qu’estimaient infiniment Nodier, lord Byron et Walter Scott7, mais qui n’obtint aucun succès à Paris.
– Ne quittez pas mon bras si vous ne voulez pas tomber dans une trappe, recevoir une forêt sur la tête, renverser un palais ou accrocher une chaumière, dit Étienne à Lucien. Florine est-elle dans sa loge, mon bijou ? dit-il à une actrice qui se préparait à son entrée en scène en écoutant les acteurs.
– Oui, mon amour. Je te remercie de ce que tu as dit de moi. Tu es d’autant plus gentil que Florine entrait ici.
– Allons, ne manque pas ton effet, ma petite, lui dit Lousteau. Précipite-toi haut la patte ! dis-moi bien : Arrête, malheureux ! car il y a deux mille francs de recette.
Lucien stupéfait vit l’actrice se composant en s’écriant : Arrête, malheureux ! de manière à le glacer d’effroi. Ce n’était plus la même femme.
– Voilà donc le théâtre, dit-il à Lousteau.
– C’est comme la boutique de la Galerie de Bois8 et comme un journal pour la littérature, une vraie cuisine9, lui répondit son nouvel ami.
1 Ouvreuses : femmes dont le rôle est de placer les spectateurs dans une salle de spectacle.
2 Portants : montants qui soutiennent un élément du décor, un appareil d’éclairage au théâtre.
3 Échelles à quinquets : échelles munies de lampes formant des rampes d’éclairage.
4 Acteurs plâtrés : acteurs dont le visage est excessivement maquillé.
5 Comparses : acteurs qui remplissent un rôle muet, personnages dont le rôle est insignifiant.
6 Mélodrame : œuvre dramatique accompagnée de musique.
7 Maturin (1782-1824) : romancier irlandais ; Nodier (1780-1844) : écrivain français ; Lord Byron (1788-1824) : artiste, écrivain, poète anglais ; Walter Scott (1771-1832) : poète et écrivain écossais.
8 La Galerie de Bois : est dépeinte ensuite par Balzac comme « un bazar ignoble » ; « la boutique » est une librairie à côté d’autres commerces plus ou moins recommandables.
9 Une vraie cuisine : un mélange de genres invraisemblable.
Émile Zola, L’Œuvre
Claude Lantier est un peintre sans succès qui cherche à imposer une nouvelle forme d’art pictural. Il évolue dans le milieu des artistes parisiens, qui tous connaissent des fortunes diverses. Il rencontre Christine avec qui il s’installe à la campagne pour un bonheur de courte durée. Elle lui donne un fils, Jacques, et le couple retrouve Paris.
Après le refus de son troisième tableau, l’été fut si miraculeux, cette année-là, que Claude sembla y puiser une nouvelle force. Pas un nuage, des journées limpides sur l’activité géante de Paris. Il s’était remis à courir la ville, avec la volonté de chercher un coup, comme il disait : quelque chose d’énorme, de décisif, il ne savait pas au juste. Et, jusqu’à septembre, il ne trouva rien, se passionnant pendant une semaine pour un sujet, puis déclarant que ce n’était pas encore ça. Il vivait dans un continuel frémissement, aux aguets, toujours à la minute de mettre la main sur cette réalisation de son rêve, qui fuyait toujours. Au fond, son intransigeance de réaliste cachait des superstitions de femme nerveuse, il croyait à des influences compliquées et secrètes : tout allait dépendre de l’horizon choisi, néfaste ou heureux.
Une après-midi, par un des derniers beaux jours de la saison, Claude avait emmené Christine, laissant le petit Jacques à la garde de la concierge, une vieille brave femme, comme ils faisaient d’ordinaire, quand ils sortaient ensemble. C’était une envie soudaine de promenade, un besoin de revoir avec elle des coins chéris autrefois, derrière lequel se cachait le vague espoir qu’elle lui porterait chance. Et ils descendirent ainsi jusqu’au pont Louis-Philippe, restèrent un quart d’heure sur le quai aux Ormes, silencieux, debout contre le parapet1, à regarder en face, de l’autre côté de la Seine, le vieil hôtel du Martoy, où ils s’étaient aimés. Puis, toujours sans une parole, ils refirent leur ancienne course, faite tant de fois ; ils filèrent le long des quais, sous les platanes, voyant à chaque pas se lever le passé ; et tout se déroulait, les ponts avec la découpure de leurs arches sur le satin de l’eau, la Cité2 dans l’ombre que dominaient les tours jaunissantes de Notre-Dame, la courbe immense de la rive droite, noyée de soleil, terminée par la silhouette perdue du pavillon de Flore, et les larges avenues, les monuments des deux rives, et la vie de la rivière, les lavoirs, les bains, les péniches. Comme jadis, l’astre à son déclin les suivait, roulant sur les toits des maisons lointaines, s’écornant3 derrière la coupole de l’Institut : un coucher éblouissant, tel qu’ils n’en avaient pas eu de plus beau, une lente descente au milieu de petits nuages, qui se changèrent en un treillis de pourpre4, dont toutes les mailles lâchaient des flots d’or. Mais, de ce passé qui s’évoquait, rien ne venait qu’une mélancolie invincible, la sensation de l’étemelle fuite, l’impossibilité de remonter et de revivre. Ces antiques pierres demeuraient froides, ce continuel courant sous les ponts, cette eau qui avait coulé, leur semblait avoir emporté un peu d’eux-mêmes, le charme du premier désir, la joie de l’espoir. Maintenant qu’ils s’appartenaient, ils ne goûtaient plus ce simple bonheur de sentir la pression tiède de leurs bras, pendant qu’ils marchaient doucement, comme enveloppés dans la vie énorme de Paris.
1 Parapet : balustrade, rambarde à hauteur de poitrine qui borde les ponts.
2 La Cité : île de la Cité, sur laquelle est implantée la cathédrale Notre-Dame.
3 S’écornant : ici, diminuant.
4 Le treillis de pourpre : les nuages se présentent de façon enchevêtrée, comme un maillage qui se défait en jouant avec la lumière du couchant.
Marguerite Duras, Un Barrage contre le Pacifique
Dans Un barrage contre le pacifique, roman inspiré de son enfance, Marguerite Duras raconte l’histoire d’une famille. Une mère, son fils (Joseph) et sa fille (Suzanne), colons en Indochine française, sont confrontés à la misère ; en cause, les terres impropres à la culture qui leur ont été attribuées par l’administration française. L’extrait qui suit ouvre la seconde partie de l’œuvre. Il s’agit de montrer la grande ville coloniale : ses rues, son quartier blanc, ses trafics, ses lieux de loisirs.
Les quartiers blancs de toutes les villes coloniales du monde étaient toujours, dans ces années-là, d’une impeccable propreté. Il n’y avait pas que les villes. Les blancs aussi étaient très propres. Dès qu’ils arrivaient, ils apprenaient à se baigner tous les jours, comme on fait des petits enfants, et à s’habiller de l’uniforme colonial, du costume blanc, couleur d’immunité1 et d’innocence. Dès lors, le premier pas était fait. La distance augmentait d’autant, la différence première était multipliée, blanc sur blanc, entre eux et les autres, qui se nettoyaient avec la pluie du ciel et les eaux limoneuses2 des fleuves et des rivières. Le blanc est en effet extrêmement salissant.
Aussi les blancs se découvraient-ils du jour au lendemain plus blancs que jamais, baignés, neufs, siestant à l’ombre de leurs villas, grands fauves à la robe fragile.
Dans le haut quartier n’habitaient que les blancs qui avaient fait fortune. Pour marquer la mesure surhumaine de la démarche blanche, les rues et les trottoirs du haut du quartier étaient immenses. Un espace orgiaque3, inutile était offert aux pas négligents des puissants au repos. Et dans les avenues glissaient leurs autos caoutchoutées4, suspendues, dans un demi-silence impressionnant.
Tout cela était asphalté5, large, bordé de trottoirs plantés d’arbres rares et séparés en deux par des gazons et des parterres de fleurs le long desquels stationnaient les files rutilantes des taxis torpédos6. Arrosées plusieurs fois par jour, vertes, fleuries, ces rues étaient aussi bien entretenues que les allées d’un immense jardin zoologique où les espèces rares des blancs veillaient sur elles-mêmes. Le centre du haut quartier était leur vrai sanctuaire. C’était au centre seulement qu’à l’ombre des tamariniers7 s’étalaient les immenses terrasses de leurs cafés. Là, le soir, ils se retrouvaient entre eux. Seuls les garçons de café étaient encore indigènes, mais déguisés en blancs, ils avaient été mis dans des smokings, de même qu’auprès d’eux les palmiers des terrasses étaient en pots. Jusque tard dans la nuit, installés dans des fauteuils en rotin derrière les palmiers et les garçons en pots et en smokings8, on pouvait voir les blancs, suçant pernod9, whisky-soda, ou martel-perrier10, se faire, en harmonie avec le reste, un foie bien colonial.
1 Immunité : privilège dont bénéficient les diplomates étrangers, leur famille, le personnel étranger des
ambassades et certains membres d’organismes internationaux, les soustrayant à la législation du pays où ils résident.
2 Limoneuses : boueuses.
3 Orgiaque : l’adjectif est à prendre ici dans le sens de « excessif ».
4 Caoutchoutées : garnies de caoutchouc. On fait ici référence aux pneus des voitures qui leur permettent de se déplacer silencieusement et confortablement.
5 Asphalté : recouvert de bitume.
6 Torpédos : automobiles anciennes décapotables.
7 Tamariniers : grands arbres pouvant atteindre vingt mètres de hauteur, poussant dans les régions tropicales.
8 « Les palmiers et les garçons en pots et en smokings » : la phrase précédente éclaire le sens. Les indigènes ont été « déguisés » et « mis dans des smokings » comme les palmiers avaient « été mis en pots ».
9 Pernod : boisson alcoolisée à base d’anis.
10 Martel-perrier : cocktail à base de cognac et d’eau minérale gazeuse.
Isabelle Jarry, Le Jardin Yamata
Agathe, la narratrice, va au Japon pour tenter d’éclaircir le mystère de ses origines familiales. Dans les années 1930-1940, son grand-père a vécu à Kyoto et aurait participé à la création d’un jardin japonais, le jardin Yamata.
J’arrivai à la ville en milieu de matinée. La journée était si radieuse que l’air même paraissait s’être allégé, je respirai à fond et cela me faisait à chaque inspiration l’effet d’une légère ivresse. La dame de la billetterie refusa d’un geste mes pièces de cent yens et me fit signe d’entrer. Elle continuait de parler comme si je la comprenais, je ne saisis dans ses paroles que le nom de Miyazawa, j’entrai dans le jardin et le cherchai des yeux. La vive clarté du jour donnait à l’ensemble du jardin une beauté particulière, un relief que seules soulignent les lumières de demi-saison, quand quelque changement se prépare et que brusquement entrent en résonance les qualités concentrées de ces périodes de l’année où le climat bascule.
Je parcourais une fois encore l’allée que j’avais suivie des dizaines de fois déjà, et la vision que j’avais de ce que je connaissais pourtant si bien se trouvait comme renouvelée, rehaussée par l’éclat flatteur du soleil printanier. Je clignais des yeux devant l’étang aux facettes brillantes, sous la surface glissaient les carpes aux couleurs mélangées, orange, jaune d’or, noir mat, blanc nacré, bleu ardoise, jaune pâle vermillon. Leurs corps fuselés se croisaient dans l’eau, parfois un dos rouge affleurait, frôlant un flanc d’un blanc rosé, les couleurs de pigmentation se brouillaient dans le miroitement de l’onde et l’on finissait par oublier les poissons, pour ne plus distinguer qu’un ballet de couleurs furtives, langues de pinceaux agités par quelque main invisible. Je fis le tour complet du jardin et ce n’est qu’en revenant vers la maison que je vis le jardinier, assis sur les tatamis1 de la grande pièce, face au paysage qu’il contemplait, les yeux perdus vers les hauteurs des collines.
Je m’approchai en silence, ôtai mes chaussures sur la pierre plate du seuil et m’assis sur le bord de la galerie. Alors seulement je remarquai que le vieil homme ne portait pas ses vêtements de travail. Je ne distinguais pas bien le bas du corps – il était agenouillé sur ses talons – mais en haut il portait une veste de kimono d’un ocre foncé, dont le grain de tissu laissait apparaître une trame plus sombre. Sous l’encolure de sa veste, la bordure de son kimono de dessous dépassait, d’un bleu soutenu à fines rayures noires. Il me fit signe de le rejoindre sur le tatami et je vins m’asseoir à côté de lui.
— En ce moment, dit-il, c’est à cette place qu’on a la plus belle vue du jardin.
C’était sans doute celle qui offrait le rapport le plus harmonieux entre le jardin lui-même et l’arrière-plan. La forêt était alors constellée d’érables dont les jeunes feuilles venaient émailler le vert profond des camphriers2 de leurs pousses vert tendre. Ce fond contrasté faisait ressortir l’agencement parfait du jardin. De cette place, on aurait pu croire que l’eau qui alimentait la cascade venait du sous-bois voisin, partie plus en amont encore d’une source de montagne. L’œil se perdait et à sa suite entraînait l’esprit qui se prenait à divaguer par-delà l’infinité. On ne pensait plus, on abandonnait tout raisonnement pour se laisser aller à la sensation pure.1 Tatamis : tapis de sol.
2 Camphriers : arbustes d’extrême Orient (lauriers du Japon).
I. Vous répondrez d’abord à la question suivante (4 points)
Les textes du corpus, à travers la description des lieux, mettent-ils en lumière la même vision du monde ? Votre réponse n’excédera pas une vingtaine de lignes.
II. Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des sujets suivants (16 points)
Commentaire
Vous commenterez le texte d’Honoré de Balzac, extrait des Illusions perdues. (Texte A)
Dissertation
Balzac, dans son roman Le Père Goriot, alors qu’il décrit le personnage de Madame Vauquer et la pension qu’elle dirige, écrit : « Toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. »
En vous appuyant sur les textes du corpus et sur vos lectures personnelles, vous direz comment la description contribue à la construction des personnages et de l’univers romanesque.
Écriture d’invention
« Toute sa personne explique la pension, comme la pension implique sa personne. »
Vous rédigerez une page de roman dans laquelle les lieux laissent deviner la psychologie d’un personnage.
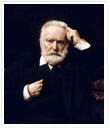 Dans un vaste espace laissé libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait.
Dans un vaste espace laissé libre entre la foule et le feu, une jeune fille dansait.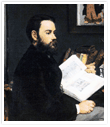 Sans pensées, l’enfant regardait toujours ce logis vénérable de maître artisan, proprement tenu, et elle lisait, clouée à gauche de la porte, une enseigne jaune, portant ces mots : Hubert chasublier1, en vieilles lettres noires, lorsque, de nouveau, le bruit d’un volet rabattu l’occupa. Cette fois, c’était le volet de la fenêtre carrée du rez-de-chaussée : un homme à son tour se penchait, le visage tourmenté, au nez en bec d’aigle, au front bossu, couronné de cheveux épais et blancs déjà, malgré ses quarante-cinq ans à peine ; et lui aussi s’oublia une minute à l’examiner, avec un pli douloureux de sa grande bouche tendre. Ensuite, elle le vit qui demeurait debout, derrière les petites vitres verdâtres. Il se tourna, il eut un geste, sa femme reparut, très belle. Tous les deux, côte à côte, ne bougeaient plus, ne la quittaient plus du regard, l’air profondément triste.
Sans pensées, l’enfant regardait toujours ce logis vénérable de maître artisan, proprement tenu, et elle lisait, clouée à gauche de la porte, une enseigne jaune, portant ces mots : Hubert chasublier1, en vieilles lettres noires, lorsque, de nouveau, le bruit d’un volet rabattu l’occupa. Cette fois, c’était le volet de la fenêtre carrée du rez-de-chaussée : un homme à son tour se penchait, le visage tourmenté, au nez en bec d’aigle, au front bossu, couronné de cheveux épais et blancs déjà, malgré ses quarante-cinq ans à peine ; et lui aussi s’oublia une minute à l’examiner, avec un pli douloureux de sa grande bouche tendre. Ensuite, elle le vit qui demeurait debout, derrière les petites vitres verdâtres. Il se tourna, il eut un geste, sa femme reparut, très belle. Tous les deux, côte à côte, ne bougeaient plus, ne la quittaient plus du regard, l’air profondément triste. Étienne et Lucien perdirent un certain temps à errer dans les corridors et à parlementer avec les ouvreuses1.
Étienne et Lucien perdirent un certain temps à errer dans les corridors et à parlementer avec les ouvreuses1.