Blaise Pascal, Trois discours sur la condition des Grands
Premier discours
Pour entrer dans la véritable connaissance de votre condition, considérez-la dans cette image.
Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue, dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi, qui s’était perdu ; et, ayant beaucoup de ressemblance de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui, et reconnu en cette qualité par tout ce peuple. D’abord il ne savait quel parti prendre ; mais il se résolut enfin de se prêter à sa bonne fortune. Il reçut tous les respects qu’on lui voulut rendre, et il se laissa traiter de roi.
Mais comme il ne pouvait oublier sa condition naturelle, il songeait, en même temps qu’il recevait ces respects, qu’il n’était pas ce roi que ce peuple cherchait, et que ce royaume ne lui appartenait pas. Ainsi il avait une double pensée : l¹une par laquelle il agissait en roi, l’autre par laquelle il reconnaissait son état véritable, et que ce n’était que le hasard qui l’avait mis en place où il était. Il cachait cette dernière pensée et il découvrait l’autre. C’était par la première qu’il traitait avec le peuple, et par la dernière qu’il traitait avec soi-même.
Ne vous imaginez pas que ce soit par un moindre hasard que vous possédez les richesses dont vous vous trouvez maître, que celui par lequel cet homme se trouvait roi. Vous n’y avez aucun droit de vous-même et par votre nature, non plus que lui : et non seulement vous ne vous trouvez fils d’un duc, mais vous ne vous trouvez au monde, que par une infinité de hasards. Votre naissance dépend d’un mariage, ou plutôt de tous les mariages de ceux dont vous descendez. Mais d’où ces mariages dépendent-ils ? D’une visite faite par rencontre, d’un discours en l’air, de mille occasions imprévues.
Vous tenez, dites-vous, vos richesses de vos ancêtres, mais n’est-ce pas par mille hasards que vos ancêtres les ont acquises et qu’ils les ont conservées ? Vous imaginez-vous aussi que ce soit par quelque loi naturelle que ces biens ont passé de vos ancêtres à vous ? Cela n’est pas véritable. Cet ordre n’est fondé que sur la seule volonté des législateurs qui ont pu avoir de bonnes raisons, mais dont aucune n’est prise d’un droit naturel que vous ayez sur ces choses. S’il leur avait plu d’ordonner que ces biens, après avoir été possédés par les pères durant leur vie, retourneraient à la république après leur mort, vous n’auriez aucun sujet de vous en plaindre.
Ainsi tout le titre par lequel vous possédez votre bien n’est pas un titre de nature, mais d’un établissement humain. Un autre tour d’imagination dans ceux qui ont fait les lois vous aurait rendu pauvre ; et ce n’est que cette rencontre du hasard qui vous a fait naître, avec la fantaisie des lois favorables à votre égard, qui vous met en possession de tous ces biens.
Je ne veux pas dire qu’ils ne vous appartiennent pas légitimement, et qu’il soit permis à un autre de vous les ravir ; car Dieu, qui en est le maître, a permis aux sociétés de faire des lois pour les partager ; et quand ces lois sont une fois établies, il est injuste de les violer. C’est ce qui vous distingue un peu de cet homme qui ne posséderait son royaume que par l’erreur du peuple, parce que Dieu n’autoriserait pas cette possession et l’obligerait à y renoncer, au lieu qu’il autorise la vôtre Mais ce qui vous est entièrement commun avec lui, c’est que ce droit que vous y avez n’est point fondé, non plus que le sien, sur quelque qualité et sur quelque mérite qui soit en vous et qui vous en rende digne. Votre âme et votre corps sont d’eux-mêmes indifférents à l’état de batelier ou à celui de duc, et il n’y a nul lien naturel qui les attache à une condition plutôt qu’à une autre.
Que s’ensuit-il de là ? que vous devez avoir, comme cet homme dont nous avons parlé, une double pensée ; et que si vous agissez extérieurement avec les hommes selon votre rang, vous devez reconnaître, par une pensée plus cachée mais plus véritable, que vous n’avez rien naturellement au- dessus d’eux. Si la pensée publique vous élève au-dessus du commun des hommes, que l’autre vous abaisse et vous tienne dans une parfaite égalité avec tous les hommes ; car c’est votre état naturel.
Le peuple qui vous admire ne connaît pas peut-être ce secret. Il croit que la noblesse est une grandeur réelle et il considère presque les grands comme étant d’une autre nature que les autres. Ne leur découvrez pas cette erreur, si vous voulez ; mais n’abusez pas de cette élévation avec insolence, et surtout ne vous méconnaissez pas vous-même en croyant que votre être a quelque chose de plus élevé que celui des autres.
Que diriez-vous de cet homme qui aurait été fait roi par l’erreur du peuple, s’il venait à oublier tellement sa condition naturelle, qu’il s’imaginât que ce royaume lui était dû, qu’il le méritait et qu’il lui appartenait de droit ? Vous admireriez sa sottise et sa folie. Mais y en a-t-il moins dans les personnes de condition qui vivent dans un si étrange oubli de leur état naturel ?
Que cet avis est important ! Car tous les emportements, toute la violence et toute la vanité des grands vient de ce qu’ils ne connaissent point ce qu’ils sont : étant difficile que ceux qui se regarderaient intérieurement comme égaux à tous les hommes, et qui seraient bien persuadés qu’ils n’ont rien en eux qui mérite ces petits avantages que Dieu leur a donnés au-dessus des autres, les traitassent avec insolence. Il faut s’oublier soi-même pour cela, et croire qu’on a quelque excellence réelle au-dessus d’eux, en quoi consiste cette illusion que je tâche de vous découvrir.
Second discours
Il est bon, Monsieur, que vous sachiez ce que l’on vous doit, afin que vous ne prétendiez pas exiger des hommes ce qui ne vous est pas dû ; car c’est une injustice visible : et cependant elle est fort commune à ceux de votre condition, parce qu’ils en ignorent la nature.
Il y a dans le monde deux sortes de grandeurs ; car il y a des grandeurs d’établissement et des grandeurs naturelles. Les grandeurs d’établissement dépendent de la volonté des hommes, qui ont cru avec raison devoir honorer certains états et y attacher certains respects. Les dignités et la noblesse sont de ce genre. En un pays on honore les nobles, en l’autre les roturiers, en celui-ci les aînés, en cet autre les cadets. Pour quoi cela ? Parce qu’il a plu aux hommes. La chose était indifférente avant l’établissement : après l’établissement elle devient juste, parce qu’il est injuste de la troubler
Les grandeurs naturelles sont celles qui sont indépendantes de la fantaisie des hommes, parce qu’elles consistent dans des qualités réelles et effectives de l’âme ou du corps, qui rendent l’une ou l’autre plus estimable, comme les sciences, la lumière de l’esprit, la vertu, la santé, la force.
Nous devons quelque chose à l’une et à l’autre de ces grandeurs ; mais comme elles sont d’une nature différente, nous leur devons aussi différents respects.
Aux grandeurs d’établissement, nous leur devons des respects d’établissement, c’est-à-dire certaines cérémonies extérieures qui doivent être néanmoins accompagnées, selon la raison, d’une reconnaissance intérieure de la justice de cet ordre, mais qui ne nous font pas concevoir quelque qualité réelle en ceux que nous honorons de cette sorte. Il faut parler aux rois à genoux ; il faut se tenir debout dans la chambre des princes. C’est une sottise et une bassesse d’esprit que de leur refuser ces devoirs.
Mais pour les respects naturels qui consistent dans l’estime, nous ne les devons qu’aux grandeurs naturelles ; et nous devons au contraire le mépris et l’aversion aux qualités contraires à ces grandeurs naturelles. Il n’est pas nécessaire, parce que vous êtes duc, que je vous estime ; mais il est nécessaire que je vous salue. Si vous êtes duc et honnête homme, je rendrai ce que je dois à l’une et à l’autre de ces qualités. Je ne vous refuserai point les cérémonies que mérite votre qualité de duc, ni l’estime que mérite celle d’honnête homme. Mais si vous étiez duc sans être honnête homme, je vous ferais encore justice ; car en vous rendant les devoirs extérieurs que l’ordre des hommes a attachés à votre naissance, je ne manquerais pas d’avoir pour vous le mépris intérieur que mériterait la bassesse de votre esprit.
Voilà en quoi consiste la justice de ces devoirs. Et l’injustice consiste à attacher les respects naturels aux grandeurs d’établissement, ou à exiger les respects d’établissement pour les grandeurs naturelles. M. N… est un plus grand géomètre que moi ; en cette qualité il veut passer devant moi : je lui dirai qu’il n’y entend rien. La géométrie est une grandeur naturelle ; elle demande une préférence d’estime, mais les hommes n’y ont attaché aucune préférence extérieure. Je passerai donc devant lui, et l’estimerai plus que moi, en qualité de géomètre. De même si, étant duc et pair, vous ne vous contentez pas que je me tienne découvert devant vous, et que vous voulussiez encore que je vous estimasse je vous prierais de me montrer les qualités qui méritent mon estime. Si vous le faisiez, elle vous est acquise, et je ne vous la pourrais refuser avec justice ; mais si vous ne le faisiez pas, vous seriez injuste de me la demander, et assurément vous n’y réussirez pas, fussiez-vous le plus grand prince du monde.
Troisième discours
Je vous veux faire connaître, Monsieur, votre condition véritable ; car c’est la chose du monde que les personnes de votre sorte ignorent le plus. Qu’est-ce, à votre avis, d’être grand seigneur ? C’est être maître de plusieurs objets de la concupiscence des hommes, et ainsi pouvoir satisfaire aux besoins et aux désirs de plusieurs. Ce sont ces besoins et ces désirs qui les attirent auprès de vous, et qui font qu’ils se soumettent à vous : sans cela ils ne vous regarderaient pas seulement ; mais ils espèrent, par ces services et ces déférences qu’ils vous rendent obtenir de vous quelque part de ces biens qu’ils désirent et dont ils voient que vous disposez.
Dieu est environné de gens pleins de charité, qui lui demandent les biens de la charité qui sont en sa puissance : ainsi il est proprement le roi de la charité.
Vous êtes de même environné d’un petit nombre de personnes, sur qui vous régnez en votre manière. Ces gens sont pleins de concupiscence. Ils vous demandent les biens de la concupiscence ; c’est la concupiscence qui les attache à vous. Vous êtes donc proprement un roi de concupiscence. Votre royaume est de peu d’étendue ; mais vous êtes égal en cela aux plus grands rois de la terre ; ils sont comme vous des rois de concupiscence. C’est la concupiscence qui fait leur force, c’est-à-dire la possession des choses que la cupidité des hommes désire.
Mais en connaissant votre condition naturelle, usez des moyens qu’elle vous donne, et ne prétendez pas régner par une autre voie que par celle qui vous fait roi. Ce n’est point votre force et votre puissance naturelle qui vous assujettit toutes ces personnes. Ne prétendez donc point les dominer par la force, ni les traiter avec dureté. Contentez leurs justes désirs, soulagez leurs nécessités ; mettez votre plaisir à être bienfaisant ; avancez-les autant que vous le pourrez, et vous agirez en vrai roi de concupiscence.
Ce que je vous dis ne va pas bien loin ; et si vous en demeurez là, vous ne laisserez pas de vous perdre ; mais au moins vous vous perdrez en honnête homme. Il y a des gens qui se damnent si sottement, par l’avarice, par la brutalité, par les débauches, par la violence, par les emportements, par les blasphèmes ! Le moyen que je vous ouvre est sans doute plus honnête ; mais en vérité c’est toujours une grande folie que de se damner ; et c’est pourquoi il n’en faut pas demeurer là. Il faut mépriser la concupiscence et son royaume, et aspirer à ce royaume de charité où tous les sujets ne respirent que la charité, et ne désirent que les biens de la charité. D’autres que moi vous en diront le chemin : il me suffit de vous avoir détourné de ces vies brutales où je vois que plusieurs personnes de votre condition se laissent emporter faute de bien connaître l’état véritable de cette condition.
Étude des textes
Introduction
Ces trois discours datent de 1670. Ils ne sont pas à proprement parler de la plume de Pascal car ils nous ont été transmis par Pierre Nicole (1625-1695), moraliste et théologien janséniste. Il s’agit plutôt de la mise en forme ultérieure de notes concernant des propos tenus par Pascal vers 16601. Cependant le lecteur y retrouve la force argumentative d’une thématique chère à l’auteur des Pensées, à savoir une réflexion sur la justice. Ces trois textes examinent en effet les relations entre avoir, savoir, pouvoir d’un côté et l’ontologie de l’autre dans une perspective chrétienne.
Premier discours
L’auteur commence son propos par une fable ou plus exactement, selon le modèle évangélique, une parabole. Pascal, à l’école de Jésus de Nazareth, recourt en effet à un récit allégorique intemporel pour développer un enseignement moral et métaphysique à l’intention d’un jeune noble2 indiqué par la présence du « votre », probablement le fils aîné du duc de Luynes, futur duc de Chevreuse. Cette « image » doit permettre d’« entrer dans la véritable connaissance de [la] condition » humaine des Grands.
À plusieurs reprises, dans les Pensées, Pascal s’est servi de la fonction royale pour exposer le paradoxe fondamental de la nature humaine, alliance de grandeur et de misère. Le récit initial reprend ces éléments antithétiques : l’homme connaît le malheur d’être « jeté par la tempête dans une île inconnue ». Le péché originel l’a chassé du jardin d’Éden. Pourtant il a gardé son titre de roi de la création conformément à l’injonction divine : « remplissez la terre et dominez-la. » Genèse 1 28
Cependant le propos de Pascal consiste ici à limiter cette expérience de la condition humaine à un cas particulier, celui du naufragé appelé à occuper indûment le trône sur l’île où il a échoué. Il vise l’exercice du pouvoir en tant que tel. Ayant choisi de taire la supercherie, le nouveau souverain vit un perpétuel dédoublement entre le for interne correspondant au jugement de son acte selon sa conscience personnelle, et le for externe qui apprécierait son acte par rapport à des critères objectifs extérieurs. Le danger mortel pour l’âme de ce prince serait alors d’oublier « le hasard qui l’avait mis en place où il était ».
Le projet de Pascal s’inscrit dans une perspective surnaturelle de salut, il peut être lu selon un axe politique, celui de considérations concernant l’exercice du pouvoir, mais aussi selon une application plus générale à l’histoire personnelle de chacun : diminué par la faute originelle, l’homme peut-il retrouver la plénitude de son statut antérieur ?
Dans son discours politique, Pascal ne remet pas en cause la nécessité du pouvoir. Bien au contraire, il reconnaît l’inquiétude de ce peuple qui a perdu son roi et n’a de cesse qu’il ne s’en soit choisi un autre. Cette exigence du bien commun pour garantir ordre et paix au corps social excuse sans doute en partie le silence mensonger de l’heureux élu. On voit poindre cependant chez Pascal le souci de séparer la personne et la fonction, de mettre fin aux tentatives d’idolâtrer le souverain, de confondre le pouvoir et la divinité comme dans le paganisme antique. La monarchie de droit divin ne saurait en aucune façon donner un quelconque privilège à celui qui l’exerce. Le monarque reste fondamentalement un homme pécheur comme les autres.
Pascal considère le pouvoir en moraliste. Avoir et pouvoir sont les fruits du « hasard ». Naissance ou élection ne confèrent aucun droit de propriété. Dans « sa condition naturelle », tout homme naît nu. Le savoir vient compléter la trilogie de la grandeur. Le monarque bien disposé sait que « ce royaume ne lui appart[ient] pas » et « il cach[e] cette dernière pensée ». Le savoir vient consolider l’avoir et le pouvoir en dissimulant leur origine véritable. La première conclusion qui en découle est que le respect dû au trône s’adresse à la fonction et non à la personne.
Ce qui s’applique au roi, Pascal l’étend par généralisation à tous les puissants. L’origine des « richesses » ne se situe pas dans un quelconque mérite, mais dans les héritages. La transmission du patrimoine selon le droit écrit ne lui confère aucun caractère acquis ou définitif. Pascal ne nie pas le droit de propriété, mais il n’en fait pas un absolu, seulement un droit de jouissance encadré par le législateur qui peut décider sa succession privée ou le retour « à la république » (c’est-à-dire à la chose publique ou intérêt général, au bien commun selon son sens étymologique).
Pascal distingue ainsi deux ordres, chacun légitime en soi, mais d’inégale valeur, et qui doivent donc être hiérarchisés. Le premier est dit « de nature », il correspond aux talents personnels mais évoque peut-être aussi ce que nous nommons aujourd’hui les droits de l’homme, droits universels et intangibles. Le second est appelé « d’un établissement humain », il est le fruit de la coutume, il peut varier d’un lieu à l’autre selon le « tour d’imagination [de] ceux qui ont fait les lois », expression à comprendre comme invention raisonnée selon les circonstances culturelles. Le second discours éclaire plus avant ces concepts.
En fait le droit de propriété est un attribut divin. Seul le créateur peut revendiquer l’entière possession de sa création. Mais dans sa sagesse, Dieu a voulu que l’homme puisse à son tour posséder avec mesure afin que ces biens participent à l’accomplissement de sa nature. Il a voulu que l’homme puisse exercer librement sa vertu dans la gestion des biens terrestres et qu’il concoure au bien commun par leur partage. Les « lois » sont l’expression imparfaite de cet exercice raisonné de la justice afin d’éviter les violences du rapt, et par là-même assurer la paix sociale. C’est pourquoi « quand ces lois sont une fois établies, il est injuste de les violer. » En effet le plus grand des maux pour l’humanité est celui de la guerre civile, du retour à la barbarie. Ainsi vaut-il mieux des lois imparfaites que l’absence de loi. La loi, même grossière, reste un frein pour les désordres du désir et de l’instinct.
Le contrat social ne doit cependant pas être confisqué par les riches. La loi n’est pas là pour renforcer le pouvoir des plus forts. En effet tout homme est égal en nature : « Votre âme et votre corps sont d’eux-mêmes indifférents à l’état de batelier ou à celui de duc, et il n’y a nul lien naturel qui les attache à une condition plutôt qu’à une autre. »
En conséquence, les puissants qui n’ont nul mérite à posséder doivent rester conscients de leur véritable nature en leur for interne et se rappeler qu’ils sont frappés par l’indignité de la faute originelle qu’ils partagent avec le reste de l’humanité. Ils ne doivent pas mésuser de leur pouvoir ou de leur savoir pour tromper le peuple. La leçon est morale : le philosophe chrétien appelle dans un premier temps à la modération et à l’humilité. La raison dit à l’homme de bonne volonté que la justice du comportement n’est pas issue du droit ; la religion affirme en plus que la justice résulte de la conscience morale éclairée par la foi. En effet la justice est moins la conformité à ce que chacun est en droit d’attendre. Elle est surtout la justification que Dieu met dans l’âme par sa grâce. La justice pascalienne est une affaire de salut. Le propos devient insistant : « Que cet avis est important ! ». À la suite du Siracide3, Pascal sait que les biens terrestres sont périssables, que leur désir désordonné conduit à « la violence » et à « la vanité » au péril de l’âme immortelle4. En effet les riches sont plus exposés au divertissement5 : « Il faut s’oublier soi-même pour cela, et croire qu’on a quelque excellence réelle au-dessus d’eux, en quoi consiste cette illusion que je tâche de vous découvrir. » La possession désordonnée des biens conduit les puissants à oublier leur vraie nature, elle leur donne une fausse sécurité qui les éloigne de la nécessaire ascèse, elle constitue en outre un scandale public. Pascal évoque en effet la responsabilité morale des Grands dans la chute du « peuple qui [les] admire » et qui, en enviant leur sort, est conduit à négliger sa propre sanctification.
Second discours
L’objet du second discours est d’exposer une saine conception de la justice distributive, celle par laquelle on adjuge à chacun ce qui lui appartient. Pascal s’adresse toujours à ce jeune noble ; « Il est bon, Monsieur, que vous sachiez ce que l’on vous doit, afin que vous ne prétendiez pas exiger des hommes ce qui ne vous est pas dû ; car c’est une injustice visible : et cependant elle est fort commune à ceux de votre condition, parce qu’ils en ignorent la nature. » Nous pouvons remarquer que Pascal utilise les premiers mots de la préface au canon de la messe : « Dignum et justum est […] » que l’on peut traduire par « il est juste et bon […] » Si cette réminiscence est avérée, le lecteur comprend que le but du moraliste est de faire saisir que les grandeurs d’établissement et de nature ne se confondent qu’en Dieu seul. Dans l’ordre humain, elles doivent être séparées sous peine de conduire au danger mortel des illusions de l’orgueil diabolique.
Le second discours développe donc deux notions entraperçues dans le premier. Pascal distingue les « grandeurs d’établissement » et les « grandeurs naturelles ». Il convient d’abord de préciser le sens de la première expression comme puissance, pouvoir, dignités, honneurs, magnificence, alors que la seconde renvoie plutôt à l’élévation et à la noblesse morales. Pascal joue de la polysémie pour continuer à opposer les fors externe et interne. En effet ces deux formes de la grandeur ne s’imposent pas de la même manière : si la première relève de l’apparence, du décorum, si elle impressionne l’imagination, la seconde appartient à la constitution personnelle, elle est appréciée par la raison. L’une appelle le respect ; l’autre, l’estime.
« Les grandeurs naturelles » sont constitutives, elles appartiennent à la personne. Elles résident « dans des qualités réelles et effectives de l’âme ou du corps, qui rendent l’une ou l’autre plus estimable, comme les sciences, la lumière de l’esprit, la vertu, la santé, la force. » Deux remarques s’imposent cependant : en premier lieu, le lecteur pourrait s’étonner que Pascal mette sur un pied d’égalité le corps et l’esprit, la force brutale et la subtilité de l’intelligence. En effet si la force peut imposer le respect par asservissement, seul l’esprit peut appeler librement l’admiration. À ce moment de son argumentation, Pascal veut affirmer que nous sommes « propriétaires » de nos talents, mais non de nos biens terrestres. En second lieu, le philosophe chrétien ne fait aucune allusion au caractère gracieux de ces dons personnels et à la responsabilité morale qui en découle6.
Les « grandeurs d’établissement » relèvent de l’arbitraire, du contingent. Ce qui le prouve est bien la reconnaissance d’états opposés dans des sociétés diverses. Il faut quand même reconnaître que les exemples de Pascal constituent plutôt de fausses fenêtres7. En effet existe-t-il vraiment des régimes qui honorent les « roturiers8 » ou les « cadets » ? Admettons avec le moraliste que la société humaine ne saurait se passer d’une hiérarchie qui s’inscrit dans une diversité de régimes selon les lieux et les cultures. Le lecteur attentif aperçoit alors le fameux paradoxe pascalien : Comment des réalisations si contradictoires peuvent-elles émaner d’une même « raison » ? Comment justifier que « la chose était indifférente avant l’établissement : après l’établissement elle devient juste, parce qu’il est injuste de la troubler » ?
La justice consiste donc selon Pascal à rendre à chaque ordre la disposition interne qui lui est due. À la « grandeur d’établissement », nous devons un respect pour ses signes extérieurs de puissance, mais avec, « selon la raison, […] une reconnaissance intérieure de la justice de cet ordre ». Le paradoxe réside bien dans cette soumission intérieure alors que l’esprit éclairé sait que le puissant n’a aucun droit de nature sur le pouvoir qu’il exerce. Pascal ne justifie pas ce devoir. S’il existe des raisons de se soumettre à ce pouvoir arbitraire, elles sont à chercher ailleurs. Dans le paradigme pascalien, on pourrait en avancer trois : d’abord, l’homme est par nature, selon la tradition aristotélicienne, un « animal politique » ; ensuite, le royaume de France a subi, au temps de Pascal, les affres de la guerre civile sous les espèces de la Fronde ; enfin et le plus important reste la volonté divine. Ce dernier point résulte de la tradition scripturaire, notamment évangélique. « Rendez à César ce qui est de César, et à Dieu ce qui est de Dieu » écrit l’évangéliste Matthieu en 22 21. Il y a aussi cette fameuse réponse du Christ à Ponce-Pilate : « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais pas reçu d’en haut », Jean 19 11. Les Évangiles affirment l’autonomie et la légitimité du pouvoir politique. Ils ajoutent aussi qu’il doit être conçu comme un service, ce sera un des objets du troisième discours. Pascal n’examine donc pas la justice de la forme du gouvernement, seulement celle de son fondement.
Le philosophe poursuit son argumentation par des exemples croisés afin de démontrer l’injustice à confondre les diverses grandeurs. En effet mélanger les ordres de grandeurs est déraisonnable, frustrant, injurieux. Un titre de duc ne saurait appeler l’estime pour la personne s’il n’habille pas un « honnête homme ». En revanche, un noble scélérat ne perd pas pour autant le droit à être respecté en public, ce qui n’empêche nullement celui qui le salue de mépriser intérieurement la personne privée. Le plus grand géomètre du temps n’a aucun droit à une préséance sur ses pairs, il peut seulement prétendre à être admiré d’eux comme le meilleur. La leçon finale ramène au prince qui, s’il veut être estimé, doit montrer que sa personne intérieure est digne. Le géomètre sert en fait de repoussoir car le plus important pour Pascal est de montrer que le prince idéal est un Grand doublé d’un honnête homme.
Tout l’objet du second discours est donc une entreprise de démythification du secret de la grandeur : « Le peuple […] croit que la noblesse est une grandeur réelle, et il considère presque les grands comme étant d’une autre nature que les autres ».
Troisième discours
Le troisième discours est un point d’orgue dans la réflexion pascalienne car il est le plus théologique. Il élève la pensée vers les fins dernières, il invite à contempler Dieu dans sa nature profonde : « Deus caritas est », « Dieu est amour » selon la Première Lettre de saint Jean.
Pascal part donc de la cité terrestre, qui est le royaume de la « concupiscence ». C’est un terme de dogmatique qui désigne l’inclination naturelle à désirer la jouissance des biens sensibles et surtout des plaisirs charnels. Sous la plume de Pascal, il désigne ici la tentative d’accaparer les biens terrestres. Le philosophe se montre très réaliste quand il décrypte les relations d’intérêt qui unissent le « grand seigneur » à ses fidèles. Le moraliste dissipe les illusions de son élève en lui donnant une leçon d’humilité cynique : le Grand n’est pas fréquenté pour sa gloire ou sa personne, seulement pour son entregent ou ses richesses. Le Grand est donc un « roi de concupiscence. C’est la concupiscence qui fait [sa] force, c’est-à-dire la possession des choses que la cupidité des hommes désire. » C’est donc finalement un roi des illusions ou une illusion de roi car il tire sa force de biens périssables, fruits du hasard, dont la possession est loin d’être pérenne.
Le philosophe oppose la cité terrestre au royaume de Dieu qui est « proprement le roi de la charité ». Ce royaume est implicitement celui des biens qui demeurent, biens spirituels faut-il préciser, celui de la communion des personnes, du partage, de la gratuité du don, de la surabondance de la grâce qui annihile la faute.
Pascal reprend la distinction des « grandeurs » pour approprier le comportement de son élève. La « grandeur d’établissement » ne peut recourir à la « force » issue de la « grandeur naturelle ». Le Grand doit se contenter de répondre aux « justes désirs » de ceux qui l’entourent, de partager ses biens terrestres, d’« être bienfaisant ». Là encore il faut faire preuve de discernement. À l’image du Père qui donne le pain quotidien9, le Grand doit au demandeur seulement ce qui lui est nécessaire. Par là il évite que les biens terrestres ne soient occasion de chute. Pascal pense sans doute aussi au conseil évangélique : « Et moi je vous dis : Faites-vous des amis avec ce maudit argent, et quand il viendra à vous manquer, eux vous accueilleront dans les demeures éternelles » Luc 16 8-9, traduction Bible des peuples. Cette première réponse demeure cependant imparfaite parce qu’elle n’engage pas la nature de la personne.
C’est pourquoi Pascal fait appel aussi à la « grandeur naturelle » seule capable de mettre sur le chemin du salut. « Ce que je vous dis ne va pas bien loin ; et si vous en demeurez là, vous ne laisserez pas de vous perdre ; mais au moins vous vous perdrez en honnête homme. » Relevons là une trace d’humour plutôt rare chez Pascal quand il aborde la métaphysique. Le salut demande d’abord l’exercice de la raison pour ne pas « se damne[r] si sottement », puis la réponse libre de la personne, son engagement dans le « royaume de charité où tous les sujets ne respirent que la charité, et ne désirent que les biens de la charité. » Pascal, en philosophe, s’arrête donc à la liberté d’indifférence à l’égard des biens matériels ; il laisse alors le soin aux prédicateurs et aux directeurs de conscience de dispenser enseignements ou conseils de vie évangélique pour mener plus avant les âmes dans la voie de la perfection, de la justice divine parfaite qui seule parachève l’équité par l’amour.
Conclusion
En dépit de leur vocabulaire typé, de leur contexte chrétien et monarchiste, ces textes restent d’actualité. Chacun des discours pourrait servir à l’homme de bonne volonté contemporain selon sa leçon principale :
- Le premier actualise le « connais-toi toi-même » socratique pour éviter la griserie et les illusions destructrices du pouvoir et des richesses.
- Le second restaure le respect dû aux personnes publiques, non en vertu de leurs mérites mais au nom de la fonction10, permettant au débat politique d’y gagner en élévation et en dignité.
- Le troisième est un appel raisonnable à la modération du désir de s’approprier, de consommer, de détruire des ressources, à l’engagement personnel au service du bien commun.
Le plus surprenant est leur rapport à la justice que nous assimilons aujourd’hui volontiers au seul pouvoir de faire droit à chacun, de récompenser et de punir. Pascal envisage le concept en son sens premier, celui de la règle de conformité au droit de chacun, de la volonté constante et perpétuelle de donner à chacun ce qui lui appartient. Il n’en oublie pas les perspectives théologiques implicites, celles de la justification que Dieu met dans l’âme par sa grâce. En moraliste chrétien, il utilise aussi le concept biblique d’observation exacte des devoirs religieux. Le juste est alors celui qui craint Dieu, celui qui obéit à ce que lui dicte sa conscience morale. La justice n’est plus simplement le recueil des droits et devoirs, mais elle s’élargit à la recherche du souverain bien, au chemin à emprunter pour parvenir au salut de l’âme. Elle n’est plus circonscrite au respect scrupuleux de la règle, elle s’accomplit dans l’ordre de la « charité » au point de rendre la règle inutile comme l’avait exprimé Augustin d’Hippone dans Dix traités sur l’épître de Saint-Jean aux Parthes : « Aime et fais ce que tu veux ».
Notes
1 Dans la préface qui précède le texte, Nicole écrit que Pascal voulait contribuer à « l’instruction d’un prince que l’on tâcherait d’élever de la manière la plus proportionnée à l’état où Dieu l’appelle, et la plus propre pour le rendre capable d’en remplir tous les devoirs et d’en éviter tous les dangers. » Aussi, Pascal n’ayant pu rédiger ces enseignements, Nicole a entrepris « d’écrire neuf ou dix ans après ce qu’il en a retenu. Or, quoique après un si long temps il ne puisse pas dire que ce soient les propres paroles dont M. Pascal se servit alors, néanmoins tout ce qu’il disait faisait une impression si vive sur l’esprit, qu’il n’était pas possible de l’oublier. Et ainsi il peut assurer que ce sont au moins ses pensées et ses sentiments. » ▲
2 Aujourd’hui on parlerait de personne en vue, d’homme dépositaire d’un pouvoir, de richesses… de quelqu’un d’enviable qui est l’objet d’articles dans la presse, qui est inscrit dans les registres mondains… ▲
3 « Ne tire pas vanité de l’habit que tu portes, ne sois pas orgueilleux parce que les gens t’honorent ; sais-tu ce que le Seigneur prépare sans qu’on le remarque ? Bien des dictateurs ont été renversés, et la couronne est allée à celui qu’on n’attendait pas. Beaucoup qui étaient puissants ont tout perdu, des gens dont tout le monde parlait sont tombés aux mains d’un nouveau venu. » Siracide 11 4-6, traduction Bible des peuples ▲
4 « Où est le bénéfice si l’on gagne le monde entier mais qu’on se détruit soi-même ? Avec quoi va-t-on racheter sa propre vie ? » Matthieu 16 26, traduction Bible des peuples ▲
5 « La littérature morale et religieuse évoquait le bon ou le mauvais usage des divertissements, autrement dit des plaisirs mondains, mais non du divertissement qui consiste pour l’homme dans le fait de se détourner (sens étymologique) d’un ennui quasi existentiel, de la pensée de sa condition. À ce thème entièrement neuf, Pascal consacra une liasse entière dans la partie de l’Apologie consacrée à l’étude de l’homme : il s’agissait là d’un exemple particulièrement significatif des « contrariétés » de la nature humaine. »
C. Puzin, Littérature – textes et documents, XVIIe siècle (coll. H. Mitterrand, Nathan, page 153) ▲
6 Voir la parabole des talents dans Matthieu 25 14-30 ▲
7 Est-ce à imputer à Nicole plutôt qu’à Pascal ? « Ceux qui font les antithèses en forçant les mots font comme ceux qui font de fausse fenêtres pour la symétrie. Leur règle n’est pas de parler juste mais de faire des figures justes. » Pensées Fragment 480 ▲
8 Qu’on ne prenne pas pour exemple le régime soviétique qui avait institué l’ordre de fer d’une nomenklatura. Toutes les révolutions aboutissent à la confiscation du pouvoir par une nouvelle classe dirigeante. ▲
9 Voir le « Notre Père » Matthieu 6 9-13 ▲
10 Par exemple, Pascal a montré la réponse à donner quand un quidam se permet une grossièreté à l’encontre du Président de la République. « C’est une sottise et une bassesse d’esprit que de leur refuser ces devoirs ». ▲
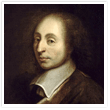 Pour entrer dans la véritable connaissance de votre condition, considérez-la dans cette image.
Pour entrer dans la véritable connaissance de votre condition, considérez-la dans cette image.