Romantisme
Le romantisme, apparu en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle et en France au début du XIXe siècle, est un mouvement littéraire et culturel européen qui a concerné tous les arts. Il s’oppose à la tradition classique et au rationalisme des Lumières, et vise à une libération de l’imagination et de la langue. Le romantisme privilégie notamment l’expression du moi et les thèmes de la nature et de l’amour.
Thèmes principaux et principes du romantisme
- la mélancolie, la nostalgie, les passions, le moi en souffrance (l’expression des sentiments personnels → lyrisme, élégie),
- la nature, les ruines, le goût pour la solitude, le désir de fuite, le voyage et le rêve,
- l’histoire,
- la spiritualité,
- la volonté de retrouver la liberté dans l’art : l’artiste romantique veut s’affranchir des règles contraignantes,
- l’engagement dans le combat politique,
- la recherche de la couleur locale, du pittoresque.
Les précurseurs du romantisme
- Rousseau (1712-1778) : La Nouvelle Héloïse (1761) et Les Rêveries du promeneur solitaire (1782)
- Madame de Staël (1766-1817)
- Chateaubriand (1768-1848) : voir, par exemple, le lyrisme dans Atala (1801) et René (1802), la nostalgie des paysages américains dans les Mémoires d’outre-tombe (1848).
Les grands auteurs romantiques
Poésie
Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859)
Élégies et Romances (1819)
Hugo (1802-1885)
Odes et ballades (1828)
Les Orientales (1829)
Les Feuilles d’automne (1831)
Les Voix intérieures (1837)
Les Rayons et les Ombres (1840)
Les Châtiments (1853)
Les Contemplations (1856)
La Légende des siècles (1859-1883)Lamartine (1790-1869)
Méditations poétiques (1820)
Musset (1810-1857)
Contes d’Espagne et d’Italie (1830)
Poésies (1830-1840)
Les Nuits (1835-1837)Nerval (1808-1855)
Les Chimères (1854)
Vigny (1797-1863)
Poèmes antiques et modernes (1826)
Les Destinées (1844-1864)
Théâtre
Hugo
Cromwell (1827)
Hernani (1830) : la première représentation de la pièce, le 25 février 1830, provoqua la fameuse « bataille d’Hernani », qui opposa d’une part les partisans du nouveau drame romantique et d’autre part les défenseurs de la conception classique du théâtre.
Ruy Blas (1838)
Les Burgraves (1843)Musset
Les Caprices de Marianne (1833)
Lorenzaccio (1834)Vigny
Chatterton (1835)
Roman
Chateaubriand (1768-1848)
René (1802)
Constant (1767-1830)
Adolphe (1816)
Hugo
Notre-Dame de Paris (1831)
Les Misérables (1862)
Quatrevingt-Treize (1874)Musset
La Confession d’un enfant du siècle (1836)
Sand (1804-1876)
Stendhal (1783-1842)
Vigny
Cinq-Mars (1826)
Quelques textes
Chateaubriand, René (1802)
Cette vie, qui m’avait d’abord enchanté, ne tarda pas à me devenir insupportable. Je me fatiguai de la répétition des mêmes scènes et des mêmes idées. Je me mis à sonder mon cœur, à me demander ce que je désirais. Je ne le savais pas ; mais je crus tout à coup que les bois me seraient délicieux. Me voilà soudain résolu d’achever, dans un exil champêtre, une carrière à peine commencée, et dans laquelle j’avais déjà dévoré des siècles.
J’embrassai ce projet avec l’ardeur que je mets à tous mes desseins ; je partis précipitamment pour m’ensevelir dans une chaumière, comme j’étais parti autrefois pour faire le tour du monde.
On m’accuse d’avoir des goûts inconstants, de ne pouvoir jouir longtemps de la même chimère, d’être la proie d’une imagination qui se hâte d’arriver au fond de mes plaisirs, comme si elle était accablée de leur durée ; on m’accuse de passer toujours le but que je puis atteindre : hélas ! je cherche seulement un bien inconnu, dont l’instinct me poursuit. Est-ce ma faute, si je trouve partout les bornes, si ce qui est fini n’a pour moi aucune valeur ? Cependant je sens que j’aime la monotonie des sentiments de la vie, et si j’avais encore la folie de croire au bonheur, je le chercherais dans l’habitude.
La solitude absolue, le spectacle de la nature, me plongèrent bientôt dans un état presque impossible à décrire. Sans parents, sans amis, pour ainsi dire seul sur la terre, n’ayant point encore aimé, j’étais accablé d’une surabondance de vie. Quelquefois je rougissais subitement, et je sentais couler dans mon cœur comme des ruisseaux d’une lave ardente ; quelquefois je poussais des cris involontaires, et la nuit était également troublée de mes songes et de mes veilles. II me manquait quelque chose pour remplir l’abîme de mon existence : je descendais dans la vallée, je m’élevais sur la montagne, appelant de toute la force de mes désirs l’idéal objet d’une flamme future ; je l’embrassais dans les vents ; je croyais l’entendre dans les gémissements du fleuve : tout était ce fantôme imaginaire, et les astres dans les cieux, et le principe même de vie dans l’univers.
Toutefois cet état de calme et de trouble, d’indigence et de richesse, n’était pas sans quelques charmes.Alphonse de Lamartine, Méditations poétiques (1820), « Le Vallon » (extrait)
Mon cœur, lassé de tout, même de l’espérance,
N’ira plus de ses vœux importuner le sort ;
Prêtez-moi seulement, vallon de mon enfance,
Un asile d’un jour pour attendre la mort.Voici l’étroit sentier de l’obscure vallée :
Du flanc de ces coteaux pendent des bois épais,
Qui, courbant sur mon front leur ombre entremêlée,
Me couvrent tout entier de silence et de paix.Là, deux ruisseaux cachés sous des ponts de verdure
Tracent en serpentant les contours du vallon ;
Ils mêlent un moment leur onde et leur murmure,
Et non loin de leur source ils se perdent sans nom.La source de mes jours comme eux s’est écoulée ;
Elle a passé sans bruit, sans nom et sans retour :
Mais leur onde est limpide, et mon âme troublée
N’aura pas réfléchi les clartés d’un beau jour. […]Victor Hugo, préface de Cromwell (1827)
Mettons le marteau dans les théories, les poétiques et les systèmes. Jetons bas ce vieux plâtrage qui masque la façade de l’art ! Il n’y a ni règles, ni modèles ; ou plutôt il n’y a d’autres règles que les lois générales de la nature qui planent sur l’art tout entier […].
Le théâtre est un point d’optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l’histoire, dans la vie, dans l’homme, tout doit et peut s’y réfléchir, mais sous la baguette magique de l’art.
Victor Hugo, Hernani (1830), acte I, scène 2
Doña Sol
Je vous suivrai.
Hernani
Parmi mes rudes compagnons ?
Proscrits dont le bourreau sait d’avance les noms,
Gens dont jamais le fer ni le cœur ne s’émousse,
Ayant tous quelque sang à venger qui les pousse ?
Vous viendrez commander ma bande, comme on dit ?
Car, vous ne savez pas, moi, je suis un bandit !
Quand tout me poursuivait dans toutes les Espagnes :
Seule, dans ses forêts, dans ses hautes montagnes,
Dans ses rocs où l’on n’est que de l’aigle aperçu,
La vieille Catalogne en mère m’a reçu.
Parmi ses montagnards, libres, pauvres et graves,
Je grandis, et demain, trois mille de ses braves,
Si ma voix dans leurs monts fait résonner ce cor,
Viendront… vous frissonnez, réfléchissez encor.
Me suivre dans les bois, dans les monts, sur les grèves,
Chez des hommes pareils aux démons de vos rêves ;
Soupçonner tout, les yeux, les voix, les pas, le bruit,
Dormir sur l’herbe, boire au torrent, et la nuit
Entendre, en allaitant quelque enfant qui s’éveille,
Les balles des mousquets siffler à votre oreille.
Être errante avec moi, proscrite, et, s’il le faut,
Me suivre où je suivrai mon père, — à l’échafaud.Doña Sol
Je vous suivrai.
Victor Hugo, Les Feuilles d’automne (1831)
Soleils couchants – VI
Le soleil s’est couché ce soir dans les nuées.
Demain viendra l’orage, et le soir, et la nuit ;
Puis l’aube, et ses clartés de vapeurs obstruées ;
Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s’enfuit !Tous ces jours passeront ; ils passeront en foule
Sur la face des mers, sur la face des monts,
Sur les fleuves d’argent, sur les forêts où roule
Comme un hymne confus des morts que nous aimons.Et la face des eaux, et le front des montagnes,
Ridés et non vieillis, et les bois toujours verts
S’iront rajeunissant ; le fleuve des campagnes
Prendra sans cesse aux monts le flot qu’il donne aux mers.Mais moi, sous chaque jour courbant plus bas ma tête,
Je passe, et, refroidi sous ce soleil joyeux,
Je m’en irai bientôt, au milieu de la fête,
Sans que rien manque au monde, immense et radieux !22 avril 1829.
Alfred de Musset, « Tristesse » (1840)
J’ai perdu ma force et ma vie,
Et mes amis et ma gaieté ;
J’ai perdu jusqu’à la fierté
Qui faisait croire à mon génie.Quand j’ai connu la Vérité,
J’ai cru que c’était une amie.
Quand je l’ai comprise et sentie,
J’en étais déjà dégoûté.Et pourtant elle est éternelle,
Et ceux qui se sont passés d’elle
Ici-bas ont tout ignoré.Dieu parle, — il faut qu’on lui réponde.
Le seul bien qui me reste au monde
Est d’avoir quelquefois pleuré.
L’adjectif « romantique »
L’adjectif « romantique » (de l’anglais romantic) a d’abord été employé au XVIIIe siècle pour qualifier des paysages pittoresques1, en concurrence avec l’adjectif romanesque. Au début du XIXe siècle, c’est Madame de Staël qui a introduit le terme en français (de l’allemand romantisch) pour désigner la « poésie née de la chevalerie et du christianisme »2. Les sens que nous connaissons aujourd’hui (« qui appartient au romantisme », « qui évoque les attitudes et les thèmes chers aux romantiques ») proviennent de l’allemand et de « l’influence anglaise sur la terminologie et la doctrine littéraire »3. Le mot « romantisme » est issu de cet adjectif. Quant au mot romanticisme, il a été employé par Stendhal jusqu’en 1824 pour désigner le mouvement romantique.
Le « mal du siècle » : le désenchantement d’une génération
L’expression « mal du siècle » désigne le malaise existentiel ressenti par la jeunesse romantique née au début du XIXe siècle. Au lendemain de la Révolution, la chute de l’Empire et la Restauration (1814-1830) ont mis fin aux rêves de grandeur des écrivains romantiques qui, déçus par leur époque et inquiets pour l’avenir, ont « le sentiment d’appartenir à une génération sacrifiée et condamnée à l’ennui, au désœuvrement d’une vie désormais privée de finalité »4.
Du vague des Passions
Il reste à parler d’un état de l’âme qui, ce nous semble, n’a pas encore été bien observé : c’est celui qui précède le développement des passions, lorsque nos facultés, jeunes, actives, entières, mais renfermées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes, sans but et sans objet. Plus les peuples avancent en civilisation, plus cet état du vague des passions augmente ; car il arrive alors une chose fort triste : le grand nombre d’exemples qu’on a sous les yeux, la multitude de livres qui traitent de l’homme et de ses sentiments rendent habile sans expérience. On est détrompé sans avoir joui ; il reste encore des désirs, et l’on n’a plus d’illusions. L’imagination est riche, abondante et merveilleuse ; l’existence pauvre, sèche et désenchantée. On habite avec un cœur plein un monde vide, et sans avoir usé de rien on est désabusé de tout.
L’amertume que cet état de l’âme répand sur la vie est incroyable ; le cœur se retourne et se replie en cent manières, pour employer des forces qu’il sent lui être inutiles. Les anciens ont peu connu cette inquiétude secrète, cette aigreur des passions étouffées qui fermentent toutes ensemble : une grande existence politique, les jeux du gymnase et du Champ-de-Mars, les affaires du Forum et de la place publique, remplissaient leurs moments et ne laissaient aucune place aux ennuis du cœur.Chateaubriand, Génie du christianisme (1802), II, III, chapitre 9.
Trois éléments partageaient donc la vie qui s’offrait alors aux jeunes gens : derrière eux un passé à jamais détruit, s’agitant encore sur ses ruines, avec tous les fossiles des siècles de l’absolutisme ; devant eux l’aurore d’un immense horizon, les premières clartés de l’avenir ; et entre ces deux mondes… quelque chose de semblable à l’Océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, traversée de temps en temps par quelque blanche voile lointaine ou par quelque navire soufflant une lourde vapeur ; le siècle présent, en un mot, qui sépare le passé de l’avenir, qui n’est ni l’un ni l’autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l’on ne sait, à chaque pas qu’on fait, si l’on marche sur une semence ou sur un débris.
Voilà dans quel chaos il fallut choisir alors ; voilà ce qui se présentait à des enfants pleins de force et d’audace, fils de l’Empire et petits-fils de la Révolution. […]
Toute la maladie du siècle présent vient de deux causes ; le peuple qui a passé par 93 et par 1814 porte au cœur deux blessures. Tout ce qui était n’est plus ; tout ce qui sera n’est pas encore. Ne cherchez pas ailleurs le secret de nos maux.Musset, La Confession d’un enfant du siècle (1836), I, chapitre 2.
Notes
1 « Il se dit ordinairement des lieux, des paysages, qui rappellent à l’imagination les descriptions des poèmes et des romans. » (Dictionnaire de l’Académie française, 5e édition, 1798)
2 Madame de Staël (1766-1817), De l’Allemagne (1813), II, 11.
3 Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert.
4 I. et Y. Ansel, Le romantisme, Ellipses, page 52.
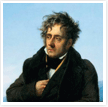 Cette vie, qui m’avait d’abord enchanté, ne tarda pas à me devenir insupportable. Je me fatiguai de la répétition des mêmes scènes et des mêmes idées. Je me mis à sonder mon cœur, à me demander ce que je désirais. Je ne le savais pas ; mais je crus tout à coup que les bois me seraient délicieux. Me voilà soudain résolu d’achever, dans un exil champêtre, une carrière à peine commencée, et dans laquelle j’avais déjà dévoré des siècles.
Cette vie, qui m’avait d’abord enchanté, ne tarda pas à me devenir insupportable. Je me fatiguai de la répétition des mêmes scènes et des mêmes idées. Je me mis à sonder mon cœur, à me demander ce que je désirais. Je ne le savais pas ; mais je crus tout à coup que les bois me seraient délicieux. Me voilà soudain résolu d’achever, dans un exil champêtre, une carrière à peine commencée, et dans laquelle j’avais déjà dévoré des siècles.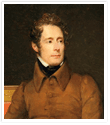 Mon cœur, lassé de tout, même de l’espérance,
Mon cœur, lassé de tout, même de l’espérance,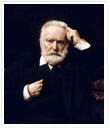 Le soleil s’est couché ce soir dans les nuées.
Le soleil s’est couché ce soir dans les nuées. J’ai perdu ma force et ma vie,
J’ai perdu ma force et ma vie,