Marivaux (1688-1763), L’Île des esclaves (1725)
L’utopie au service de la comédie sociale
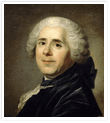 Cette comédie en un acte et en prose de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux a été créée par les comédiens italiens en 1725 et publiée à Paris la même année. Beaumarchais a exprimé toute son estime pour cette courte comédie en la qualifiant de « petit bijou ». Cette pièce en onze scènes est à la fois une satire sociale et un regard de moraliste sur l’homme. Marivaux y renouvelle le canevas et les lazzis de la commedia dell’arte pour faire réfléchir les spectateurs à de nouveaux rapports sociaux au moyen de l’utopie.
Cette comédie en un acte et en prose de Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux a été créée par les comédiens italiens en 1725 et publiée à Paris la même année. Beaumarchais a exprimé toute son estime pour cette courte comédie en la qualifiant de « petit bijou ». Cette pièce en onze scènes est à la fois une satire sociale et un regard de moraliste sur l’homme. Marivaux y renouvelle le canevas et les lazzis de la commedia dell’arte pour faire réfléchir les spectateurs à de nouveaux rapports sociaux au moyen de l’utopie.
Réutilisant le couple traditionnel maître-valet, Marivaux se livre à deux exercices concomitants : le laboratoire utopique et la comédie de mœurs. Il joue également sur deux registres, le comique et le pathétique. Ces dualités assumées donnent à la pièce son caractère onirique qui permet de mieux faire accepter la critique très novatrice pour l’époque. En effet Marivaux aborde l’aliénation sociale et l’exclusion. Nous pouvons imaginer le choc que durent vivre les spectateurs d’alors devant cette inacceptable invitation à échanger les rôles sociaux, alors même qu’ils refusaient la présence des domestiques en livrée dans l’enceinte théâtrale.
- Résumé de l’œuvre
- Le contexte
- Le lieu utopique
- Castigat ridendo mores
- Une « bergerie révolutionnaire » ?
- Une comédie du siècle des Lumières commençant
Résumé de l’œuvre
La farce
Scène 1 : À la suite d’une fortune de mer, Iphicrate, noble Athénien, et son domestique Arlequin échouent sur une île qui se trouve être le refuge d’anciens esclaves révoltés. En ces lieux, les maîtres sont voués à devenir les serviteurs de leurs anciens laquais. À cette nouvelle, Arlequin se montre insolent, tutoie son seigneur et refuse de lui obéir, tandis qu’Iphicrate se lamente sur son sort et veut punir les écarts de son valet par un coup d’épée.
Scène 2 : Survient Trivelin qui fait désarmer Iphicrate. Le maître des lieux apprend aux nouveaux arrivants quels sont les lois et le projet de l’île. Cette terre est destinée à humaniser les anciens maîtres. En leur faisant revêtir la condition servile, elle leur donne l’occasion de prendre conscience des avanies qu’ils ont fait subir à leur domesticité. Si au bout de la période probatoire de trois ans qui s’ensuit, les nouveaux seigneurs sont contents de leurs valets et servantes, ces derniers sont libérés et retrouvent leurs privilèges.
La “grande comédie”
Scène 3 : Après avoir procédé à l’échange des patronymes pour le couple féminin, Euphrosine l’aristocrate et Cléanthis la servante, Trivelin demande aux jeunes femmes de se livrer à l’épreuve des portraits. L’ancienne domestique va brosser une peinture peu flatteuse de sa maîtresse.
Scène 4 : Euphrosine, touchée dans son amour-propre, est révoltée par l’impertinence de sa soubrette. Trivelin lui demande si le portrait était fidèle. La jeune noble joue sur les mots, voudrait atténuer l’acidité de la critique, puis finalement convient de la justesse de la satire.
Scène 5 : Iphicrate, à son tour, doit se soumettre aux lazzis de son valet. Lui aussi a du mal à admettre la sévérité des remarques acérées.
Scène 6 : Arlequin et Cléanthis singent les conversations galantes de leurs maîtres mais n’en tirent pas tout le plaisir souhaité. Pour éprouver un peu plus les avantages de leur nouvelle situation, Arlequin imagine que chacun courtisera son ancien seigneur.
La comédie larmoyante
Scène 7 : Cléanthis ordonne donc à Euphrosine de céder à l’amour d’Arlequin, meilleur parti que les anciens amants de sa maîtresse.
Scène 8 : Arlequin se lance maladroitement dans la conquête d’Euphrosine. Son entreprise déclenche les pleurs et la plainte de la jeune femme qui se voit accablée par le sort. Arlequin, ébranlé par la souffrance d’Euphrosine, en reste coi.
Scène 9 : Il se trouve ensuite en butte aux reproches de son ancien maître qui s’offusque de l’ingratitude de son valet. Arlequin, qui entend à plusieurs reprises des protestations d’amitié dans la bouche de son maître, est ému aux larmes. Il lui pardonne, reconnaît ses propres torts. À son tour Iphicrate fait grâce. Arlequin décide illico de retourner à sa condition de serviteur.
Scène 10 : Cléanthis est à son tour touchée par la générosité d’Arlequin. Iphicrate tente de convaincre Euphrosine de la sincérité des serviteurs. Elle est gagnée par l’attendrissement ambiant et reconnaît son injustice à l’encontre de sa servante.
Scène 11 : Trivelin vient conclure cette réconciliation générale. La vocation de l’île est bien vertueuse. Elle doit tout autant corriger les maîtres de leur dureté de cœur qu’apprendre la magnanimité aux serviteurs. Chacun ayant médité sur le hasard des conditions, chacun s’étant converti à la sagesse et à la bienveillance peut repartir vers Athènes réconcilié avec son semblable.
Le contexte
Artistique
Ces thèmes de l’île et du naufrage sont à la mode dans les années 1720. Qu’on en juge par la peinture du Pèlerinage à l’île de Cythère de Watteau, la publication du Robinson Crusoé de Defoe, des Voyages de Gulliver de Swift.
Philosophique
Marivaux reprend à la scène la tradition du roman utopique en vogue. Cette réflexion sociale lui tient tant à cœur qu’elle donnera deux autres pièces : L’Île de la Raison en 1727 et La Colonie en 1729.
L’île des esclaves exploite aussi le thème des Saturnales, fêtes de la Rome antique où, pendant un temps très court, les esclaves étaient libérés de leur servitude et changeaient de rôle avec leurs maîtres. Cette tradition s’est perpétuée dans le carnaval qui permet, un court moment, de lever les interdits communautaires afin de libérer dans l’anonymat les frustrations dommageables à l’ordre social.
Ainsi, dans L’île des esclaves, Marivaux réunit-il des traditions populaire et savante pour estomper l’acidité de sa critique sociale au moment où Les Lettres persanes de Montesquieu expriment une tout autre virulence sur d’autres aspects de la société française et son mode de gouvernement.
Social
Le terme d’esclave ne renvoie pas seulement à l’Antiquité mais à des réalités contemporaines bien connues des spectateurs, comme le commerce du « bois d’ébène ». Les personnes présentes savaient que les échanges triangulaires entre la France, l’Afrique et l’Amérique avaient fondé de solides fortunes qui ne voulaient pas être ébranlées.
Aussi, même avec l’excuse du mythe, appeler esclavage l’état de domesticité devait-il heurter les esprits de l’époque. C’est sans doute pourquoi Marivaux a recouru à la comédie et à la caricature afin que le spectateur ne se sentît pas trop menacé dans ses privilèges.
Le lieu utopique
Pour estomper un peu la vigueur de son propos, Marivaux a choisi non seulement le comique de situation du monde à l’envers, mais encore de placer sa critique dans un cadre utopique.
D’une part, l’utopie peut prendre corps grâce à l’éloignement dans le temps. Elle renvoie l’action dans un passé indistinct, celui de l’Athènes antique. D’autre part, dans la lignée de l’Utopia de Thomas More, le lieu prédisposé à l’accueillir est l’île. Isolée pour permettre que se développe une société en marge, mais non totalement inaccessible afin qu’elle puisse s’adjoindre de temps à autre des visiteurs étrangers, l’île constitue le laboratoire idéal qui permet de tester de nouveaux rapports sociaux. Elle prend même des allures de clinique pour restaurer les liens humains abîmés par l’indifférence, le mépris ou l’innocente cruauté. Ce lieu clos est proposé à l’observation du spectateur guidé par le seigneur des lieux, Trivelin. Ce maître de cérémonie est à la fois un expérimentateur, un pédagogue, un analyste, un thérapeute, le garant de la règle, un juge ; il possède plusieurs attributs de la divinité : l’omnipotence, la sagesse, l’omniscience, l’équité et la bonté paternelle. Tout lui est soumis, mais lui-même fait appel à l’adhésion libre de ses hôtes du moment. Tout ce qui pourrait rappeler la coercition, en particulier les anciens esclaves devenus seigneurs, apparaît seulement au début de la scène 2 pour mettre en place l’inversion des états de vie voulue par la constitution de l’île.
Marivaux a donc choisi de ne garder que deux couples symétriques et opposés, reprenant une constante de la tragédie classique : le personnage noble et son confident, devenu sous l’influence de la comédie, maître et serviteur. Ces quatre personnages, avec en leur centre le maître de cérémonie, prennent des allures de carré magique. De même, la détention qui est censée durer plusieurs mois se déroule en fait dans le temps très concentré de la représentation. Marivaux utilise à plein le lieu focal de la scène et l’épuration extrême de la convention théâtrale. Avec si peu de personnages et une intrigue minimaliste, il invite le spectateur à s’intéresser à l’essentiel : les variations du sentiment et du jugement quand surviennent les aléas du sort. Marivaux utilise donc les possibilités de l’utopie pour faire œuvre de moraliste. Avec lui, la comédie devient ici une épure rigoureuse, une forme simplifiée en même temps qu’une correction des mœurs par le rire libérateur.
Castigat ridendo mores
Dans cette forme utilisant l’esthétique de la brièveté et la virtuosité du retournement, Marivaux reprend les ambitions de la « grande comédie » qui, par le rire, prétendait instruire le public et le convertir aux valeurs de la sincérité et de la tolérance. Cet aspect est manifeste dans la deuxième partie de la pièce, l’épreuve des portraits : « Il est nécessaire que vous m’en donniez un portrait, qui se doit faire devant la personne qu’on peint, afin qu’elle se connaisse, qu’elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu’elle se corrige. »
Au cours de cet examen satirique, Marivaux établit le relevé des défauts caractéristiques tant des maîtres que des valets.
Les reproches faits aux maîtres
La paresse et la mondanité
Marivaux reproche aux aristocrates de mener une existence futile, dépensière, improductive. Leur peur de déchoir en exerçant une activité lucrative les conduit à l’inutilité sociale, à une forme de parasitisme condamnable. Aussi n’est-il pas étonnant d’entendre Trivelin admonester les futurs maîtres en ces termes : « Je vous apprends, au reste, que vous avez huit jours à vous réjouir du changement de votre état; après quoi l’on vous donnera, comme à tout le monde, une occupation convenable. »
Ces nobles sont frivoles. Euphrosine est « vaine minaudière et coquette ». Elle mène une existence superficielle dans les salons où la principale occupation est de séduire. Iphicrate est tout aussi vain, il dissipe son temps et son argent dans la conquête de jeunes beautés.
Cette vie galante est épinglée par la critique des petits maîtres et de leur fausseté. Cléanthis en brosse un portrait sans complaisance : « Il ne vous fera pas de révérences penchées ; vous ne lui trouverez point de contenance ridicule, d’airs évaporés : ce n’est point une tête légère, un petit badin, un petit perfide, un joli volage, un aimable indiscret ; ce n’est point tout cela ; ces grâces-là lui manquent à la vérité ; ce n’est qu’un homme franc, qu’un homme simple dans ses manières, qui n’a pas l’esprit de se donner des airs ; qui vous dira qu’il vous aime, seulement parce que cela sera vrai ; enfin ce n’est qu’un bon cœur, voilà tout ; et cela est fâcheux, cela ne pique point. »
L’orgueil
Les maîtres sont critiqués pour leur arrogance et leur mépris. Trivelin rappelle à Arlequin de ne pas tomber dans ce travers : « Souvenez-vous en prenant son nom, mon cher ami, qu’on vous le donne bien moins pour réjouir votre vanité, que pour le corriger de son orgueil. » L’attribut de ce pouvoir masculin impudent est l’épée. Marivaux semble vouloir critiquer la noblesse d’épée plutôt que la noblesse de robe plus affairée, plus policée et donc plus proche de ses aspirations.
Cette suffisance liée à son apparent pouvoir s’exerce dans deux domaines : l’aristocratie tutoie ses domestiques, alors que l’ancien esclave Trivelin marque son respect en vouvoyant tout le monde. Pis, le maître marque sa domination en dénommant sa domesticité comme bon lui semble. Marivaux insiste particulièrement sur cet usage. Le valet n’a pas de nom propre. Si le noble peut se rattacher à une lignée par son patronyme, le valet est en quelque sorte la propriété de son maître qui se l’approprie en le nommant par un sobriquet, comme un animal domestique :
Trivelin. — Comment vous appelez-vous ?
Arlequin. — Est-ce mon nom que vous demandez ?
Trivelin. — Oui vraiment.
Arlequin. — Je n’en ai point, mon camarade.
Trivelin. — Quoi donc, vous n’en avez pas ?
Arlequin. — Non, mon camarade ; je n’ai que des sobriquets qu’il m’a donnés ; il m’appelle quelquefois Arlequin, quelquefois Hé.
Trivelin. — Hé ! Le terme est sans façon ; je reconnais ces Messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s’appelle-t-il ?
Arlequin. — Oh, diantre ! Il s’appelle par un nom, lui ; c’est le seigneur Iphicrate.(Scène 2)Cléanthis. — J’ai aussi des surnoms ; vous plaît-il de les savoir ?
Trivelin. — Oui-da. Et quels sont-ils ?
Cléanthis. — J’en ai une liste : Sotte, Ridicule, Bête, Butorde, Imbécile, et cætera.(Scène 3)
Le valet fait partie de la suite du maître, il lui est nécessaire pour paraître. Cléanthis pose la question profonde : « pouvons-nous être sans eux ? c’est notre suite ». Sans valet, point de maître digne de ce nom.
La colère
Un autre défaut et non des moindres est la colère. Les maîtres y recourent volontiers quand ils sont contrariés. Elle est ensuite l’expression de leur peur.
Ainsi le maître, homme ou femme, injurie-t-il son serviteur. Seul le maître masculin se livre à des voies de fait sur son domestique. Le maître donne des coups. « Il demande à parler à mon dos » se plaint Arlequin en une cocasse synecdoque. Le seigneur pratique les châtiments corporels. Ailleurs il est fait allusion aux « étrivières » réservées aux animaux de selle.
L’abus de pouvoir masculin
L’inversion des rôles ne pose de prime abord aucune difficulté pour la relation amoureuse entre seigneur et servante. Ce caprice de maître paraît valorisant pour la jeune domestique désirée et distinguée par un homme de la classe supérieure. Il n’en va pas de même pour le commerce galant entre la maîtresse et le serviteur que la bienséance réprouve car il est suspecté de déchéance. Cléanthis est donc obligée de solliciter Arlequin pour qu’il ordonne à son valet Iphicrate de courtiser une jeune femme noble.
Marivaux guide subtilement l’attention sur l’horreur des amours ancillaires en tirant parti de l’échange des rôles. Cette convoitise désordonnée du maître est censée flatter la destinatrice élevée de sa situation subalterne par le regard concupiscent qui s’abaisse sur elle. Et pourtant qu’en est-il vraiment quand l’objet du désir seigneurial refuse cette promotion ? Arlequin, par mimétisme capricieux, a décidé de jouer en allant conter fleurette à Euphrosine. La servante sans importance devrait accepter l’intérêt du maître pour elle. Or il se trouve que la jeune femme est une personne distinguée, sensible, révulsée par l’entreprise d’Arlequin qui la souille. Le spectateur ne peut qu’être révolté par l’abus de situation dominante vécu comme un viol. Le maître qui impose son désir reste un goujat criminel. Écoutons plus attentivement la plainte d’Euphrosine : « Ne persécute point une infortunée, parce que tu peux la persécuter impunément. Vois l’extrémité où je suis réduite ; et si tu n’as point d’égard au rang que je tenais dans le monde, à ma naissance, à mon éducation, du moins que mes disgrâces, que mon esclavage, que ma douleur t’attendrissent. Tu peux ici m’outrager autant que tu le voudras ; je suis sans asile et sans défense ; je n’ai que mon désespoir pour tout secours, j’ai besoin de la compassion de tout le monde, de la tienne même, Arlequin ; voilà l’état où je suis ; ne le trouves-tu pas assez misérable ? Tu es devenu libre et heureux, cela doit-il te rendre méchant ? »
Les reproches faits aux serviteurs
Les défauts traditionnels
Marivaux, avec beaucoup d’habileté, n’a pas dépeint un monde simpliste réservant ses critiques à la seule société aristocratique. Les valets ont aussi leurs défauts. Marivaux a puisé dans la tradition.
Cléanthis est bavarde, fine mouche et piquante. Marivaux utilise à son encontre le comique de la boîte mécanique remontée que l’on ne parvient plus à arrêter.
Arlequin boit plus que de raison. Il s’exprime de manière boursouflée lorsqu’il veut imiter le langage des maîtres.
L’envie
Plus original est le désir des domestiques de ressembler à leurs maîtres dans ce qu’ils ont de plus enviable, la présence qu’ils dégagent. « Arlequin. — Voilà ce que c’est, tombez amoureuse d’Arlequin, et moi de votre suivante. Nous sommes assez forts pour soutenir cela. »
Plus loin, ils singent les conversations galantes de leurs maîtres : « Nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes plus sages. » Leur perspicacité ne les empêche pourtant pas de vouloir se comporter comme eux.
La vis comica
C’est donc par le rire que va s’opérer la prise de conscience salutaire, puis la nécessaire correction des travers. En ce domaine, Arlequin représente essentiellement la force dénonciatrice et éducatrice de la satire.
Cléanthis. — Seigneur Iphicrate, peut-on vous demander de quoi vous riez ?
Arlequin. — Je ris de mon Arlequin qui a confessé qu’il était un ridicule.
Marivaux reprend à son compte, dans le portrait, la vigueur didactique des exempla que les prédicateurs proposaient aux fidèles pour leur édification ou leur dissuasion.
Iphicrate. — Dites plutôt : quel exemple pour nous, Madame, vous m’en voyez pénétré.
Cléanthis. — Ah ! vraiment, nous y voilà, avec vos beaux exemples.
Cependant Arlequin, malgré ses défauts, reste capable d’émotion. Il n’est pas rancunier. Dans le fond, il est demeuré bon. Grâce à cette part d’innocence préservée en lui, Arlequin va pouvoir s’amender et permettre la conversion autour de lui. Son rire ne va pas exclure. Tempéré par son humanité latente, il permet juste de décaper l’amour-propre pour révéler la nature profonde des êtres.
Une « bergerie révolutionnaire » ?1
Cette comédie, pour nouveaux que soient son sujet et sa tonalité, n’apparaît jamais comme une tentative de prise du pouvoir. Elle n’est jamais une contestation explicite de l’ordre établi.
Marivaux utilise cette intrigue comme un laboratoire comique. Que se passerait-il si les rôles étaient renversés ? si c’était les valets qui commandaient ? si les préjugés liés à l’appartenance à une classe sociale ne protégeaient plus ceux qui les professaient ?…
Il s’agit donc moins d’une révolution que d’une variation comique sur le thème de l’échange temporaire, ce qui n’empêche pas Marivaux de donner au passage une leçon de relativité.
Marivaux nous livre plutôt une vision réformatrice d’inspiration chrétienne fondée sur
- l’égalité fondamentale entre tous les êtres humains, avec une ouverture sur la fraternité2,
- un appel à la raison plutôt qu’à la révolte,
- un appel à la conversion du cœur,
- un discernement sur l’origine des désordres sociaux,
- une soumission aux décrets de la Providence3,
- et plus profondément la vertu de progrès du pardon4.
Le pardon occupe les trois dernières scènes. C’est par lui que se débloque une situation compromise. Il contribue puissamment à la brièveté de la pièce par le retournement brusque qu’il permet. Résultat de l’apitoiement du cœur, il est l’ennemi de la revanche. Permettant à chacun de reconnaître ses torts, il désarme l’adversaire. Il veut oublier l’offense. Il est contagieux, il appelle la réciproque entre esprits généreux. Le pardon est le régulateur social idéal : il procure la paix et le bonheur. Mais le pardon ne doit pas conduire à la suffisance ni à un quelconque esprit de supériorité. Pour être parfait, le pardon doit s’accompagner d’humilité. Ces caractéristiques le rattachent clairement à la pensée chrétienne.
En ce sens, Marivaux est très éloigné des prises de position futures de Voltaire ou de Beaumarchais. Les spectateurs du temps ont-ils su saisir la profondeur prophétique de l’avertissement quant aux dangers d’une société fondée sur l’injustice et le mépris ? On peut penser que l’inscription de la thèse dans une forme assez conventionnelle a édulcoré la force du propos. La morale implicite (du moins pour les appels les plus osés) n’a sans doute pas poussé cette société de la Régence étourdie par ses plaisirs à une réforme urgente.
Une comédie du siècle des Lumières commençant
L’éloge de la raison
Cette comédie révèle les balbutiements du siècle des Lumières. La réflexion sociale est permise par le relatif progressisme manifesté par Philippe d’Orléans. Trivelin, en bon pédagogue, fait appel à l’intelligence et à la mesure de ses hôtes. Il fait l’éloge d’une société policée capable de retour sur elle-même, parce qu’elle a renoncé aux excès spontanés de la barbarie.
« La vengeance avait dicté cette loi ; vingt ans après, la raison l’abolit, et en dicta une plus douce. »
« Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons ; ce n’est plus votre vie que nous poursuivons, c’est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire ; nous vous jetons dans l’esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu’on y éprouve ; nous vous humilions, afin que, nous trouvant superbes, vous vous reprochiez de l’avoir été. »
Ailleurs Trivelin utilise l’argumentation par analogie pour convaincre grâce à la métaphore filée de la maladie du corps social : « Remerciez le sort qui vous conduit ici, il vous remet en nos mains, durs, injustes et superbes ; vous voilà en mauvais état, nous entreprenons de vous guérir ; vous êtes moins nos esclaves que nos malades, et nous ne prenons que trois ans pour vous rendre sains, c’est-à-dire humains, raisonnables et généreux pour toute votre vie. »
Marivaux compte sur les hommes, qui disposent de la force et de la raison, pour faire évoluer la situation conflictuelle. Un peu misogyne, il considère que le sexe faible, plus soumis à l’emprise des sentiments, a la rancune plus tenace. « Mais à présent il faut parler raison ; c’est un langage étranger pour Madame ; elle l’apprendra avec le temps ; il faut se donner patience : je ferai de mon mieux pour l’avancer. »
La victoire des sentiments
La situation conflictuelle peut être dénouée par le bon cœur d’Arlequin.
Iphicrate. — De ton audace et de tes mépris envers ton maître ; rien ne m’a été si sensible, je l’avoue. Tu es né, tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père ; le tien y est encore ; il t’avait recommandé ton devoir en partant ; moi-même je t’avais choisi par un sentiment d’amitié pour m’accompagner dans mon voyage ; je croyais que tu m’aimais, et cela m’attachait à toi. […]
Arlequin. — Tu as raison, mon ami ; tu me remontres bien mon devoir ici pour toi ; mais tu n’as jamais su le tien pour moi, quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affliction, et jamais tu n’as partagé la mienne. Eh bien va, je dois avoir le cœur meilleur que toi ; car il y a plus longtemps que je souffre, et que je sais ce que c’est que de la peine. Tu m’as battu par amitié : puisque tu le dis, je te le pardonne ; je t’ai raillé par bonne humeur, prends-le en bonne part, et fais-en ton profit. […]
Iphicrate, s’approchant d’Arlequin. — Mon cher Arlequin, fasse le ciel, après ce que je viens d’entendre, que j’aie la joie de te montrer un jour les sentiments que tu me donnes pour toi ! Va, mon cher enfant, oublie que tu fus mon esclave, et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais pas d’être ton maître.
Toute la fin est ponctuée des pleurs de repentir, de reconnaissance. Ainsi s’établit grâce aux sentiments une nouvelle hiérarchie fondée sur la générosité. Chaque personnage fait assaut de bonté. La fonction cachée de l’île était bien de rendre ses habitants meilleurs, de susciter cette république du cœur.
La recherche de la vérité
On trouve donc le climat particulier des comédies de Marivaux et déjà les thématiques qu’il reprendra : l’échange des conditions, l’imposture de la vie sociale, le rôle déterminant du hasard, l’aveuglement de l’amour-propre et de la coquetterie, la richesse et la corruption du cœur… Les habits marquent l’appartenance à une classe, fruit du sort et non du mérite personnel. Comme les rites sociaux, ils appartiennent aux apparences et cachent la nature intime des personnes. Pis, ils façonnent le comportement par mimétisme. Ces habits ne sont pas seulement pour Marivaux des masques qui dissimulent. Le dramaturge leur fait aussi jouer le rôle du révélateur pour servir la recherche de la vérité. Privé de sa tenue et de la sécurité ou de la reconnaissance qu’elle représente, le personnage noble est déstabilisé, dépouillé. Revêtu de la tenue du maître, le valet se trouve mal à l’aise. Il doit apprendre l’usage raisonné de cette liberté toute neuve ainsi que les obligations de l’exercice du pouvoir. C’est par l’échange des habits que chacun prend conscience de son être profond et des devoirs de son état.
Un besoin de reconnaissance dissimulé
À l’orée du siècle des Lumières, le bourgeois anobli Marivaux commence à discuter les privilèges de la noblesse d’épée pour promouvoir une hiérarchie du mérite fondée sur l’utilité sociale, le respect et la générosité. Sa contestation est implicite, savamment estompée. Il mise encore sur la puissance réformatrice de la pensée chrétienne.
Marivaux fait œuvre de moraliste et nous demande si nous sommes dignes de la situation où nous a placés la fortune. Mieux, il nous invite à examiner si, installés dans une autre condition, nous en serions pour autant meilleurs.
Notes
1 Selon les termes de Sainte-Beuve. ↑
2 Iphicrate peut rappeler à Arlequin qu’ils ont été élevés comme des demi-frères : « Tu es né, tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père ; le tien y est encore ; il t’avait recommandé ton devoir en partant ; moi-même je t’avais choisi par un sentiment d’amitié pour m’accompagner dans mon voyage ; je croyais que tu m’aimais, et cela m’attachait à toi. » ↑
3 Ce nécessaire assentiment personnel à son état de vie est clairement souligné par Arlequin qui utilise de manière comique l’argument des vêtements :
« Pourquoi avez-vous repris votre habit ?
Arlequin, tendrement. — C’est qu’il est trop petit pour mon cher ami, et que le sien est trop grand pour moi. »
À la fin de la pièce, Trivelin en dévoile la raison : « La différence des conditions n’est qu’une épreuve que les dieux font sur nous ». ↑
4 Arlequin. — Tu as raison, mon ami ; tu me remontres bien mon devoir ici pour toi ; mais tu n’as jamais su le tien pour moi, quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affliction, et jamais tu n’as partagé la mienne. Eh bien va, je dois avoir le cœur meilleur que toi ; car il y a plus longtemps que je souffre, et que je sais ce que c’est que de la peine. Tu m’as battu par amitié : puisque tu le dis, je te le pardonne ; je t’ai raillé par bonne humeur, prends-le en bonne part, et fais-en ton profit.
Arlequin. — Ne dites donc point comme cela, mon cher patron : si j’avais été votre pareil, je n’aurais peut-être pas mieux valu que vous. C’est à moi à vous demander pardon du mauvais service que je vous ai toujours rendu. Quand vous n’étiez pas raisonnable, c’était ma faute.
Iphicrate, l’embrassant. — Ta générosité me couvre de confusion.
Cléanthis. — Ah ! vraiment, nous y voilà, avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre, et puis, qui sont trop heureux dans l’occasion de nous trouver cent fois plus honnêtes gens qu’eux. Fi ! que cela est vilain, de n’avoir eu pour tout mérite que de l’or, de l’argent et des dignités ! C’était bien la peine de faire tant les glorieux ! Où en seriez-vous aujourd’hui, si nous n’avions pas d’autre mérite que cela pour vous ? Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapés ? Il s’agit de vous pardonner, et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s’il vous plaît ? Riche ? non ; noble ? non ; grand seigneur ? point du tout. Vous étiez tout cela ; en valiez-vous mieux ? Et que faut-il donc ? Ah ! nous y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison ; voilà ce qu’il faut, voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu’un homme est plus qu’un autre. ↑