Sujets du bac de français 2011
Centres étrangers : Amérique du Nord
Séries S et ES – Objet d’étude : le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde
Corpus :
- Texte A – Alexandre Dumas, Pauline, 1838.
- Texte B – Émile Zola, La Débâcle, 1892.
- Texte C – André Malraux, La Condition humaine, 1933.
- Texte D – Julien Gracq, Un Balcon en forêt, 1958.
Alexandre DUMAS, Pauline, 1838.
En Inde, lors d’un dîner, des officiers anglais manifestent de façon moqueuse leur peu d’estime pour le jeune comte Horace de Beuzeval, du fait de son apparence fragile. Pour les détromper, le comte décide d’affronter seul, le lendemain, sous leurs yeux, une tigresse.
Il regarda donc circulairement autour de lui, et dans un enfoncement pratiqué dans l’herbe et pareil à une voûte de quatre ou cinq pieds de profondeur il aperçut la tigresse couchée à moitié, la gueule béante et les yeux fixés sur lui ; ses petits jouaient sous son ventre comme de jeunes chats.
Ce qui se passa dans son âme à cette vue, lui seul peut le dire ; mais son âme est un abîme d’où rien ne sort. Quelque temps la tigresse et lui se regardèrent immobiles ; et, voyant que de peur de quitter ses petits, sans doute, elle ne venait pas à lui, ce fut lui qui alla vers elle.
Il en approcha ainsi jusqu’à la distance de quatre pas ; puis, voyant qu’enfin elle faisait un mouvement pour se soulever, il se rua sur elle. Ceux qui regardaient et écoutaient1 entendirent à la fois un rugissement et un cri ; ils virent pendant quelques secondes les roseaux s’agiter ; puis le silence et la tranquillité leur succédèrent : tout était fini.
Ils attendirent un instant pour voir si le comte reviendrait ; mais le comte ne revint pas. Alors ils eurent honte de l’avoir laissé entrer seul, et se décidèrent, puisqu’ils n’avaient pas sauvé sa vie, à sauver du moins son cadavre. Ils s’avancèrent dans le marais tous ensemble et pleins d’ardeur, s’arrêtant de temps en temps pour écouter, puis se remettant aussitôt en chemin ; enfin ils arrivèrent à la clairière et trouvèrent les deux adversaires couchés l’un sur l’autre : la tigresse était morte, et le comte évanoui. Quant aux deux petits, trop faibles pour dévorer le corps, ils léchaient le sang.
La tigresse avait reçu dix-sept coups de poignard, le comte un coup de dent qui lui avait brisé le bras gauche, et un coup de griffe qui lui avait déchiré la poitrine.1 II s’agit des officiers anglais.
Émile ZOLA, La Débâcle, 1892.
La défaite de l’armée française à Sedan dans les Ardennes conduit à la capitulation de la France devant la Prusse le 2 septembre 1870, et marque la fin du Second Empire de Napoléon III. Zola retrace la bataille de Sedan dans son roman La Débâcle.
La ville est assaillie, la défaite déjà certaine. Le soldat français Gaude vient d’être abattu alors qu’il tentait un ultime geste de résistance face à l’ennemi. Son camarade Rochas est en danger.
Cela ne lui1 entrait pas dans la cervelle, que ce fût la défaite encore. On changeait tout, même la façon de se battre. Ces gens n’auraient-ils pas dû attendre, de l’autre côté du vallon, qu’on allât les vaincre ? On avait beau en tuer, il en arrivait toujours. Qu’est-ce que c’était que cette fichue guerre, où l’on se rassemblait dix pour en écraser un, où l’ennemi ne se montrait que le soir, après vous avoir mis en déroute par toute une journée de prudente canonnade2 ? Ahuri, éperdu, n’ayant jusque là rien compris à la campagne3, il se sentait enveloppé, emporté par quelque chose de supérieur, auquel il ne résistait plus, bien qu’il répétât machinalement, dans son obstination :
– Courage, mes enfants, la victoire est là-bas !
D’un geste prompt, cependant, il avait repris le drapeau. C’était sa pensée dernière, le cacher, pour que les Prussiens ne l’eussent pas. Mais, bien que la hampe4 fût rompue, elle s’embarrassa dans ses jambes, il faillit tomber. Des balles sifflaient, il sentit la mort, il arracha la soie du drapeau, la déchira, cherchant à l’anéantir. Et ce fut à ce moment que, frappé au cou, à la poitrine, aux jambes, il s’affaissa par minces lambeaux tricolores, comme vêtu d’eux. Il vécut encore une minute, les yeux élargis, voyant peut-être monter à l’horizon la vision vraie de la guerre, l’atroce lutte vitale qu’il ne faut accepter que d’un cœur résigné et grave, ainsi qu’une loi. Puis, il eut un petit hoquet, il s’en alla dans son ahurissement d’enfant, tel qu’un pauvre être borné, un insecte joyeux, écrasé sous la nécessité de l’énorme et impassible nature. Avec lui, finissait une légende.1 « lui » : il s’agit de Rochas.
2 « canonnade » : tir de canons.
3 « campagne » : campagne militaire.
4 « hampe » : manche en bois auquel est fixé le drapeau.
André MALRAUX, La Condition humaine, 1933.
En 1927, en Chine, Kyo, leader communiste, considéré à cause de ses actes révolutionnaires comme un terroriste, est jeté en prison. Il se trouve dans une vaste salle commune où gémissent de nombreux autres opposants politiques, pour la plupart blessés. Il risque, de manière imminente, d’être torturé et jeté vif dans une chaudière. Pour éviter de parler et de trahir sa cause, il prévoit d’avaler l’ampoule de cyanure dont il s’est muni.
Et une rumeur inentendue prolongeait jusqu’au fond de la nuit ce chuchotement de la douleur : ainsi qu’Hemmelrich1, presque tous ces hommes avaient des enfants. Pourtant, la fatalité acceptée par eux montait avec leur bourdonnement de blessés comme la paix du soir, recouvrait Kyo, ses yeux fermés, ses mains croisées sur son corps abandonné, avec une majesté de chant funèbre. Il aurait combattu pour ce qui, de son temps, aurait été chargé du sens le plus fort et du plus grand espoir ; il mourrait parmi ceux avec qui il aurait voulu vivre ; il mourrait, comme chacun de ces hommes couchés, pour avoir donné un sens à sa vie. Qu’eût valu une vie pour laquelle il n’eût pas accepté de mourir ? Il est facile de mourir quand on ne meurt pas seul. Mort saturée de ce chevrotement fraternel, assemblée de vaincus où des multitudes reconnaîtraient leurs martyrs2, légende sanglante dont se font les légendes dorées ! Comment, déjà regardé par la mort, ne pas entendre ce murmure de sacrifice humain qui lui criait que le cœur viril des hommes est un refuge à morts qui vaut bien l’esprit ?
II tenait maintenant le cyanure dans sa main. Il s’était souvent demandé s’il mourrait facilement. Il savait que, s’il décidait de se tuer, il se tuerait ; mais, connaissant la sauvage indifférence avec quoi la vie nous démasque à nous-mêmes, il n’avait pas été sans inquiétude sur l’instant où la mort écraserait sa pensée de toute sa pesée sans retour.
Non, mourir pouvait être un acte exalté3, la suprême expression d’une vie à quoi cette mort ressemblait tant ; et c’était échapper à ces deux soldats qui s’approchaient en hésitant. Il écrasa le poison entre ses dents comme il eût commandé, entendit encore Katow1 l’interroger avec angoisse et le toucher, et, au moment où il voulait se raccrocher à lui, suffoquant, il sentit toutes ses forces le dépasser, écartelées au-delà de lui-même contre une toute-puissante convulsion4.1 « Hemmelrich » et « Katow » : compagnons de combat de Kyo.
2 « martyrs » : personnes qui souffrent ou meurent pour une cause.
3 « exalté » : passionné.
4 « convulsion » : contraction violente et involontaire des muscles.
Julien GRACQ, Un Balcon en forêt, 1958.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, l’armée française se prépare à une offensive ennemie qui tarde à venir. Après d’interminables mois d’attente et de guet dans une construction fortifiée en pleine forêt ardennaise, le capitaine Grange, personnage principal du roman de Gracq, essuie les premières balles allemandes. Il est blessé.
Une hâte, une angoisse enfantine, le tiraient maintenant en avant, arrachant un pas après l’autre sa mauvaise jambe aux trous du sentier noir : il marchait vers la maison1 comme s’il était attendu. Quand il s’arrêtait, les tempes battantes de fièvre, trempé de sueur, il tendait de nouveau l’oreille au silence des taillis2, étonné de ce monde autour de lui qui laissait fuir l’homme comme un tas de sable laisse fuir l’eau. Une faiblesse le saisissait à la nuque ; il jeta son casque : l’air frais autour de son cou lui fit du bien. « Personne ! se répétait-il. Personne ! » De nouveau il avait envie de pleurer sur lui ; son cœur se nouait. « Je vais peut-être mourir » pensa-t-il encore. Son esprit s’engouait3 malgré lui, entraîné par une pesanteur grandissante : il pensait maintenant à la gangrène qui se met dans les plaies infectées ; l’idée fixe, délirante, le saisit tout à coup que sa jambe noircissait : il s’arrêta, s’allongea par terre, et commença à relever la jambe de sa culotte4. « J’ai oublié ma lampe électrique » pensa-t-il brusquement, et de nouveau une colère folle, impuissante, le souleva de hoquets : penché en avant dans les ténèbres épaisses, avec une obstination bovine, il essayait, en tirant sur ses reins douloureux, d’approcher son œil de sa jambe. Il sentit qu’il allait s’évanouir – la coulée de sueur froide redescendait de son front à ses reins – couché sur le côté, il vomit à petits coups le vin rouge et le peu de biscuit qu’il avait mangé. Cependant, dès qu’il était allongé et immobile, de nouveau il souffrait peu, ses forces lui revenaient – un sentiment de tranquillité, de bonheur stupide l’envahissait, comme s’il était monté de la terre. « On dirait que je suis convalescent, songea-t-il. Mais de quoi ? ». Il resta allongé ainsi une bonne heure. Il n’était plus pressé de repartir ; il regardait au-dessus de lui les branches des arbres qui voûtaient à demi le chemin contre le ciel plus clair : il lui semblait que la nuit devant lui s’étendait avec la coulée de cette voûte insondablement5 longue et paisible – il se sentait perdu, mais vraiment perdu, sorti de toutes les ornières : personne ne l’attendait plus, jamais – nulle part. Ce moment lui paraissait délicieux.
1 « maison » : renvoie à la construction fortifiée.
2 « taillis » : partie de forêt où les arbres, régulièrement taillés, restent de dimension modeste.
3 « s’engouait » : s’emballait.
4 « culotte » : pantalon de l’uniforme militaire.
5 « insondablement » : d’une profondeur impossible à mesurer.
I. Vous répondrez d’abord à la question suivante (4 points)
En quoi l’emploi du point de vue interne contribue-t-il à l’intensité dramatique de ces scènes ?
II. Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des sujets suivants (16 points)
Commentaire
Vous commenterez le texte de Julien Gracq (texte D).
Dissertation
Un personnage de roman doit-il nécessairement surmonter des épreuves pour être considéré comme un héros de fiction ?
Écriture d’invention
Vous rédigerez les notes personnelles d’un soldat français qui a assisté à la mort de Rochas, le personnage de Zola (texte B) : au soir de la bataille de Sedan, il restitue dans son carnet sa propre vision de la mort de son camarade et livre les réflexions que le combat lui a inspirées.
Série L – Objet d’étude : l’argumentation : convaincre, persuader, délibérer
Corpus :
- Texte A – Michel de Montaigne, Essais, III, 9, « De la vanité », 1588.
- Texte B – Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, 1955.
- Texte C – Nicolas Bouvier, L’Usage du monde, 1963.
Michel de MONTAIGNE, Essais, III, 9, « De la vanité », 1588.
Dans le chapitre « De la vanité », Montaigne aborde plusieurs fois le thème du voyage. Il justifie ses propres voyages, raconte son séjour en Italie et évoque l’attitude des Français qu’il a pu rencontrer à l’étranger.
Quand j’ai été ailleurs qu’en France et que, pour me faire courtoisie, on m’a demandé, si je voulais être servi à la française, je m’en suis moqué, et me suis toujours jeté aux tables les plus épaisses1 d’étrangers. J’ai honte de voir nos hommes2, enivrés de cette sotte humeur, de s’effaroucher des formes contraires aux leurs. Il leur semble être hors de leur élément, quand ils sont hors de leur village. Où qu’ils aillent, ils se tiennent à leurs façons, et abominent3 les étrangères. Retrouvent- ils un compatriote en Hongrie, ils festoient cette aventure : les voilà à se rallier ; et à se recoudre ensemble ; à condamner tant de moeurs barbares qu’ils voient. Pourquoi non barbares, puisqu’elles ne sont françaises ? Encore sont-ce les plus habiles, qui les ont reconnues, pour en médire : la plupart ne prennent l’aller que pour le venir4. Ils voyagent couverts et resserrés, d’une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la contagion d’un air inconnu. Ce que je dis de ceux-là, me ramentoit en5 chose semblable, ce que j’ai parfois aperçu en aucuns6 de nos jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu’aux hommes de leur sorte : nous regardent comme des gens de l’autre monde, avec dédain, ou pitié. Ôtez-leur les entretiens des mystères de la cour, ils sont hors de leur gibier7. Aussi neufs pour nous et malhabiles, comme nous sommes à eux. On dit bien vrai, qu’un honnête homme, c’est un homme mêlé8.
1 « épaisses » : fournies.
2 « nos hommes » : c’est-à-dire nos compatriotes
3 « abominent » : ont en horreur, détestent.
4 Montaigne joue sur l’expression « prendre l’aller pour le venir » qui signifie agir en vain. Pour la plupart, le voyage n’apporte donc aucun enrichissement.
5 « ramentoit en » : rappelle.
6 « en aucuns » : chez quelques-uns.
7 « gibier » : domaine.
8 « mêlé » : nourri d’influences diverses.
Claude LÉVI-STRAUSS, Tristes Tropiques, 1955.
Dans les années 1930, après des études de philosophie, Lévi-Strauss se tourne vers l’ethnologie et dirige deux expéditions au Brésil. Il revient sur cette expérience dans Tristes Tropiques qu’il publie en 1955. Le texte suivant constitue l’incipit de l’ouvrage.
Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m’apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m’y résoudre ! Quinze ans ont passé depuis que j’ai quitté pour la dernière fois le Brésil et, pendant toutes ces années, j’ai souvent projeté d’entreprendre ce livre ; chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m’en ont empêché. Eh quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d’événements insignifiants ? L’aventure n’a pas de place dans la profession d’ethnographe ; elle en est seulement une servitude, elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin ; des heures oisives pendant que l’informateur se dérobe ; de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie ; et toujours, de ces mille corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire… Qu’il faille tant d’efforts, et de vaines dépenses pour atteindre l’objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu’il faudrait plutôt considérer comme l’aspect négatif de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n’ont de valeur que dépouillées de cette gangue1. On peut, certes, consacrer six mois de voyage, de privation et d’écœurante lassitude à la collecte (qui prendra quelques jours, parfois quelques heures) d’un mythe inédit, d’une règle de mariage nouvelle, d’une liste complète de noms claniques2, mais cette scorie3 de la mémoire : « À 5 h 30 du matin, nous entrions en rade4 de Recife5 tandis que piaillaient les mouettes et qu’une flotille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque », un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ?
1 « gangue » : enveloppe.
2 « claniques » : qui relèvent d’un clan.
3 « scorie » : déchet, résidu.
4 « rade » : bassin maritime naturel.
5 « Recife » : port brésilien.
Nicolas BOUVIER, L’Usage du monde, 1963.
Écrivain suisse de langue française, Bouvier effectue en 1953 un voyage en voiture qui le conduit jusqu’en Extrême-Orient. Il raconte la première partie de ce périple, qui le mène en Afghanistan, dans L’Usage du monde.
La fin du jour est silencieuse. On a parlé son saoul en déjeunant. Porté par le chant du moteur et le défilement du paysage, le flux du voyage vous traverse, et vous éclaircit la tête. Des idées qu’on hébergeait sans raison vous quittent ; d’autres au contraire s’ajustent et se font à vous comme les pierres au lit d’un torrent. Aucun besoin d’intervenir, la route travaille pour vous. On souhaiterait qu’elle s’étende ainsi, en dispensant ses bons offices, non seulement jusqu’à l’extrémité de l’Inde, mais plus loin encore, jusqu’à la mort.
À mon retour, il s’est trouvé beaucoup de gens qui n’étaient pas partis, pour me dire qu’avec un peu de fantaisie et de concentration ils voyageaient tout aussi bien sans lever le cul de leur chaise. Je les crois volontiers. Ce sont des forts. Pas moi. J’ai trop besoin de cet appoint concret qu’est le déplacement dans l’espace. Heureusement d’ailleurs que le monde s’étend pour les faibles et les supporte, et quand le monde, comme certains soirs sur la route de Macédoine, c’est la lune à main gauche, les flots argentés de la Morava1 à main droite, et la perspective d’aller chercher derrière l’horizon un village où vivre les trois prochaines semaines, je suis bien aise de ne pouvoir m’en passer. […]
À l’est d’Erzerum2, la piste est très solitaire. De grandes distances séparent les villages. Pour une raison ou une autre, il peut arriver qu’on arrête la voiture et passe la fin de la nuit dehors. Au chaud dans une grosse veste de feutre, un bonnet de fourrure tiré sur les oreilles, on écoute l’eau bouillir sur le primus3 à l’abri d’une roue. Adossé contre une colline, on regarde les étoiles, les mouvements vagues de la terre qui s’en va vers le Caucase, les yeux phosphorescents des renards. Le temps passe en thés brûlants, en propos rares, en cigarettes, puis l’aube se lève, s’étend, les cailles et les perdrix s’en mêlent… et on s’empresse de couler cet instant souverain comme un corps mort au fond de sa mémoire, où on ira le rechercher un jour. On s’étire, on fait quelques pas, pesant moins d’un kilo, et le mot « bonheur » paraît bien maigre et particulier pour décrire ce qui vous arrive.
Finalement, ce qui constitue l’ossature de l’existence, ce n’est ni la famille, ni la carrière, ni ce que d’autres diront ou penseront de vous, mais quelques instants de cette nature, soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l’amour, et que la vie nous distribue avec une parcimonie4 à la mesure de notre faible cœur.1 « Morava » : rivière de Serbie, affluent du Danube.
2 « Erzerum » : ville de l’est de la Turquie, à 1945 mètres d’altitude.
3 « primus » : réchaud.
4 « parcimonie » : c’est-à-dire en petite quantité.
I. Vous répondrez d’abord à la question suivante (4 points)
En quoi l’utilisation par les trois auteurs de leur expérience de voyageur est-elle efficace pour convaincre et persuader ? Votre réponse n’excédera pas une vingtaine de lignes.
II. Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des sujets suivants (16 points)
Commentaire
Vous commenterez le texte de Lévi-Strauss (Texte B).
Dissertation
Tirant la leçon de ses voyages, Bouvier écrit : « Des idées qu’on hébergeait sans raison vous quittent ; d’autres au contraire s’ajustent et se font à vous comme les pierres au lit d’un torrent. » (lignes 3 et 4). Pensez-vous que ce jugement que Bouvier porte sur le voyage puisse aussi renvoyer à la fonction de la littérature ?
Écriture d’invention
Dans la lettre ouverte qu’il publiera dans un magazine de voyage, un explorateur (ou une exploratrice) répond à la question finale de Lévi-Strauss (texte B) : « […] un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ? ». Il y défend la nécessité et l’intérêt de faire partager aux lecteurs les détails concrets du déroulement d’une expédition. Il fait lui-même référence à ses voyages ainsi qu’à ses lectures.
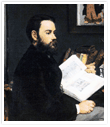 Cela ne lui1 entrait pas dans la cervelle, que ce fût la défaite encore. On changeait tout, même la façon de se battre. Ces gens n’auraient-ils pas dû attendre, de l’autre côté du vallon, qu’on allât les vaincre ? On avait beau en tuer, il en arrivait toujours. Qu’est-ce que c’était que cette fichue guerre, où l’on se rassemblait dix pour en écraser un, où l’ennemi ne se montrait que le soir, après vous avoir mis en déroute par toute une journée de prudente canonnade2 ? Ahuri, éperdu, n’ayant jusque là rien compris à la campagne3, il se sentait enveloppé, emporté par quelque chose de supérieur, auquel il ne résistait plus, bien qu’il répétât machinalement, dans son obstination :
Cela ne lui1 entrait pas dans la cervelle, que ce fût la défaite encore. On changeait tout, même la façon de se battre. Ces gens n’auraient-ils pas dû attendre, de l’autre côté du vallon, qu’on allât les vaincre ? On avait beau en tuer, il en arrivait toujours. Qu’est-ce que c’était que cette fichue guerre, où l’on se rassemblait dix pour en écraser un, où l’ennemi ne se montrait que le soir, après vous avoir mis en déroute par toute une journée de prudente canonnade2 ? Ahuri, éperdu, n’ayant jusque là rien compris à la campagne3, il se sentait enveloppé, emporté par quelque chose de supérieur, auquel il ne résistait plus, bien qu’il répétât machinalement, dans son obstination : Et une rumeur inentendue prolongeait jusqu’au fond de la nuit ce chuchotement de la douleur : ainsi qu’Hemmelrich1, presque tous ces hommes avaient des enfants. Pourtant, la fatalité acceptée par eux montait avec leur bourdonnement de blessés comme la paix du soir, recouvrait Kyo, ses yeux fermés, ses mains croisées sur son corps abandonné, avec une majesté de chant funèbre. Il aurait combattu pour ce qui, de son temps, aurait été chargé du sens le plus fort et du plus grand espoir ; il mourrait parmi ceux avec qui il aurait voulu vivre ; il mourrait, comme chacun de ces hommes couchés, pour avoir donné un sens à sa vie. Qu’eût valu une vie pour laquelle il n’eût pas accepté de mourir ? Il est facile de mourir quand on ne meurt pas seul. Mort saturée de ce chevrotement fraternel, assemblée de vaincus où des multitudes reconnaîtraient leurs martyrs2, légende sanglante dont se font les légendes dorées ! Comment, déjà regardé par la mort, ne pas entendre ce murmure de sacrifice humain qui lui criait que le cœur viril des hommes est un refuge à morts qui vaut bien l’esprit ?
Et une rumeur inentendue prolongeait jusqu’au fond de la nuit ce chuchotement de la douleur : ainsi qu’Hemmelrich1, presque tous ces hommes avaient des enfants. Pourtant, la fatalité acceptée par eux montait avec leur bourdonnement de blessés comme la paix du soir, recouvrait Kyo, ses yeux fermés, ses mains croisées sur son corps abandonné, avec une majesté de chant funèbre. Il aurait combattu pour ce qui, de son temps, aurait été chargé du sens le plus fort et du plus grand espoir ; il mourrait parmi ceux avec qui il aurait voulu vivre ; il mourrait, comme chacun de ces hommes couchés, pour avoir donné un sens à sa vie. Qu’eût valu une vie pour laquelle il n’eût pas accepté de mourir ? Il est facile de mourir quand on ne meurt pas seul. Mort saturée de ce chevrotement fraternel, assemblée de vaincus où des multitudes reconnaîtraient leurs martyrs2, légende sanglante dont se font les légendes dorées ! Comment, déjà regardé par la mort, ne pas entendre ce murmure de sacrifice humain qui lui criait que le cœur viril des hommes est un refuge à morts qui vaut bien l’esprit ? Quand j’ai été ailleurs qu’en France et que, pour me faire courtoisie, on m’a demandé, si je voulais être servi à la française, je m’en suis moqué, et me suis toujours jeté aux tables les plus épaisses1 d’étrangers. J’ai honte de voir nos hommes2, enivrés de cette sotte humeur, de s’effaroucher des formes contraires aux leurs. Il leur semble être hors de leur élément, quand ils sont hors de leur village. Où qu’ils aillent, ils se tiennent à leurs façons, et abominent3 les étrangères. Retrouvent- ils un compatriote en Hongrie, ils festoient cette aventure : les voilà à se rallier ; et à se recoudre ensemble ; à condamner tant de moeurs barbares qu’ils voient. Pourquoi non barbares, puisqu’elles ne sont françaises ? Encore sont-ce les plus habiles, qui les ont reconnues, pour en médire : la plupart ne prennent l’aller que pour le venir4. Ils voyagent couverts et resserrés, d’une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la contagion d’un air inconnu. Ce que je dis de ceux-là, me ramentoit en5 chose semblable, ce que j’ai parfois aperçu en aucuns6 de nos jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu’aux hommes de leur sorte : nous regardent comme des gens de l’autre monde, avec dédain, ou pitié. Ôtez-leur les entretiens des mystères de la cour, ils sont hors de leur gibier7. Aussi neufs pour nous et malhabiles, comme nous sommes à eux. On dit bien vrai, qu’un honnête homme, c’est un homme mêlé8.
Quand j’ai été ailleurs qu’en France et que, pour me faire courtoisie, on m’a demandé, si je voulais être servi à la française, je m’en suis moqué, et me suis toujours jeté aux tables les plus épaisses1 d’étrangers. J’ai honte de voir nos hommes2, enivrés de cette sotte humeur, de s’effaroucher des formes contraires aux leurs. Il leur semble être hors de leur élément, quand ils sont hors de leur village. Où qu’ils aillent, ils se tiennent à leurs façons, et abominent3 les étrangères. Retrouvent- ils un compatriote en Hongrie, ils festoient cette aventure : les voilà à se rallier ; et à se recoudre ensemble ; à condamner tant de moeurs barbares qu’ils voient. Pourquoi non barbares, puisqu’elles ne sont françaises ? Encore sont-ce les plus habiles, qui les ont reconnues, pour en médire : la plupart ne prennent l’aller que pour le venir4. Ils voyagent couverts et resserrés, d’une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la contagion d’un air inconnu. Ce que je dis de ceux-là, me ramentoit en5 chose semblable, ce que j’ai parfois aperçu en aucuns6 de nos jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu’aux hommes de leur sorte : nous regardent comme des gens de l’autre monde, avec dédain, ou pitié. Ôtez-leur les entretiens des mystères de la cour, ils sont hors de leur gibier7. Aussi neufs pour nous et malhabiles, comme nous sommes à eux. On dit bien vrai, qu’un honnête homme, c’est un homme mêlé8. Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m’apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m’y résoudre ! Quinze ans ont passé depuis que j’ai quitté pour la dernière fois le Brésil et, pendant toutes ces années, j’ai souvent projeté d’entreprendre ce livre ; chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m’en ont empêché. Eh quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d’événements insignifiants ? L’aventure n’a pas de place dans la profession d’ethnographe ; elle en est seulement une servitude, elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin ; des heures oisives pendant que l’informateur se dérobe ; de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie ; et toujours, de ces mille corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire… Qu’il faille tant d’efforts, et de vaines dépenses pour atteindre l’objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu’il faudrait plutôt considérer comme l’aspect négatif de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n’ont de valeur que dépouillées de cette gangue1. On peut, certes, consacrer six mois de voyage, de privation et d’écœurante lassitude à la collecte (qui prendra quelques jours, parfois quelques heures) d’un mythe inédit, d’une règle de mariage nouvelle, d’une liste complète de noms claniques2, mais cette scorie3 de la mémoire : « À 5 h 30 du matin, nous entrions en rade4 de Recife5 tandis que piaillaient les mouettes et qu’une flotille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque », un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ?
Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m’apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m’y résoudre ! Quinze ans ont passé depuis que j’ai quitté pour la dernière fois le Brésil et, pendant toutes ces années, j’ai souvent projeté d’entreprendre ce livre ; chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m’en ont empêché. Eh quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d’événements insignifiants ? L’aventure n’a pas de place dans la profession d’ethnographe ; elle en est seulement une servitude, elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin ; des heures oisives pendant que l’informateur se dérobe ; de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie ; et toujours, de ces mille corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire… Qu’il faille tant d’efforts, et de vaines dépenses pour atteindre l’objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu’il faudrait plutôt considérer comme l’aspect négatif de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n’ont de valeur que dépouillées de cette gangue1. On peut, certes, consacrer six mois de voyage, de privation et d’écœurante lassitude à la collecte (qui prendra quelques jours, parfois quelques heures) d’un mythe inédit, d’une règle de mariage nouvelle, d’une liste complète de noms claniques2, mais cette scorie3 de la mémoire : « À 5 h 30 du matin, nous entrions en rade4 de Recife5 tandis que piaillaient les mouettes et qu’une flotille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque », un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ?